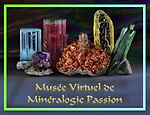LES MINERAUX D'AUVERGNE

Une compilation de Nathalie Bertrand,
animatrice du Musée de Minéralogie Passion,
et JJ Chevallier.

Nathalie Bertrand
alias
Nath Berliozette
Assistante et auteur de textes.
MARSANGES,
district de Langeac -Haute-Loire.
(cf. La Montagne, publié le 09/01/2017 © Glaine Yannic, Mindat et Géowiki)
Marsanges, c’est trois sites emblématiques : La Drey, Chavaniac-Lafayette et Langeac qui a été l’une des plus grosses productrices de fluorite de France. La ville de Langeac est passée à la postérité minière française grâce au charbon, mais surtout à ses importants gisements de fluorite. L’exploitation arrêtée en 1979 fut l’une des plus grosses productrices de fluorite de France.

Historique :
Ancienne mine de charbon, puis d’antimoine et pour finir de fluorine située près de Marsanges, à 6,5 km au SSW de Langeac, les travaux d'exploitation se déroulaient à flanc de montagne.
L’extraction du « charbon de terre » à Marsanges remonte à des temps très anciens. Cependant, ce n’est qu’après l’ordonnance royale de 1831 que l’exploitation industrielle a véritablement commencé.
Le volume annuel est passé très vite, en moins de trente ans, de 15 tonnes en 1824 à 2 500 tonnes en 1850. Mais l’enclavement de la mine était un gros obstacle a son développement.
L’exploitation de la ligne P.L.M. Langeac-Brioude, en 1867, a permis d’expédier le charbon vers Clermont-Ferrand.
En 1870, l’ouverture de la ligne dite des Cévennes ouvre de nouvelles perspective commerciales vers le Sud, Nîmes et Marseille.
Le chemin de fer Decauville a été installé en 1877, pour relier la mine à l’usine de lavage et de tri de Chambaret. L’exploitation a pris son essor à partir de cette année-là.
La mine, employait près de 200 personnes, en 1914.
Malheureusement, l’épuisement des filons de charbon a entraîné sa fermeture définitive le 31 décembre 1924.
L'estimation totale de la production de charbon est de 1 400 000 tonnes, de 1832 à 1924, dont 1 250 000 tonnes extraites entre 1876 et 1920.
Après sa fermeture, l’ensemble des infrastructures ont été rachetées par une filiale de Péchiney pour l’exploitation des dépôts d'antimoine et de fluorite.
Débutée en 1830 pour l'extraction d'antimoine mais rapidement orientée vers l'extraction de fluorine, cette mine exploitait plusieurs gros filons constitués principalement de fluorine et de quartz, encaissés dans des gneiss. Ce gisement, qui fut l'un des plus importants de France, fut exploité jusqu'en 1975 par la société Pechiney (SECME) qui produisit 930 000 tonnes de fluorine et jusqu'en 1977 par P. Lebrat, un industriel local.
Tous personnels confondus (jour et fond) l’effectif était composé d’environ 150 personnes au début pour terminer à 70 à la fermeture en juin 1979. La totalité du personnel fut reclassée dans les mines de spath fluoré à Fontsante proche de Saint-Raphaël, de bauxite à Brignoles (Var) et dans différentes usines de la société.
Par suite de la décision de son conseil municipal de faire de 1997 l’année de la mine et des mineurs (avec notamment la pose de la lampe des mineurs sur la fontaine des capucins), Guy Vissac, maire, écrivait dans une lettre envoyée aux mineurs que "Langeac se doit de ne pas effacer ce passé afin de garder la mémoire de la mine et des mineurs".
Vingt ans après, seuls quelques mineurs retraités peuvent témoigner de cette période qui restera gravée dans le patrimoine langeadois, mais qui reste méconnue des nouvelles générations.
Les plus beaux spécimens de fluorine de Haute-Loire proviennent de ce célèbre gisement. Depuis 2017, la mine appartient à un collectionneur de minéraux (N. Vignat) qui exploite à nouveau cette mine pour la production de spécimens minéralogiques. Par conséquent, la collecte ici (même sur de grands terrils subsistant près d'anciennes galeries) n'est pas autorisée sans son autorisation.
Outre le filon principal, qui était le plus gros amas de fluorine du gisement, 50 m de haut, 70 m de long et 18 m de large (63 0000 m3), cet amas résultant du croisement des filons Communal, Pastro et X), de nombreux autres filons sont connus et ont été exploités. Voici les plus importants :
- Filon Le Communal (Costebois) : Ce filon est le plus long du gisement (600 m de long, 3 m de large). Sa partie nord a été exploitée par P. Lebrat et sa partie sud par la société Pechiney.
- Filon Marmeisse : le filon occidental du gisement avec les sulfures les plus abondants, notamment la galène et la sphalérite.
- Filon Pastro : le filon sud du gisement, avec du quartz riche en stibine.
- Filon X et filon Y (dans les niveaux supérieurs) : deux "petits" filons (200 m de long, 1 m de large) à côté du filon Pastro.
- Filon Les Italiens : un filon au sud du filon Communal.
- veine n°5 et veine n°4 (dans les niveaux inférieurs) : deux veines au nord de la veine Communale.
Production sur le bassin langeadois :
Marsanges pour une production de plus de 750.000 tonnes, La Drey (au nord du village de Barlet) avec 450.000 tonnes et Chavaniac-Lafayette avec 700.000 tonnes. Au total, une production de plus de 2.000.000 de tonnes.
La plupart des spécimens minéraux proviennent de ces veines les plus importantes qui contiennent de nombreuses vacuoles (parfois très grosses) mais quelques spécimens ont aussi été trouvés dans les veines les plus petites.
Selon J.-J. Périchaud (1970), 4 stades de minéralisation sont connus dans ces veines :
1) mise en faille de gneiss puis dépôts de quartz gris et de sulfures (pyrite, arsénopyrite, stibine...) (au cours du Stéphanien/Permien)
2) nouvel élargissement des veines et large remplissage par de la fluorine violette et/ou verte (octaédrique ou massive) à quartz blanc (fluides à 145°C au cours du Trias/Lias inférieur).
3) gisements (en veines) de fluorite cubique bleue/jaune/incolore avec sulfures (chalcopyrite, pyrite, bournonite, galène, sphalérite...) et quartz, sidérite, dolomite, baryte, calcite...
4) Dans les parties supérieures des veines, altération de sulfures et gisements de minéraux secondaires (chalcanthite, cérussite, goethite...)
Minéraux :
La fluorite, elle présente surtout une cristallisation en cubes (jusqu’à 10 cm), mais on trouve aussi fréquemment des octaèdres ; les couleurs dominantes sont le violet et le vert pour la partie massive, mais on trouve des cristaux mauves, rose pâle à rose vif, bleus, verts, jaunes, incolores. Les croissances peuvent produire des spécimens de plusieurs couleurs.

On trouve aussi des minéraux classiques très connus : quartz, barytine, chalcopyrite, bournonite, tétraédrite, sidérite, limonite, calcite, dolomie, sphalérite...
Et d'autres beaucoup moins connus et plus rares
La bismite est un minéral secondaire provenant de l’altération des minerais de bismuth, en particulier du bismuth natif.
La childrenite est un phosphate d’aluminium, tardif et rare des filons métallifères, des pegmatites à phosphates.
La Churchite, phosphate d’yttrium hydraté, à cristaux aciculaires rayonnants.
Hinsdalite, minéral secondaire dans la zone oxydée des gisements de sulfures polymétalliques.
Hydroxylherderite . Analogue à dominance hydroxyle de l’Herderite . L’hydroxylherderite est isotypique de la Datolite. On la trouve généralement sous forme de pegmatite formée au cours d’un dépôt hydrothermal tardif.
Iodargyrite, halogénure d’argent, minéral rare des "chapeaux de fer" (zone d’oxydation) des gisements plumbo-argentifères et cuproargentifères
Jarosite, minéral secondaire courant des gisements de fer dans les zones arides par altération de la pyrite, constitué d’hydroxy-sulfate de fer et de .
Kidwellite, phosphate hydraté de fer contenant des halogènes ou des hydroxyles, minéral de stade tardif ou secondaire qui se trouve généralement dans les gisements de fer contenant du phosphate, en remplacement de la béraunite et de la rockbridgeite.
Lacroixite, très rare à l’état pur, on la trouve fréquemment sous forme de grains et de bâtonnets dans les marges altérées de cristaux en blocs et de grains d’amblygonite ou de montébrasite enchâssés dans une matrice de pegmatite granitique, on la trouve très rarement dans les cristaux de montébrasite s’étendant dans des cavités.
Mawsonite, sulfure de cuivre, fer, étain, des gisements de cuivre hydrothermaux dans des roches volcaniques altérées, il est également présent dans des gisements de skarns et sous forme de disséminations dans des granites altérés.
Stannite, sulfure mixte de cuivre , de fer et d’étain , Cu 2 FeSnS4 , utilisé comme second minerai d’étain, relativement rare il apparaît dans les filons stannifères de haute température avec la cassitérite et la wolframite
Stolzite, Zone d’oxydation des gisements hydrothermaux de plomb contenant du tungstène.
Strengite, minéral secondaire formé dans des conditions de surface ou proches de la surface par l’altération de phosphates ferreux, tels que la triphylite dans la pegmatite ou la dufrénite , ou peut se produire dans des gisements de minerai de limonite et des chapeaux de fer, des minerais de fer magnétite, une minéralisation à un stade tardif dans les pegmatites granitiques, ou rarement comme minéral de grotte.
Uranpyrochlore, minéral isométrique hexaoctaédrique contenant de l’uranium, du calcium, du cérium, du fluor, de l’hydrogène, du niobium, du tantale, du fluor, de l’oxygène et de l’hydrogène...
Varlamoffite, oxyde d’étain secondaire résultant de l’oxydation de sulfosels riches en étain soluble dans les acides et n’était donc pas de la cassitérite et que certains considéraient comme une simple variété de cassitérite - bien que ce ne soit probablement pas le cas.
Synchysite (Ce) - mine de Marsange.
CaCe(CO 3 ) 2 F
Passée à la loupe, en fait au MEB par François Périnet.
%2C%20Mine%20de%20Marsanges%2C%20Langeac%2C%20Haute-Loire_.jpg)
Synchrisite mine de Marsange, Haute-Loire
" Cristaux avec mélange de carbonate de calcium et de terres rares, voisin de la synchysite-(Ce), voisin de la röntgénite-(Ce), et de phosphate de terres rares, voisin de la rhabdophane-(Ce).
Plusieurs résultats d'analyses MEB ont permis d'identifier des carbonates de calcium et des terres rares, adjacents à la formule synchysite-(Ce), la röntgénite-(Ce), ainsi qu'un phosphate de terres rares, voisin de formule rhabdophane-(Ce). Tous se présentent ici plus ou moins mélangés, avec la même morphologie, peut-être en raison de phénomènes de lixiviation ou d'altération. "

INSTALLATION ET ENVIRONNEMENT
Un document intéressant...
NOUVEAUX MOYENS DE PRODUCTION DE L'ANTIMOINE EN FRANCE - 1916