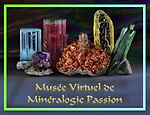LA CURIEUSE ALCHIMIE NATURELLE DE L'OR EXPLIQUÉE A TRAVERS L'EXEMPLE DES GISEMENTS DU SUD ARMORICAIN

Un dossier rédigé par
Monsieur Yves LULZAC
ancien ingénieur géologue minier du BRGM
OR...
Illustration et mise en page
JJ Chevallier
1-Origine de l'or.
L'or, ainsi que tous les autres métaux constituant l'écorce terrestre, est disséminé dans les roches ainsi que dans les mers et océans. Ceci, bien sûr en très faibles proportions mais à des degrés plus ou moins importants suivant la nature de son hôte. Ces proportions, ou teneurs, se chiffrent en "ppb"(1) c'est-à-dire en milligrammes d'or par tonne de roches ou d'eau. C'est ainsi que la teneur moyenne en or des sols et de la partie supérieure de la lithosphère est de 5 ppb. Les chiffres peuvent atteindre en moyenne 10 ppb pour les granites, 4 ppb pour les roches ultra basiques, 7 ppb pour les basaltes et gabbros, 5 ppb pour les diorites, 3 ppb pour les calcaires et schistes argileux, 0,12 ppb pour l'eau de mer et 0,3 ppb pour l'eau douce.
Bien entendu, l'extraction de l'or dans les mers, le gisement qui serait le plus vaste et le plus facile à exploiter, est impossible dans les conditions économiques actuelles. Il vaut mieux rechercher des concentrations beaucoup plus importantes même si les conditions d'exploitation sont plus difficiles et même si le potentiel récupérable est beaucoup plus réduit.
Dans la nature, ces concentrations existent, aussi bien dans les roches dures que dans les alluvions des cours d'eau. On en connaît un certain nombre dans le Massif Armoricain, certaines ayant été exploitées avec profit.
Mis à part les dépôts de type alluvial bien connus des orpailleurs, ces concentrations en "roches dures" se manifestent principalement sous forme de filons quartzeux ou sous forme d'amas sulfurés.
11-LES FILONS
Les filons, en se rappelant qu'un filon métallifère emprunte toujours une fracture de l'écorce terrestre qui lui sert de guide. Fracture plus ou moins longue, simple ou ramifiée, ayant une direction précise et plongeant dans le sous-sol suivant un angle plus ou moins accentué (le pendage). A l'affleurement, sur la surface topographique actuelle, un filon dont l'épaisseur (ou puissance) peut varier de quelques centimètres à plusieurs mètres, peut se suivre sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres, voire beaucoup plus, pour enfin se ramifier en de multiples filonnets ou pour laisser place à une simple fissure laquelle, le plus souvent, sera stérile. En profondeur (ou en aval pendage), un filon peut disparaître de la même manière mais, très souvent, on reste dans l'ignorance de sa fin car les recherches profondes, très onéreuses, sont toujours tributaires de l'appauvrissement du filon en matière première économiquement récupérable.
Les structures filoniennes aurifères peuvent se rencontrer dans un contexte pétrographique quelconque, généralement granitique ou métamorphique. Leurs bordures (ou épontes), présentent parfois une zone d'altération plus ou moins prononcée se traduisant par la présence d'une grande proportion d'argile. Dans d'autres cas, l'altération des roches encaissantes est nulle ou peut se manifester par une certaine silicification de la roche.
Dans le Massif Armoricain, le remplissage des filons aurifères est généralement constitué de quartz et de minéraux sulfurés, dont la pyrite et le mispickel (ou arsénopyrite). L'or peut alors s'y exprimer sous forme de micro-veinules mal cristallisées disséminées dans le quartz lui-même. Il y est généralement peu abondant. Cependant, il est beaucoup plus présent dans les sulfures, soit sous forme minéralogique mais extrêmement fine, soit sous forme ionique. Dans tous les cas, cet or restera toujours invisible à l'œil nu.

Cette partie du gîte, que l'on nomme protore(2), contient donc de l'or que l'on pourra qualifier de "primaire".
Toujours dans le Massif Armoricain, la teneur en or des protores connus, déjà exploités ou non, est en moyenne d'une dizaine de grammes à la tonne de minerai tout-venant. Avec parfois, mais très localement, des zones enrichies de faible extension pouvant atteindre les 50 grammes à la tonne. Cet or représente le potentiel du gisement qui peut être exploitable sous certaines conditions : géométrie favorable et bonne tenue des terrains ; traitement du minerai ne posant pas de problèmes particuliers et permettant d'obtenir un bon coefficient de récupération ; conjoncture économique favorable compte tenu des teneurs et des tonnages espérés, et aussi de la méthode d'exploitation (en carrière à ciel ouvert ou en souterrain).
En France, toutes les zones filoniennes affleurantes sur la surface topographique à partir de la fin de l'ère tertiaire, ont été le siège de phénomènes d'oxydo-réduction s'étendant jusqu'au niveau de battement de la nappe phréatique (en général entre 10 et 20 mètres de profondeur). Phénomènes à l'origine de concentrations minéralogiques d'or natif (phénomène de pépitisation). Mais, dans l'état actuel des connaissances acquises à l'issue des recherches minières de la fin du vingtième siècle dans le Massif Armoricain, de tels niveaux enrichis ne sont plus observables de nos jours car ayant été exploitées dans l'Antiquité (travaux gallo-romains ou antérieurs). Les seuls témoins de ces anciennes mines apparaissent encore parfois sous forme de mares ou d'excavations plus ou moins remblayées qui peuvent s'aligner sur plusieurs kilomètres (par exemple la "ligne des Miaules" du district de Château Gontier en Mayenne, ou la ligne des "Aurières" de la région de la Poëze-Angrie dans le Maine-et-Loire). Quelques rares autres témoins peuvent aussi se manifester à la faveur de découvertes fortuites de "pépites" d'or natif oubliées ou égarées par les anciens mineurs…
Pour ce qui concerne les exploitations modernes d'or du Massif Armoricain on peut citer :
- La mine de la Bellière sur la commune de Saint-Pierre-Montlimart dans le Maine-et-Loire qui a fourni 10,4 tonnes d'or à teneur moyenne de 9 g/t. Son activité a cessé en 1952.
- La mine de La Lucette sur la commune du Genest en Mayenne qui a fonctionné de 1905 à 1939. En plus de 42.000 tonnes d'antimoine, elle a fourni 8,35 tonnes d'or à teneur moyenne de 10 g/t.
- La mine du Semnon sur la commune de Martigné-Ferchaud en Ille-et-Vilaine qui à fourni environ 500 tonnes d'antimoine et, probablement, quelques kilogrammes d'or.
Un autre gîte aurifère a été découvert récemment mais il n'a pas été exploité. Il s'agit du gîte de Lopérec dans le département du Finistère dont les réserves sont estimées à 3,9 tonnes d'or à teneur moyenne de 7,8 g/t. Il ne s'agit pas, à proprement parlé, d'un gîte filonien quartzeux, mais plutôt d'une imprégnation de sulfures aurifères au sein d'une zone de cisaillement affectant des sédiments paléozoïques riche en matière organique. Ce gîte qui ne semble pas avoir été découvert ni exploité dans l'Antiquité, ne porte pas l'empreinte d'une altération superficielle classique génératrice d'une pépitisation secondaire de l'or. La cause est probablement à rechercher dans le proche environnement fortement réducteur du gîte primaire.

12-LES AMAS SULFURÉS
Les amas sulfurés sous forme de colonnes ou de corps massifs généralement de géométrie elliptique encaissés dans des séries sédimentaires ou volcano-sédmentaires. Actuellement, ce type aurifère n'est connu dans le Massif Armoricain qu'à un seul exemplaire : le gisement de Rouez-en-Champagne dans la Sarthe, dont la partie oxydée, ignorée des Anciens si ce n'est pour ses teneurs importantes en fer, a été récemment exploitée.
Encaissé dans des schistes noirs datés du Briovérien, ce gisement est principalement constitué de pyrite et pyrrhotine auro-argentifères avec chalcopyrite, galène et blende (sphalérite) subordonnées. L'or y est exprimé sous forme de microparticules invisibles à l'œil nu et la teneur du protore non oxydé est d'environ 1 gramme d'or à la tonne de tout-venant, tandis que la zone soumise à des phénomènes d'oxydo-réduction à montré une teneur voisine de 8,5 grammes à la tonne en moyenne avec des zones enrichies, mais très locales, à 77 grammes à la tonne. Au total, de 1989 à 1995, la production d'or a été de 2,6 tonnes, et celle d'argent de 9,1 tonnes.
Un second gîte pouvant se rattacher à ce type est connu dans le Massif Armoricain. Découvert récemment, il n'a pas été exploité. Il s'agit du gîte de la Haie Claire dans la région de Saint-Georges-sur-Loire (département du Maine-et-Loire), avec un tonnage d'or estimé à 1,2 tonne à teneur voisine de 2 g/t.

2-LE Phénomène DE PEPITISATION de l'or.
21-CAS des filons quartzeux SULFURÉS
Comme entrevu plus haut, l'or peut s'exprimer minéralogiquement dans le protore sous forme de fines particules sans formes cristallines nettes.
A l'approche de la surface topographique, une formation filonienne de ce type s'oxyde intensément sous l'effet des eaux météoriques qui vont percoler jusqu'à la nappe phréatique dont le niveau variera au rythme des saisons. Ces eaux météoriques, très chargées en oxygène, vont réagir sur les sulfures, la pyrite principalement, pour former du sulfate ferreux ainsi que de l'acide sulfurique.
Le sulfate ferreux, qui est très réducteur mais peu stable, va ensuite subir l'action de l'acide sulfurique néoformé et d'un nouvel apport d'oxygène pour donner du sulfate ferrique et de l'eau.
A son tour, le sulfate ferrique, au contact d'un excès d'eau, va s'hydrolyser et produire à nouveau de l'acide sulfurique et de l'hydroxyde de fer exprimé minéralogiquement sous forme de "limonite", variété amorphe de goethite. Cette concentration de "limonite" constituera ce que l'on appelle un « chapeau de fer ».
Ces réactions chimiques s'écrivent de la manière suivante :

Pour ce qui concerne le mispickel, le fer libéré contribue à la formation de limonite tandis que l'arsenic peut migrer sous forme d'arsénolite As2O3 ou rester bloqué dans la limonite sous forme d'arséniates, principalement la scorodite Fe3+AsO4.2H2O.
Au cours de ce processus d'oxydation, l'or camouflé dans les sulfures est libéré, soit sous forme minéralogique ou colloïdale, soit sous forme de véritable solution. Une partie de cet or pourra migrer hors de la caisse filonienne pour se retrouver dans les sols ou les eaux de ruissellement et finalement terminer son périple dans un dépôt alluvionnaire de fond de vallon. S'il rencontre un milieu réducteur, il pourra y floculer et se fixer sur des particules quartzeuses ou argileuses électro-négatives, l'or étant lui-même électro-positif.
Des pépites de type alluvionnaire vont donc se former lesquelles, si elles subissent un transport suffisamment important, prendront la forme de "paillettes" si elles sont de petite taille, ou de masses à contours arrondis si leur taille est plus importante. Ce seront les vraies pépites bien connues des orpailleurs du monde entier.
L'on sait également que dans un milieu fortement réducteur, par exemple composé de matières carbonées ou de végétaux en voie de décomposition, l'or pourra précipiter et former une mince pellicule sur les surfaces réductrices. C'est ce que l'on remarque parfois en climat tropical où les phénomènes d'oxydoréduction sont très agressifs. Dans tous les cas, cet or sera fortement appauvri en métaux alliés, argent ou cuivre.
On fera remarquer que l'oxydation des sulfures peut également se produire en dehors d'une caisse filonienne et en un temps relativement court. En effet, ce processus peut très bien s'exercer sur d'anciens terrils (ou haldes) abandonnés sur un carreau minier et soumis aux intempéries. Ici aussi, les sulfures, pour peu qu'ils soient aurifères, vont s'altérer en libérant l'or qu'ils contiennent. Cet or, très dispersé dans un milieu hétérogène, s'exprimera sous forme de multiples petites aiguilles ou de cristaux plus ou moins cubiques ou dendritiques. Ce phénomène s'observe particulièrement bien dans certains déblais de mines antiques, romaines par exemple. D'où une légende voulant que l'or à la propriété de se régénérer. Malheureusement, la proportion d'or libéré est généralement très faible et ne permet pas d'en envisager l'exploitation à l'heure actuelle. C'est par exemple ce qui avait été tenté récemment sur les rejets des anciennes mines d'or romaines de la région de Chaves dans le nord du Portugal.

Si l'or libéré reste piégé dans sa caisse filonienne, il commencera sa cristallisation en présence du sulfate ferreux réducteur et aura tendance à se regrouper à la base de la zone d'oxydation, dans une zone plus réductrice privée d'oxygène que l'on appelle zone de cémentation(3). Il pourra s'y fixer sur un élément électro-négatif et, si l'espace dont il dispose se révèle suffisamment grand (un espace précédemment occupé par de la pyrite par exemple), il pourra former un amas plus ou moins caverneux et cristallisé dont la géométrie, souvent très complexe, épousera les contours des cavités ouvertes dans le quartz ou même dans les épontes(4) argileuses, au contact de la roche encaissante. Ces amas de tailles variées dont le poids peut atteindre plusieurs dizaines de grammes, voire beaucoup plus dans certains cas, sont donc constitués d'or de formation secondaire. On pourra les qualifier d'or pépitique secondaire.
Si l'action de l'érosion superficielle parvient à démanteler et à déplacer cette zone filonienne à or secondaire, tout d'abord dans l'horizon éluvial de pente, puis finalement dans les alluvions de fond de vallon, cet or, désolidarisé d'une grande partie de sa gangue quartzeuse ou argileuse, subira des déformations et abrasions au fur et à mesure de sa progression dans ce milieu mouvant. Son aspect extérieur se modifiera donc au point de prendre un aspect de véritable pépite alluvionnaire difficile à distinguer des premières, si ce n'est au moyen d'analyses chimiques qui indiqueront la présence ou non de métaux annexes tels que l'argent et le cuivre.
Dans tous les cas, il faut admettre que le bilan aurifère d'une zone filonienne soumise à des phénomènes d'oxydo-réduction, ne pourra jamais surpasser le potentiel aurifère initial du protore non oxydé. S'il y a augmentation locale des teneurs en or, il n'y a pas augmentation du poids en or disponible dans le corps filonien originel. Cependant, la récupération du métal y sera beaucoup plus aisée car ne nécessitant qu'un abattage plus ou moins sélectif, suivi d'un éventuel débourbage et d'un simple traitement gravimétrique. C'est bien pour cela que les Anciens se sont uniquement intéressés à l'exploitation des zones filoniennes altérées et superficielles, leur activité se terminant dès l'apparition des sulfures dont ils ignoraient le traitement.


22-CAS des AMAS SULFURÉS MASSIFS
Ils sont à l'origine d'importants "chapeaux de fer" qui, très souvent, ont fait l'objet d'exploitations uniquement centrée sur la production de fer bien que ce minerai ne soit pas toujours d'excellente qualité.
Comme évoqué plus haut, le seul exemple connu d'amas sulfuré aurifère dans le Massif Armoricain est le gisement de Rouez. Si le protore non oxydé n'a été reconnu qu'au moyen de sondages carottés, il n'en est pas de même pour la zone oxydée et cémentée qui à été exploitée pour son or et son argent et dont on a pu étudier son architecture et son mode de formation.
C'est ainsi que ce gisement comporte 5 horizons successifs :
- De 0 à -10 m. Horizon oxydé rouge très riche en limonite ("chapeau de fer") et silice résiduelle. C'est le lieu de percolation des eaux météoriques chargées en oxygène.
- De -10 à -18 m. Zone de battement de la nappe phréatique. L'enrichissement en or et argent commence à se manifester dans la moitié inférieure de cet horizon.
- De -18 à -20 m. Premier horizon de cémentation où se manifeste l'enrichissement maximum en or (jusqu'à 77 g/t), argent (jusqu'à 1.600 g/t) et accessoirement plomb (jusqu'à 11%), contrairement au zinc qui est complètement lessivé
- De -20 à -30 m. Horizon cémenté de couleur noire, enrichi en cuivre (de 2 à 4,5%) mais dans lequel on note des concentrations dégressives en or et argent.
- De -30 à -35 m. Horizon de passage progressif au protore.
Ici, l'or secondaire présente bien son maximum de concentration dans le premier horizon de cémentation mais, contrairement à ce qui se passe dans le cas des filons quartzeux, il ne s'exprime jamais sous forme d'amas volumineux. Il se présente toujours sous forme de fines particules, la plupart du temps invisibles ou difficilement discernables à l'œil nu car n'ayant jamais rencontré de cavités suffisamment grandes pour s'y développer sans contraintes. C'est pour cela que ce type de gisement a pu échapper à l'œil, pourtant pointu, des anciens prospecteurs d'or.
3-LES ALLUVIONS ARMORICAINES.
En général, la signature alluvionnaire des gîtes aurifères "en place", est toujours très nette, qu'il s'agisse de gîtes exploités dans l'Antiquité ou à l'époque moderne. On constate une dispersion d'or plus ou moins micro-pépitique dans les cours d'eau qui se situent en aval des travaux miniers, sans que l'on puisse faire toujours la distinction entre l'or de néoformation issu d'or dissout ou colloïdal, et l'or détritique provenant de l'horizon éluvionnaire situé en aval du gîte primaire en roche (ou "en place"). Cependant, dans le second cas, l'or sera souvent associé à des fragments plus ou moins anguleux de quartz pouvant montrer de légères traces d'usure ou un certain émoussé acquis au cours de son trajet dans le milieu alluvionnaire. En général, dans le réseau hydrographique armoricain, les degrés d'usure sont faibles. Cependant, il peut être important en contexte marin, non seulement dans les alluvions marines actuelles, mais surtout dans les alluvions marines d'âge pliocène dont il subsiste encore d'épais placages sur quelques versants ou sommets de collines.
Un point particulier, qui n'est d'ailleurs pas encore totalement élucidé, réside dans l'omniprésence d'or alluvionnaire sur toutes les surfaces briovériennes armoricaines, en particuliers sur celles qui affleurent dans le centre Bretagne, dans les régions de Pontivy et de Loudéac par exemple. Cet or est présent dans la totalité du réseau hydrographique et peut être facilement récupéré au moyen d'une simple batée. Mais, bien sûr, pas en grosses quantités, car les teneurs enregistrées dans certains dépôts alluviaux de la région de Cléguérec, apparemment les plus riches, sont en général de l'ordre de 0,10 grammes d'or au mètre cubes de sables et graviers. Néanmoins, certains orpailleurs ont pu, dans les années 60, récupérer quelques dizaines de kilogrammes d'or dans les exploitations de sable qui étaient en activité à l'époque sur les alluvions du Blavet. Le matériel mis en œuvre étant simplement constitué de tables à rifles garnies de moquette.
Dans les petits cours d'eau, cet or "briovérien" se présente toujours sous la forme de petites pépites millimétriques mais pouvant parfois atteindre le centimètre ou très rarement plus.
Ces pépites ont des formes quelconques, souvent caverneuses et peuvent englober des grains de quartz plus ou moins émoussés. Dans les grands cours d'eau, l'Oust et le Blavet par exemple, la plupart des grains d'or prennent alors un faciès typiquement alluvionnaire en "paillettes".
L'origine de cet or pose un problème car jusqu'à présent et malgré quelques recherches effectuées dans ce sens dans les années 70, il n'a jamais été découvert de gîtes pouvant justifier une si importante dispersion d'or sur des kilomètres carrés d'affleurement briovérien. Mis à part quelques rares filonnets quartzeux montrant des traces d'or natif découverts sur affleurement ou sous forme de "pierres volantes".
Un hypothèse voudrait que l'or contenu à l'origine dans les sédiments briovériens, en teneurs de base de l'ordre de 3 ppb, ait été remobilisé sous l'effet des profondes altérations climatiques enregistrées à l'Eocène en climat tropical, altération que l'on peut encore constater sur des épaisseurs de plusieurs dizaines de mètres. Dans le cas présent, cette altération s'est exercée sur des roches schisteuses noires, plus ou moins chargées en matière carbonée et donc réductrices. Milieu favorable à la cristallisation de l'or, mais celui-ci étant à l'origine finement divisé et ne disposant pas de grosses cavités pour s'y déposer, il n'y forme jamais de gros amas. L'érosion récente (fluviatile ou périglaciaire) exercée sur ces roches altérées aurait donc définitivement libéré cet or pour le concentrer dans le réseau hydrographique actuel.

en guise de conclusion
Finalement, on s'aperçoit que l'or n'est pas un métal aussi rare qu'on pourrait l'imaginer. Nombreux sont les petits cours d'eau du Massif Armoricain qui, à la base de leur "lit vif" peuvent encore livrer des "couleurs" d'or. "Couleurs" que l'on retrouve facilement au fond d'une batée ou d'un pan américain mais qui, mis à part le plaisir quelles peuvent apporter au moment de leur découverte, ne peuvent prétendre à la moindre rentabilité. Cependant, il a existé de fortes concentrations d'or libre superficiel dans certaines formations filoniennes quartzeuses et il est certain que ceux qui les ont découvertes autrefois ont dû se réjouir devant un tel spectacle qui pourtant, et sans qu'ils s'en doutent, contribuait à faire de la Gaule, la "Gallia Aurifera" tant convoitée des légions romaines.
En France, tous ces anciens mineurs ne nous ont gardé aucun exemple intact de ce qu'ils ont pu découvrir au cours de leurs prospections, nous laissant le soin d'exploiter à grands frais les parties profondes des filons qu'ils dédaignaient.
Heureusement, il était, et est encore possible de par le monde, de recréer l'ambiance qui devait régner à l'occasion des grandes découvertes de l'Antiquité. Il suffit de se remémorer les grandes aventures du Klondyke et de la Californie sur le continent américain lequel, à l'époque, était resté quasiment vierge de toute exploitation minière. Sans oublier également l'Australie et certains pays africains qui, encore de nos jours, ne sont pas avares de gîtes aurifères intacts, ni de grosses "pépites"…
Cliquez sur la carte pour agrandir.
adenda
De nombreux historiens de la recherche minière ont tenté d'évaluer la production antique de l'or en France. Chose difficile car, en général, on connaît mal le volume ou le tonnage du minerai traité, la proportion d'or dans ce minerai, ainsi que le pourcentage de récupération du métal à l'issue des opérations de lavage et de raffinage.
Les mêmes interrogations se posent dans le cas du Massif Armoricain, en particulier pour ce qui concerne le tonnage du minerai extrait. En effet, les traces d'exploitations encore visibles sur le terrain ne sont que très partielles et souvent mal délimitées. Depuis au moins 2000 ans, les carrières ont pu être complètement remblayées pour les besoins de l'agriculture, ne laissant parfois que de vagues ondulations de terrain d'interprétation peu aisée. Avec un peu de chance, un microtoponyme en "Aurière" ou en "Miaule" aura franchi les siècles pour nous indiquer un lieu d'extraction de métal sans préjuger de la taille ni de l'importance des travaux effectués. Dans d'autres cas, si la carrière n'a pas été remblayée par l'homme, la nature s'en est plus ou moins chargée en érodant les déblais miniers (les "cavaliers") bordant la zone excavée. Bien sûr, on ignore l'épaisseur de ce remblayage en l'absence de travaux de terrassement toujours malaisés à conduire au fond d'une cavité qui, de plus, est souvent remplie d'eau.
Le district de Château Gontier n'échappe pas à ces règles bien que de rares tentatives de reconnaissance des niveaux d'exploitation les plus profonds aient été tentées par les équipes du B.R.G.M. dans les années 80. A l'issue de ces travaux, il semblerait que ces anciens mineurs ne soient guère descendus à plus d'une quinzaine de mètres de profondeur, niveau pouvant correspondre à l'apparition de minerai sulfuré ou à la zone de battement de la nappe phréatique.
Une dizaine de mètres semblerait constituer une bonne moyenne de profondeur atteinte dans cette région.
Pour ce qui concerne les volumes de minerai extraits, il faut partir du principe que les Anciens travaillaient "à vue" d'une manière très sélective, ne récoltant que les structures filoniennes quartzeuses, de préférence avec or visible.
L'or en amas "pépitiques" était probablement mis de côté tandis que le tout-venant quartzeux était concassé et broyé, puis finalement traité par gravimétrie hydraulique (batée ou sluice). Quant aux roches encaissantes stériles, elles étaient remisées en surface, en bordure de l'excavation pour former ce que l'on appelle aujourd'hui des "cavaliers".
Toujours dans les années 80, des sondages carottés profonds ont été exécutés afin de reconnaître l'aval pendage et les prolongements éventuels des anciennes exploitations. Ces sondages, au nombre de 23 répartis sur 5 aurières encore bien visibles sur le terrain, ont permis d'avoir une première idée sur le nombre et la puissance des formations filoniennes exploitées, ainsi que sur leur teneur en métal. Tout en gardant à l'esprit que les zones recoupées constituent le protore des filons dont la teneur moyenne en or permettra d'en apprécier le potentiel aurifère. Potentiel que l'on reportera alors sur la partie oxydée du gîte exploité.
Les données fournies par ces sondages sont résumées ci-après, sachant que les teneurs moyennes exprimées en grammes par tonne (g/t) ont été pondérées par la puissance des filons interceptés ; que la profondeur des aurières à été arbitrairement fixée à 10 m, et que la densité du minerai extrait est de 2,6 :
1- Aurière de la Vieuville sur la commune de Livré-la-Touche. Longueur totale évaluée à 340 mètres reconnue par 8 sondages ayant intersecté 13 formations filoniennes de puissance moyenne égale à 3,81 m (min. 0,25 m, max. 7,74 m). Teneur moyenne = 3,06 g/t (min. 0,7 g/t, max. 12,38 g/t). D'où un potentiel de 103 kg d'or, soit 0,30 kg au mètre d'allongement.
2- Aurière de la Petite Perrine sur la commune d'Athée. Longueur totale évaluée à 750 mètres reconnue par 6 sondages ayant intercepté 7 formations filoniennes de puissance moyenne égale à 0,72 m (min. 0,30 m, max. 1 m). Teneur moyenne = 1,84 g/t (min. 0,68 g/t, max. 2,35 g/t). D'où un potentiel voisin de 26 kg d'or, soit 0,03 kg au mètre d'allongement.
3- Aurière des Fosses sur la commune de Saint Fort. Longueur totale évaluée à 400 mètres reconnue par 6 sondages ayant intercepté 7 formations filoniennes de puissance moyenne égale à 1,46 m (min. 1 m, max. 3,78 m). Teneur moyenne = 24,04 g/t (min. 0,5 g/t, max. 83,1 g/t). D'où un potentiel de 390 kg d'or, soit 0,97 kg au mètre d'allongement.
4- Aurière de la Derbourière sur la commune de Saint Fort. Longueur totale évaluée à 250 mètres reconnue par 1 sondage ayant intercepté 3 formations filoniennes de puissance totale égale à 1,50 m, et de puissance moyenne égale à 0,50 m (min. 0,40 m, max. 0,55 m). Teneur moyenne = 2,50 g/t (min. 1,25 g/t, max. 6 g/t). D'où un potentiel voisin de 24 kg d'or, soit environ 0,10 kg au mètre d'allongement.
5- Aurière du Coudreau sur la commune de Chemazé. Longueur totale évaluée à 200 mètres reconnue par 2 sondages ayant intercepté 4 formations filoniennes de puissance moyenne égale à 1,23 m (min. 0,56 m, max. 1,75 m). Teneur moyenne = 15,5 g/t (min. 3,30 g/t, max. 28 g/t). D'où un potentiel de 99 kg d'or, soit 0,49 kg au mètre d'allongement.
Ce qui, au total, représente un potentiel d'environ 642 kg d'or réparti sur 5 aurières dont la longueur cumulée serait d'environ 1.940 mètres.
Cependant, ce potentiel doit être corrigé en fonction des pertes d'or dissout ou colloïdal ayant migré hors des caisses filoniennes oxydées. Chiffre évidemment impossible à évaluer d'une manière précise mais que l'on pourrait fixer arbitrairement à 10%. Ce qui abaisse le potentiel récupérable à 578 kg. Ce dernier chiffre devant lui-même être corrigé pour tenir compte des pertes d'or au moment de l'exploitation (filonnets négligés car sans or visible, broyage insuffisant des quartz, perte de métal au lavage, etc). Correction difficile à apprécier mais que l'on pourrait aussi fixer arbitrairement à 10%. D'où un poids d'or récupéré égal à environ 520 kg.
Ces sondages, bien qu'en nombre très insuffisant compte tenu des grandes surfaces à explorer, montrent cependant que le potentiel métal peut varier dans de très fortes proportions d'un aurière à l'autre. Dans le cas présent, de 30 grammes à 970 grammes par mètre d'allongement filonien. Ce dernier chiffre, apparemment anormal, obtenu dans l'aurière des Fosses, étant dû à une forte accumulation de sulfures, et non à un "effet pépite" puisque l'or natif primaire est ici toujours finement divisé dans le protore.
On peut tenter d'élargir ce chiffre de production à l'ensemble du district de Château Gontier sur lequel il est possible de repérer 21 autres sites montrant des traces évidentes d'activité humaine du même genre et dont la longueur totale d'exploitation pourrait être de 5.900 mètres. La production supplémentaire d'or pourrait alors se monter à 1.581 kg.
D'où un total de 2.100kg ayant pu être extrait de ce district. Chiffre, répétons-le, tout-à-fait hypothétique compte tenu des trop nombreuses imprécisions dans l'évaluation des tonnages réellement sortis ainsi que des teneurs en or récupérable.
A fortiori, il serait très imprudent de vouloir majorer ce chiffre de production en prenant comme base de travail une exploitation continue de l'or sur toute l'étendue réelle de ce district, soit sur 40 km depuis Château Gontier jusqu'aux abords de la Guerche-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. En effet, les zones minéralisées en or, loin d'être continues, forment au contraire des îlots s'échelonnant de distance en distance et d'une manière irrégulière le long de cet axe tectonique.
Peut-on, également, appliquer ces chiffres de production à l'échelle régionale, en prenant en compte, par exemple, l'alignement des aurières qui s'étend sur 20 kilomètres à l'ouest de la Pouëze et d'Angrie dans le Maine-et-Loire. Ou bien, au-delà d'Angrie, l'alignement des aurières qui s'étend sur 17 kilomètres entre les bourgs du Pin et de Moisdon-la-Rivière en Loire Atlantique ?
Dans l'affirmative, il serait alors possible de doubler les chiffres obtenus sur le district de Château Gontier…
CARTE POSTALE DE MINE D'OR DE LA RÉGION OUEST...
Collection privée F. C.
BIBLIOGRAPHIE
-
E. Raguin. Géologie des gîtes minéraux. Masson et Cie. éd. Paris. 1961;
-
P. Routhier, E. Raguin et al. Métallogénie hypogène de l'or. Colloque M.P.M.G. - B.R.G.M. 1966;
-
J. Goñi, C. Guillemin, C. Sarcia. Géochimie de l'or exogène. Etude expérimentale de la formation des dispersions colloïdales d'or et de leur stabilité. Min. Deposita. Berlin, 1. 1967;
-
G. Machairas. Contribution à l'étude minéralogique et métallogénique de l'or. Bull. B.R.G.M., 2ème série, section 2, n°3. 1970. (Etude particulièrement bien documentée);
-
J. Guigues, G. Machairas. Les diverses minéralisations aurifères du Massif Armoricain en relation avec le volcanisme, la sédimentation et les orogénies. 24th. Int. Geol. Congr. Montreal, Sect 4, Mineral Deposits. 1972;
-
J.J. Bache. Les gisements d'or dans le monde. Mémoire B.R.G.M. n°118. 1982;