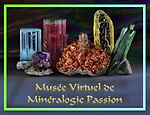BITUMES
AUVERGNATS
THERMALISME
et
INDUSTRIE

Entre l'Auvergne et la Mésopotamie existe un point commun, la présence de sources bitumineuses.
Fleurs de bitume d'Auvergne.
Photo Pierre Thomas,
Laboratoire de géologie, ENS Lyon.
En France l'utilisation de l'asphalte fut plus modeste, point d'arche de Noé à colmater, ni de tour de Babel à édifier. Le bitume d'Auvergne possède cependant une longue histoire.
Le bitume est une substance noire généralement très visqueuse ou solide à la température ordinaire, liquéfiable à chaud autour de 100°C. Le bitume est formé par un mélange d'hydrocarbures lourds, de résines et d'asphaltènes[*]. Insoluble dans l'eau, on l'utilisait pour calfater les bateaux qui naviguaient sur l'Allier et pour assurer l'étanchéité des murs.
Le bitume est le résultat de la transformation chimique de la matière organique contenue dans les sédiments originels de l’ancien lac de Limagne sous l’action de l’élévation de la température au fur et à mesure de l’enfouissement. Il remonte très lentement vers la surface en raison de sa faible densité, utilisant ici les fractures associées aux cheminées volcaniques. Arrivé en surface, il perd ses éléments les plus volatils devenant très visqueux, presque solide.
Le bitume est connu et utilisé en Limagne depuis l'Antiquité, des poteries brisées, déterrés à proximité du Puy de la Poix, ont été réparées par les Celtes avec cette colle naturelle.
[*] Note du transcripteur : Les asphaltènes et les résines sont les fractions lourdes des pétroles bruts, ce sont des composés qui contiennent C (carbone), H (hydrogène), S (soufre), O (oxygène) et N (azote) alors que les hydrocarbures ne contiennent que C et H.
(Texte, "Le sentier du bitume" (PDF), Club Minérlogique de Moulin sur Allier)
http://clubmineralogiquemoulins03.planet-allier.com/index.htm

Calcaire bitumineux, carrière de Cournon d'Auvergne,
Photo C Nicollet,
Université Clermont Auvergne de Clermont Ferrand.
Les deux textes historiques anciens, de cette page, proviennent de mes archives numériques, malheureusement je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur et je suis à sa recherche pour le citer, si vous reconnaissez ce texte et que vous en connaissez l'auteur, merci de m'envoyer un mail.
UN SITE GÉOLOGIQUE CÉLÈBRE
Observons, voulez-vous la carte du « Riche et Ancien Pays d'Auvergne », oeuvre du florentin Siméoni en 1560. Ce familier de la cour épiscopale de Guillaume Duprat, évêque de Clermont, a dessiné sur le précieux document une petite butte dans une boucle de rivière. Examinons de plus près cette bosse insignifiante. La voici, un peu au-dessous du nom de «Clermont». C'est la «collis bitumosus», à droite d'un monticule plus prononcé, Croelle. La «collis bitumosus» pour le vulgaire d'alors qui ne comprenait pas le beau langage, n'était autre que le puy de la Pège, notre puy de la Poix actuel. Le puy de la Poix, ignoré aujourd'hui de la plupart des Clermontois a été l'une des plus grandes curiosités naturelles non seulement de l'Auvergne mais de la France entière.
Sa réputation était comparable à celle des sources incrustantes de Saint-Alyre. Tous les visiteurs de marque venaient faire un pèlerinage à ces deux merveilles de la nature, bien avant la découverte du volcanisme dans notre région.
La réputation du puy de la Poix est fort ancienne, les hommes préhistoriques attirés sans doute par cette eau noire et salée s'installent aux abords immédiats de la colline asphaltique. Un menhir, maintenant détruit, rappelait leur souvenir; les trésors, vases et poteries datant de plusieurs siècles avant JC. se retrouvent çà et là dans les terres labourées. D'importants chantiers de fouilles viennent chaque année confirmer l'intérêt grandissant de ce site archéologique de grande classe.
Si l'histoire reste, en somme, fort discrète sur notre colline clermontoise, quelques documents sont tout de même parvenus jusqu'à nous.


Carte de la Limagne d'Auvergne,
de Gabriello Siméoni, du
« Riche et Ancien Pays d'Auvergne »,
1560.
UN SPECIALISTE DU THERMALISME A CLERMONT EN 1605
C'est en effet en 1605 que Jean Banc écrit un ouvrage précurseur des traités actuels du thermalisme, au titre évocateur :
« La Mémoire renouvelée des merveilles des eaux naturelles en faveur de nos nymphes françaises. »
Après avoir passé en revue les eaux de Saint-Myon, de Clermont, du Mont-Dore et de bien d'autres émergences, il parle en ces termes du « puy de la Poix » :
« Suivons cette Limagne et allons trouver la fontaine qui fait la poix au voisinage d'un demi-quart de lieue de Montferrand, presque sur le chemin de Pont-du-Château, il y a deux sources, l'une plus grande que l'autre, l'eau est aigrelette et tiède. Élles sont situées sur le penchant de la colline. Au-dessus de la plus grande nage le bitume et poix noirâtre extrêmement puante, qui se décharge peu à peu au-dehors de ladite fontaine, si adhérent et si gluant qu'il est fort difficile de le faire jamais du tout démordre du lieu où il a été appliqué. »
Jean Banc nous assure encore que par les hivers les plus froids, les oiseaux qui viennent boire à la fontaine de poix, qui ne gèle jamais, s'y prennent comme à des gluaux.
Mais cet auteur n'est pas le premier à s'occuper de cette source à la fois si curieuse et si originale. Quelques années plus tôt, Belleforest, dans sa Cosmographie universelle datant de 1575, parle également d'une colline ou montagnette où le bitume coule ainsi qu'une source de fontaine, lequel est noir au possible, tenant et gluant. Én bon observateur, il note une plus grande abondance de la poix au cours de l'été, la froidure de l'hiver empêchant, nous dit-il, la liqueur de se dissoudre et de se distiller.
Ce bitume qui s'écoule, en dehors de son objet de curiosité, avait bien, on s'en doute, quelque utilité. Les érudits auvergnats restent assez discrets à ce point de vue. On s'en sert pour marquer les brebis, et sans doute pour la confection de médicaments, comme en Alsace. Le bitume a d'ailleurs été d'un usage courant au Moyen Âge; en Bavière, au xve siècle, le duc de Ferrare parle d'une huile qu'il nomme pétroléon, et il vante ses grandes vertus; le pétrole alsacien était utilisé pour les cataplasmes et les pommades. Il est bien certain que les apothicaires clermontois ont su eux aussi employer à bon escient le bitume du puy de la Poix; leurs recettes hélas ne sont pas parvenues jusqu'à nous.
Reprenons le cours de l'histoire. En 1718, un chanoine de la cathédrale, sans doute naturaliste à ses heures, s'aperçoit de l'attrait tout particulier exercé par l'eau salée et bitumineuse sur les pigeons d'alentour qui recherchent avec avidité l'eau de cette fontaine; beau sujet de recherches médicales pour un esprit curieux.
Dans son traité des eaux minérales, bains et douches de Vichy, Chomel ne dédaigne pas de consacrer quelques lignes à la source asphaltique; il assure même que Tournefort, illustre chimiste de l'époque (1734), en a retiré une huile analogue à celle de pétrole. Du pétrole en Auvergne, dès 1734, avouons que nous en ressentons quelque fierté. Hélas, l'or noir de la Limagne reste encore à découvrir.
Le Monnier, un des pères de la géologie française, à peu près vers la même époque, a visité également la source visqueuse et noirâtre; comme à son habitude il en fait une étude sérieuse et méthodique. L'eau qu'il goûte possède une amertume insupportable; elle est recouverte d'une mince couche de bitume, ressemblant à de la poix. Dans les fentes d'une colline voisine, il recueille une demi-livre d'une substance sombre, sèche, dure, qui s'enflamme facilement, en dégageant malheureusement une fumée noire et épaisse et une odeur désagréable. Décidément, l'asphalte clermontois ne fera pas un bon combustible. Le Monnier ajoute cependant : « Je suis persuadé que par distillation on en retirerait du pétrole.»
L'intérêt pour le puy de la Poix ne faiblit pas. Bien au contraire, confusément sans doute, on sent qu'il faudrait en tirer parti. Un naturaliste auvergnat, l'abbé Delarbre, entreprend de mesurer l'écoulement du bitume (1749). Durant huit jours du mois de juillet la quantité d'asphalte recueilli a été de six livres, en août il y a eu légère progression, car on a pu en prélever huit livres. C'est un peu maigre, bien sûr, pour une exploitation; ce serait pourtant une heureuse idée, le bitume alsacien n'entre-t-il pas dans la confection d'un nouveau ciment employé dans les bassins du jardin de Versailles et du jardin des plantes de Paris ?
Guettard, le grand Guettard qui découvrit le volcanisme auvergnat, s'intéressa aussi aux buttes de Limagne. Très astucieusement, il remarque la position géologique « des pierres bitumineuses », dont les collines sont disposées suivant un même alignement. Il existe du bitume, non seulement à la montagne de la Poix, mais à Crouel, et dans la cave des bénédictins. A Machaul, sur la route de Clermont à Riom, la source de poix intéresse les paysans qui s'en servent pour graisser les essieux de voitures. L'asphalte de Pont-du-Château attire l'attention du savant géologue, il lui semble apercevoir des taches révélatrices sur le roc même où repose l'écluse dans le cours de l'Allier.
Adressons-nous à Buffon pour connaître les idées qui régnaient alors sur l'origine des bitumes, pétroles et naphtes. Ce sont, nous dit le célèbre naturaliste, des produits de la distillation par les feux souterrains des charbons de terre et schistes bitumineux. Il envisage, non l'action de la chaleur interne du globe, mais la présence de véritables feux « qui liquéfient le bitume, le distillent et font élever les parties les plus ténues pour former le naphte et le pétrole ».
Tout cela semble puéril aux géologues actuels ; ajoutons cependant que les découvertes récentes montrent qu'une élévation de température est nécessaire pour la naissance des hydrocarbures au sein des couches sédimentaires.

VERS L'UTILISATION INDUSTRIELLE DES ASPHALTES D'AUVERGNE
C'est aux alentours de la Révolution française que se pose le problème des bitumes auvergnats. Legrand-d'Aussy nous apprend que les Auvergnats en sont embarrassés. En gens qui ne veulent rien laisser perdre, ils souhaitent faire quelque chose, mais quoi ? L'un d'eux, l'histoire a oublié son nom, se met à exploiter le puy de la Poix pour fabriquer des moellons, le bitume servant de ciment naturel. Hélas, il faut très vite déchanter, la construction répand une telle odeur qu'elle devient inhabitable. Il y a bien les essieux de voiture, mais la consommation est minime; puis, là encore, c'est une faillite complète, la poix sèche trop rapidement. Alors, que faire en dehors du marquage des moutons ?
Un habitant de Pont-du-Château a un trait de génie. Si le bitume sèche trop vite, malaxons-le et mélangeons à de la graisse pour en faire un onguent qui se vend avec succès. Le citoyen de Pont-du-Château renouait sans le savoir avec une longue tradition. Les Babyloniens se frottaient le corps, il y a plus de deux mille ans, avec un mélange de bitume, d'huile et de suc de végétaux, et les Egyptiens, au temps des Pharaons, fabriquaient des onguents à base de cire et de bitume.
Revenons à l'Auvergne pour conter la mésaventure survenue aux bénédictins de Saint-Alyre, possesseurs d'une source ou plutôt d'un gisement d'asphalte. Ils en sont vraiment embarrassés. Que faire de la butte rocheuse qui s'élève maintenant près du mur de clôture, au niveau du boulevard Lavoisier ? Rien, sinon y creuser une cave. Le rocher n'est pas humide, tout se présente(bien, le tuf volcanique n'est pas trop dur, la cave se termine, on dispose les fûts; l'expérience tourne au désastre, l'odeur de poix et de soufre est d'une telle force que le vin s'altère très vite. Tout n'est pas perdu cependant, car le représentant d'une compagnie industrielle arrive à Clermont attiré par la réputation de l'asphalte, employé de plus en plus pour rendre les bassins imperméables et pour fabriquer les trottoirs. Il est sans complexe, comme nous dirions aujourd'hui, et sollicite du conseil municipal de Clermont l'autorisation d'exploiter le puy de la Poix dans son entier. Cette demande parut insolite; exploiter le puy de la Poix, ce lieu célèbre de l'Auvergne, cela dut sembler un véritable sacrilège à nos édiles municipaux.
Les hésitations du conseil municipal firent traîner les délibérations. La réponse tardant à venir, l'industriel parisien, qui ne trouvait pas beaucoup de distractions à Clermont, finit par quitter l'Auvergne. Le puy de la Poix venait de justesse d'être sauvé de la destruction totale, car il s'agissait bel et bien de sa disparition par une opération technique d'un style très particulier que nous pourrions sans ironie qualifier d'opération « œuf à la coque ». Il s'agissait ni plus ni moins que d'enlever le sommet du puy de la Poix comme on découpe l'extrémité d'un œuf, et théoriquement on devait découvrir un bitume liquide mijotant dans cette chaudière naturelle, alimentée par les feux volcaniques.
C'est, en somme, guidée par les théories de Buffon que s'effectuait alors la prospection en Limagne, l'asphalte étant considéré comme une production liée à la chaleur des volcans.
De toute façon, le progrès dans la construction des rues et des trottoirs aidant, le bitume devient de plus en plus un produit industriel. Dès 1831 le département du Puy-de-Dôme possède un directeur des exploitations d'asphalte en la personne de M. Ledru, concessionnaire des mines de Pont-du-Château, de Lussat et de Dallet ; la production du puy de la Poix lui est également réservée.
Il n'est pas le seul à vouloir s'enrichir du sous-sol d'Auvergne, le baron de Barante, personnage très influent, se voit attribuer par l'ordonnance du 25 septembre 1843, les mines de Malintrat, Gerzat et Pont-du-Château. La partie ouest de ce dernier territoire particulièrement riche devient concession des frères Michel et François Bresson, tandis que le comte Maurice de Laizer prend possession du gisement des Roys dans les communes de Lempdes et Dallet.
Dans toutes ces tractations le puy de la Poix est un peu oublié. Le docteur Nivet (1845) envisage pourtant des bains avec son eau minérale pour traiter les maladies de la peau, gale, dartre, en particulier. Nivet rejoint ainsi une longue tradition, celle des Chaldéens qui guérissaient les dermatoses par l'action des eaux bitumineuses. Sarah, épouse d'Abraham, n'a-t-elle pas été guérie par cette thérapeutique ? Regrettons cependant qu'aucune étude sérieuse n'ait vu le jour sur la source de poix, peut-être n'est-il pas trop tard pour reprendre l'idée du docteur Nivet.
Les visiteurs du centre de la France se dirigent toujours vers la colline d'où suinte la poix. Lecoq (1867) tient à les mettre en garde contre certains dangers. " Qu'ils ne commettent pas l'imprudence surtout si fatigués par une longue marche, de s'asseoir sur le monticule, leurs vêtements n'y résisteraient pas. Attention aux chaussures, la poix colle si fortement qu'on risque de s'y engluer comme jadis les oiseaux."
LE BITUME D'AUVERGNE ET LA CONSTRUCTION DES ROUTES
Le problème routier qui préoccupe sérieusement gouvernement et ingénieurs des ponts et chaussées était aussi d'actualité au siècle dernier. La technique s'améliore d'année en année si l'on en juge par un ouvrage de 1838 préconisant un nouveau système de dallage et de trottoirs où l'asphalte d'Auvergne tient une large place. On ne se contente pas de théorie, l'expérience tient une large part; la route nationale 9, de Clermont à Perpignan, a été choisie comme terrain d'essai par Ledru ; un rapport a été présenté par l'ingénieur ordinaire, A. Monestier.
Les Auvergnats sont gens sérieux, le macadam bitumineux construit en janvier 1851 a été l'objet de soins attentifs. Peut-être n'est- il pas sans intérêt de rappeler la méthode employée par l'architecte clermontois précurseur des grands bâtisseurs d'autoroutes.
« Une couche de fragments de minerai calcaire a été étendue sur le sol, et chaque joint garni de petits fragments de grès bitumineux. Le pilonnage a serré ensemble ces matériaux. Une deuxième couche de fragments de calcaire, de plus petite dimension que les premières a été étendue, rejointoyée et pilonnée comme la première. Enfin tout le travail a été recouvert d'une couche de petits fragments de grès qui se sont étendus et soudés sous l'action du pilonnage. Le roulage a fait le reste sans que les pieds des chevaux aient rien dérangé. »
Le calcaire bitumineux employé provenait de la mine des Roys située à Dallet, le grès ou arkose asphaltique s'exploitait à Lussat. Sa présence donnait une certaine élasticité à la chaussée qui reprenait son aspect normal durant le repos nocturne.
M. Ledru a essayé de remplacer la couche inférieure de calcaire par des fragments de basalte; aucune différence ne s'est manifestée. L'entretien de la nouvelle chaussée a été nul, en dehors de quelques cailloux arrachés çà et là et introduits par la circulation, il n'y a eu pratiquement aucuns travaux de rechargement.
L'avenir est donc prometteur pour le macadam de Dallet et de Pont-du-Château, Ledru parle avec foi du procédé nouveau : « Il s'étendra dans les villes de province dont les rues sont souvent si mal pavées que la marche y est difficile et que le passage d'une voiture n'y est pas sans danger. Il contribuera à l'assainissement de ces nombreux quartiers dont le sol imprégné d'une humidité constante est un foyer permanent d'infection. » La ville de Lyon vient de donner l'exemple, l'espérance est au cœur du directeur des mines d'asphaltes, mais encore faudrait-il que les chaussées bitumineuses puissent se faire à des prix modérés.
Plus d'un siècle a passé depuis le mémoire présenté en 1852 à l'Académie des sciences arts et belles lettres de Clermont-Ferrand, plus d'un siècle qu'une technique de goudronnage des routes a été mise au point à Clermont sur la nationale 9. Si l'on avait écouté Ledru, que de progrès ne se seraient-ils pas réalisés, le problème si angoissant des routes de France serait résolu depuis longtemps.
L'asphalte d'Auvergne a bien d'autres emplois. A chaud il entre dans la fabrication des mastics bitumineux applicables aux dallages. Ces derniers jouissent vers 1850 d'un succès certain, leur réputation a dépassé la capitale de l'Auvergne. En 1841, le dallage du marché aux fleurs à Paris est exécuté en produits asphaltiques de Limagne. L'Administration, toujours soucieuse des deniers de l'État, a reconnu leurs qualités et les a inscrits dans le cahier des charges (1842) de la ville de Paris, « au même rang que les produits des meilleures provenances ».
L'industrie asphaltique continue à progresser avec cependant des vicissitudes, des concessions nouvelles sont accordées, d'autres périclitent; bientôt c'est autour de Pont-du-Château et de Dallet que se concentre l'extraction. Le gisement de l'Éscourchade, situé à Chamalières attire l'attention dès 1829, il en est de même de celui de Crouzol, près Volvic, mis au jour dans la propriété de Chabrol.
En 1848, la plupart des concessions sont réunies dans la Société des bitumes et asphaltes du Centre, qui continue aujourd'hui de traiter dans son usine de Pont-du-Château les pépérites [1] et calcaires asphaltiques des Roys près de Dallet.
LES MINÉRAUX SATELLITES DU BITUME
En dehors de la lussatite dont nous avons parlé dans un article précédent, toute une série minérale est liée à la présence du bitume en Limagne. La mine des Roy à Dallet, présente de la pyrite sans formes distinctes et des rhomboèdres de dolomie. Certains gisements y ajoutent des zéolites ; il faut bien le reconnaître, seule la pyrite est fréquente partout, aussi bien dans les pépérites qu'au milieu des grès bitumineux de Sainte-Marguerite.
Reprenons pour les amateurs de minéraux l'étude de R. Weil pour en donner les grandes lignes. Nous irons rechercher dans la tranchée de la voie de chemin de fer à Chamalières (près de la voie romaine), dans le granite altéré et imprégné de bitume, la pyrite et la copiaprite (sel de fer). A l'Éscorchade, mais retrouverons-nous les galeries ? Avec beaucoup de chance nous récolterons de petits cubes de pyrite.
Dans le groupe des zéolites c'est le mésotype qui prédomine; elle est connue depuis longtemps au puy de la Poix (A. Lacroix) en cristaux de très petite taille, de teinte jaune, à Dallet sous forme de sphérolites, elle cimente un tuf périphérique proche des venues bitumineuses.
C'est toujours le puy de la Poix qui retient la curiosité des minéralogistes car il s'y trouve des cristaux énigmatiques étudiés jadis par Gonnard (1887) sous le nom de giobertite, et d'ankérite par Lacroix dans la minéralogie de la France. Weil, à la loupe binoculaire, remarque les faces aux triangles isocèles ou équilatéraux, aux arêtes biseautées « à la manière de celles du diamant ». L'analyse chimique, hélas, ne permet pas le moindre espoir, les diamants du puy de la Poix sont tout simplement des cristaux de dolomite, avec cependant une densité un peu élevée.
Quelle serait l'origine des espèces minérales accompagnant les suintements bitumineux ? Diverses hypothèses sont possibles, la plus valable tient à la montée d'eaux possédant, comme au puy de la Poix, une très forte salinité. Les eaux ont facilité la transformation du pétrole en bitume (R. Weil). Ce phénomène s'est effectué dans les profondeurs de la Limagne grâce au flux de chaleur élevé provoqué par le magma responsable des éruptions pépéritiques.
LA CHIMIE DES BITUMES D'AUVERGNE
C'est à M. l'ingénieur Louis, de l'École nationale des pétroles, que l'on doit l'étude des bitumes de Limagne. A la température ordinaire le bitume est visqueux, car il se trouve à l'état colloïdal. Cet état disparaît à 70° et le bitume devient un véritable liquide.
Parmi les constituants chimiques, retenons une teneur en soufre élevée, 20 % de résine, 29,8 % d'asphaltènes; les constituants huileux, de beaucoup les plus abondants, sont de 49,1 %. Le poids moléculaire du bitume est de 780. Pour les spécialistes des hydrocarbures, le bitume de Pont-du-Château peut être considéré comme résultant de la polymérisation peu prononcée d'une huile brute initiale. Toujours d'après M. Louis, il correspond à une concentration de pétrole brut dont une partie que l'on peut évaluer à 30 % a été polymérisée par l'action du soufre. Des essais de distillation, qu'il serait fastidieux de décrire, montrent que le bitume de Limagne peut donner des huiles brutes, susceptibles à leur tour de servir à la préparation de lubrifiants.
Un mot sur son origine qu'il faut rattacher au milieu biologique du lac stampien de Limagne. La réaction positive du cholestérol enregistrée par M. l'ingénieur Louis montre qu'une partie des asphaltes d'Auvergne provient du règne animal.
L'EXPLOITATION
(NDR l'article ayant été écrit alors que l'exploitation de la mine des Roys était encore en activité, j'ai légèrement modifié le texte)
Le dernier gisement exploité fut celui de la mine des Roy à Dallet. Le bitume imprégnait des calcaires concrétionnés disposés eux-mêmes au sein de calcaires marneux. Souvent le liquide gluant s'écoulait le long des fentes et des failles donnant naissance à des ruisselets noirs et visqueux. La roche était concassée puis broyée en poudre fine, puis utilisée dans diverses fabrications, mastics, pavés d'asphalte, etc... Les pavés constituaient la principale production possédaient d'incontestables qualités, c’étaient des isolants remarquables, insonores, élastiques et d'une grande résistance à l'usure. Un étrange phénomène géologique recoupait la principale galerie minière, une cheminée évasée vers le haut, interrompt les couches sédimentaires. Cette ancienne cheminée d'explosion, contemporaine des éruptions pépéritiques de Limagne, témoigne du souffle puissant d'un volcan apaisé depuis trente millions d'années.
__________________________________________________
[1] Roche pépéritique : lors d'une éruption phréatomagmatique, le contact explosif de la lave et de l'eau émiette le basalte et le mélange aux sédiments. Les éruptions phréatomagmatiques surviennent lors de la rencontre entre le magma ascendant et de l'eau superficielle, nappe phréatique, cours d'eau ou lac.

Les principaux indices de bitume de la Limagne sont situés en rive gauche de l'Allier dans la région de Clermont Ferrand car c'est là que se trouve la plus grande épaisseur de sédiments, en particulier les schistes papyracés, roches mères des hydrocarbures. (Texte, "Le sentier du bitume", Club Minérlogique de Moulin sur Allier)
Extrait de :
Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne / publiées par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand ; sous la direction de M. H. Lecoq. 1846.
Transcription du texte original des pages 123 à 132.
Document original
d'époque en PDF.
PUY DE LA POIX.[i]
Nous ne connaissons dans la Basse-Auvergne qu'une seule fontaine véritablement sulfureuse ; elle jaillit au Puy de la Poix. Cette source minérale fournit en même temps de l'acide carbonique, du gaz sulfhydrique, de l'eau fortement chargée de muriate de soude et du bitume-malte.
Pour rendre plus intelligible la disposition des lieux, nous allons indiquer quelques circonstances géologiques importantes.
A la fin de la période tertiaire, 2,58 Ma, des diks (dyke, note du transcripteur) de wakite (strates de laves basaltiques terreuses, note du transcripteur) ont traversé de bas en haut les terrains tertiaires de la Limagne; et comme cette plaine n'était pas encore émergée , les parties les plus élevées de ces filons, ayant dépassé le niveau des calcaires, ont été remaniées par les eaux. Il en est résulté des couches alluviales qui se sont déposées sur les pentes et le 1ommet de ces éminences. Mais au-dessous de ces assises superficielles on retrouve la wakite non altérée.
Les monticules de wakites, de wakes ou de pépérites bitumineuses sont très-nombreux. Les plus remarquables sont ceux de Crouël, de Malintrat, de Pont-du-Château , de Clermont et du puy de la Poix[ii].
Le puy de la Poix est un monticule situé à cinq ou six kilomètres est de Clermont-Ferrand, au nord-est et à une petite distance du puy de Crouël dont il est séparé par la route de Lyon. Il s'élève à dix ou douze mètres au-dessus des plaines environnantes. La roche qui occupe son sommet, est de couleur grise ou noirâtre, et sa texture est très-grossière; elle se désagrège facilement. Ses fentes contiennent du bitume-malte. Près de la source minérale, la wakite est plus dure et plus compacte. Sa cassure est d'un gris foncé, truité de gris clair.
Cette dernière portion de la petite montagne est moins élevée ; elle fait partie d'un communal appartenant à la ville de Clermont.
Jean Banc, qui écrivait au commencement du dix-septième siècle , assure qu'il existait de son temps au puy de la Poix deux sources, l'une plus grande que l'autre; l'eau en est aigrette et tiède. Elles sont situées sur le penchant de la colline. Au-dessus de la plus grande nage le bitume.
La source principale, dont parle cet auteur, a disparu depuis qu'on a fait des fouilles près de la seconde fontaine. ( Bouillet.)
Cette dernière est placée au milieu d'un fossé creusé sur le revers septentrional du puy de la Poix.



L'eau minérale du Puy de la Poix est trop active pour qu’on ose l'administrer à l'intérieur. Mais il serait possil1le, après l’avoir filtrée, de s'en servir pour préparer des bains minéraux. La présence du bitume la rendrait sans doute efficace dans certaines affections dartreuses. Déjà les expériences tentées par M. H. Lecoq, démontrent que ce médicament guérit promptement la gale.
____________________________________________
[i] Ce Puy, que l'on nomme en patois auvergnat Puy de la Pége , est situé sur le territoire de la commune de Clermont.
[ii] Il existe également des gisements de bitume au Calvaire, au puy Dol in, au puy de la Sau, à celui de Gandaillat, au puy Long, sur les puys d' Anzel, de Pelou et de Lempdes ; près de Cournon, aux puys de Cornolet et de Chalus ; à Lussat, au puy de Mur et à Machal ; aux sources du Tambour et près du pont de Longue, à Coudes, à Gergovia, à Chamalières, à Chanturgue, à Terre-Fondue, à Cœur, à Crouzol, à Davayat, à Montpensier etc… Mais, dam ces diverses localités, on ne trouve point de source semblable à celle du puy de la Pois.
[iii] Annales l'Auvergne, 1829, page 276.
[iv] Au sud-sud-est et un peu plus haut que ce bassin, on voit sortir d'une muraille le sommet d'une pyramide de granit que les antiquaires rangent parmi les pierres druidiques.
[v] On trouve une source analogue dans le Languedoc; elle porte le nom de font de la Pége. Bouillon-Lagranie, page 212.
[vi] Jean Banc, page t4, Caldaguès ajoute que les pigeons recherchent avec avidité l'eau de cette fontaine. Manuscrit1 de la bibliothèque de Clermont.
[vii] Tome 1, page 356.
[viii] Chomel assure que Tournefort, en distillant le bitume du puy de la Poix, en a retiré une huile analogne à celle de Pétrole. (Traité des eaux de Vichy, etc., page 341 Mars 1846.
[ix] Nous nous sommes borné à analyser les gaz dissous dans l'eau.
[x] La source de la grotte inférieure ( Bagnères de Luchon), qui est la plus sulfureuse des eaux des Pyrènées, ne contient par litre que 0,0868 de sulfure de sodium. (Patissier et BoutronCharlard, page 102)
Avant 1718, on voyait autour de l'ancienne source un bassin carré ayant un pied deux pouces de côté, et deux pieds de profondeur. (Caldaguès.) Ce bassin a été renversé avant 1796. ( Buc' Hoz.)
Afin d'assainir un cuvage placé sous le puy de la Poix, on commença à creuser, en 1829, un fossé qui traversait la cavité où venait sourdre la seconde fontaine. M. Bouillet engagea l'Académie de Clermont à s'opposer à ce que les fouilles entreprises fussent poursuivies. Une commission composée de MM. Tailhand, Bouillet, Peghoux, Lecoq et Burdin , fut nommée et se transporta sur les lieux.
M. Tailhand, dans la séance de juin 1829, fit un rapport où il déclara nuisibles et illégaux les travaux exécutés sur le communal du puy de la Poix. Les conclusions de ce rapport furent approuvées par l'Académie et communiquées au maire de Clermont[iii]. Les travaux furent suspendus.
Postérieurement à l'année 1831, on a construit, autour de la source bitumineuse, un bassin de forme irrégulière et d'environ deux mètres de côtés ; il permet de recueillir facilement le pissaphalte[iv]. (pissaphalte, bitume mou, noir, dont l’aspect est entre celui de la poix et de l’asphalte, note du transcripteur)
Cette substance est ramassée par les domestiques d'une ferme voisine qui la vendent à M. Ledru, directeur de l'exploitation des bitumes du département du Puy-de-Dôme.
L'eau minérale du puy de la Poix est très-peu abondante, et comme le bassin où elle séjourne est découvert, elle se mêle aux eaux pluviales, et devient moins active lorsque le temps est mauvais; tandisque le soleil d'été augmente la proportion des matières salines qu'elle tient en dissolution. On prévoit d'avance que ces particularités doivent faire varier beaucoup la composition de ce liquide.
Une couche plus ou moins épaisse de bitume très visqueux recouvre la surface de l'eau. Entre les globules de cette matière, on remarque une croûte blanche formée par du carbonate de chaux et des cristaux de sel marin.
L’orsqu'il n'existait point encore de bassin, on pouvait suivre de l'œil la sortie de l'eau, des gaz et du pissaphalte. On voyait alors s'échapper de temps en temps des séries de bulles d'hydrogène sulfuré, mêlé d'acide carbonique, chassant devant elles de petits amas de bitume qui s'étalaient en s'entourant d'une auréole irrisée. Parfois cette matière gluante obstruait la fente du rocher ; l'eau et les gaz s’accumulaient au-dessous d'elle, et après quelques instants ils projetaient au loin l'obstacle qui les avait un instant arrêtés.
La source du puy de la Poix a fixé, depuis bien des siècles, l'attention des naturalistes[vi].
Belleforest, dans sa cosmographie, écrit, en 1575, que l'on observe près de Clermont et de Montferrand « une colline ou montaignette , où le bitume coule tout ainsi que fait une source de fontaine, lequel est noir au possible, gluant et tenant. » On s'en sert dans le pays pour marquer les brebis. Cet auteur fait remarquer que le pissaphalte est plus abondant en été, tandis que la froidure empêche la liqueur de se dissoudre et de distiller.
Jean Banc nous assure « que les oiseaux, en hyver le plus glacé, qui viennent boire en ce lieu, incapable de gelée, s'y prennent comme à des gluaux» Le bitume qui produit de pareils effets, répand une horrible puanteur[vi].
Les sources et le puy de la Poix ont été étudiés, en 1718, par Caldaguès, chanoine de la cathédrale, et en 1749 par Delarhre. (Buc'h-loz.) Legrand-d'Aussy et MM. Lecoq et Bouillet s'en sont également occupés.
Le bitume-malte qui sort des fentes de la wakite, est épais, visqueux, tenace, d'un noir foncé tirant un peu sur le brun ; son odeur est forte et désagréable. Soumis à la distillation, il laisse un résidu d'asphalte qu'on mélange avec du sable pour en faire des terrasses, des sols de cour et des fonds de réservoirs.
Nous ferons remarquer, à cette occasion, que l'emploi du bitume est très-ancien. « Il existe, dit Legrand, dans la ci-devant province d'Alsace, une source de pissaphalte. En 1140, si je ne me trompe, on avait fait entrer celui-ci dans la composition d'un nouveau ciment qu'on prétendait indestructible et inaltérable dans l'eau, et il avait même été employé pour quelques bassins des jardins de Versailles, et pour celui du Jardin des Plantes à Paris[vii]. »
Bien avant l'époque où les trottoirs en bitume ont détroné, à Paris, la lave de Volvic, on construisait en Auvergne des terrasses avec le pissaphalte du puy de la Poix.
Parmi les produits volatiles qu'on extrait de ce bitume, en le chauffant en vases clos, on remarque une huile semblable au naphte[viii].
Les seules observations qui puissent nous indiquer, d'une manière précise, la quantité de pissaphalte qui se rassemble, dans un temps donné, à la surface de l'eau du puy de la Poix, remontent à 1749. Elles ont été faites par Delarhre. (Buc'Hoz.)
Au mois de juillet , la quantité de bitume sortie en huit jours a été de six livres ; au mois d'août, elle s'est élevée dans le même temps à huit livres. Ce qui fait pour la première expérience 367 grammes ; pour la seconde, 489 grammes en vingt-quatre heures. Ces expériences ont été faites sur la première fontaine qui a disparu. M. Ledru assure que la seconde fontaine qui existe encore donne 500 à 750 grammes de bitume par jour pendant les chaleurs de l'été.
Propriétés physiques.
L'eau minérale du puy de la Poix présente, quand on la voit en masse, un aspect louche et une teinte légèrement plombée. Autrefois, alors que son écoulement était facile, elle paraissait limpide lorsqu'on la puisait dans un vase de petite dimension. Elle a une forte odeur d 'œufs pourris et de pissaphalte ; sa saveur est bitumineuse, sulfureuse et salée. Un ancien auteur nous assure que quand on en boit même en petite quantité, elle détermine des nausées et des vomissements. Cet observateur ajoute, ce qui nous paraît fort douteux, que la répugnance est étrangère à la production de ces phénomènes.
Il est impossible aujourd'hui d'apprécier le degré de chaleur de cette source minérale ; mais au mois de septembre 1831, elle a fait monter notre thermomètre centigrade à +14°,5, la température de l'atmosphère étant, à l'ombre, de +16°.
Propriétés chimiques.
Avant d'exposer les expériences auxquelles nous nous sommes livré aux mois d'août et de septembre 1844, nous devons avertir que la quantité de sels dissoute dans, l'eau du puy de la Poix présente des variations notables, comme le prouvent les observations suivantes :
1° - En 1718 Caldaguès, quand le bassin est presque vide, trouve par litre d'eau........... 77,50
2° - Lorsque le bassin est plein , le résidu est de …………………………………………….45,84
3° - Delarbre retire de la même quantité de liquide, sels âcres ……………………......….100,00
4° - L'évaporation faite au mois de septembre nous a fourni ……………….……..........…..90,07
5° - Au mois de septembre 1844- nous avons retiré …………………….………….…..……70,60
6° - Enfin au mois d'août 1844, chaque litre a laissé un résidu de .…………............……..82,67
C'est sur cette dernière quantité que nous avons opéré.
Voici les proportions de substances gazeuses et des sels contenus dans un litre d'eau du Puy de la Poix.

ANNEXE
Ne ratez pas la magnifique conférence
du Professeur Pierre Thomas sur
"Les gaz de schistes"
http://html5.ens-lyon.fr/Acces/FormaTerre/20141120/pierre_thomas/lesgazdeschiste_video.html
SOURCES
Textes :
"Le sentier du bitume", PDF du Club minéralogique de Moulin sur Allier.
2 textes historiques : Auteur inconnu
Crédit photos :
Pierre Thomas, ENS Lyon, professeur émérite, laboratoire de géologie
C. Nicollet, professeur émérite à l'Université Clermont Auvergne de Clermont Fd,