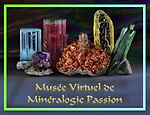« Le charbon est un combustible fossile connu et utilisé depuis la haute antiquité. »

Anthracite
LES CHARBONS

Le terme générique « charbon » désigne un ensemble de roches sédimentaires combustibles fossiles dont la maturité et le pouvoir calorifique varient fortement. Il n’existe donc pas un mais des charbons que l’on catégorise principalement en fonction de leur taux de carbone.
Les gisements les plus importants de cette roche sédimentaire débutèrent au Carbonifère, il y a 358 millions d'années.
La réserve mondiale prouvée est d’environ 1 1000 milliards de tonnes en 2021.
En raison de sa densité énergétique élevée, avec un contenu calorifique moyen d’environ 24 millions de Btu par tonne, c’est une source énergétique très efficace pour la production d’électricité et des processus industriels. En 2022 il génère plus de 40% de l’électricité dans le monde.
Avec un prix par tonne de 45 à 85 USD en 2021 il est relativement moins cher que d’autres sources de combustible fossile, gaz naturel et pétrole. De plus la stabilité du pris en fait une source d’énergie stable et prévisible dans le temps
Le charbon est le résultat de la transformation de matières organiques végétales. Il est donc composé d'hydrogène, de soufre, d'oxygène et surtout de carbone.
Durant des dizaines de millions d'années, l'accumulation et la sédimentation de débris végétaux dans un environnement anaérobique (absence d’oxygène), de type tourbière ou la biomasse est noyée dans les vases ou le sable, elle s’enfonce ce qui entraine une modification progressive des conditions de température, de pression et d'oxydo-réduction dans la tourbe qui entraine, par carbonisation, la formation de composés de plus en plus riches en carbone.
Le charbon, comment s'est-il formé ?
Voici une bonne description du groupe "Friends of Coal-Kentucky".
« En 1918, les mineurs de charbon se sont émerveillés devant une souche d'arbre pétrifiée encapsulée dans une veine de charbon, ce qui nous rappelle que le charbon est plus que du carburant énergétique - c'est une pièce préservée du passé ancien de notre planète.
Le processus de préservation de la végétation dans une couche de charbon, comme dans le cas d'une souche d'arbres perminéralisée trouvée par les mineurs, est un phénomène intéressant ancré dans les processus géologiques et biologiques. Voici un aperçu de la façon dont cela se passe :
1. Formation de tourbe : Au départ, le matériel végétal, comme les arbres, les fougères et d'autres végétations, s'accumule dans les milieux marécageux ou humides. Cette matière végétale ne se décompose pas complètement à cause des conditions anaérobiques (faibles ou privés d’oxygène) dans ces milieux humides.
2. Enfouissement et compression : Au fil du temps, des couches de sédiments, dont la boue, la vase et le sable, enfouissent les matières végétales. À mesure que les sédiments s'accumulent, leur poids comprime la matière végétale sous-jacente.
3. Changements chimiques et carbonisation : sous la pression et l'augmentation de la température des sédiments, la matière végétale subit des transformations chimiques. Ce processus, connu sous le nom de carbonisation (en anglais coalification), convertit graduellement la matière végétale en charbon. Au cours de ce processus, l'eau et les substances volatiles sont chassées par la pression et la chaleur, alors la teneur en carbone augmente.
4. Préservation de la structure de la végétation : dans certains cas, les conditions sont justes pour préserver la structure de la plantes originelle à l'intérieur des couches de charbon. Cela peut inclure des feuilles, des branches, de l'écorce et même des souches d'arbres entières. Le processus de perminéralisation, où la matière organique est remplacée par des minéraux, peut aussi se produire, préservant davantage ces structures.
5. Découverte dans l'exploitation minière : lorsque les mineurs excavent des couches de charbon, ils découvrent parfois ces morceaux de végétation ancienne préservés, ce qui fournit un lien direct et tangible avec l'histoire géologique et biologique de la Terre.
" Cette préservation est assez remarquable car elle offre une fenêtre sur les écosystèmes et les environnements passés, nous montrant quel type de végétation était présent il y a des millions d'années lorsque le charbon a été formé. "


Pour les besoins industriels et domestiques, un charbon se caractérise par :
-
sa teneur en matières volatiles (MV) exprimée en pourcentage par rapport à la masse totale. Celles-ci sont constituées sensiblement de méthane et d'hydrogène ; sous l'effet d'une élévation de température, les matières volatiles se dégagent du combustible, s'enflamment facilement, et accélèrent la combustion ;
-
son pouvoir calorifique (exprimé en kJ/kg), quantité de chaleur fournie par la combustion d'un kg de charbon ;
-
sa teneur en eau exprimée en pourcentage ;
-
sa teneur en cendres exprimée en pourcentage. Les cendres sont les résidus solides de la combustion du charbon, et peuvent contenir des polluants, métalliques notamment, de 20 à 120 ppm de métaux radioactifs (uranium, thorium, radium…), qui se concentrent dans les tas de cendres issus de la combustion du charbon, ce qui contribue à la pollution de l'environnement ;
-
sa teneur en soufre exprimée en pourcentage ; la présence de dioxyde de soufre et de traces de mercure ou d'autres métaux dans les fumées de combustion contribue à la pollution de l'environnement.
Gradation des charbons selon leur teneur en carbone (C).
-
La tourbe contient 40/50 % de carbone ;
-
Le lignite contient jusqu'à 50/60 % de carbone ;
-
La houille se subdivise en :
-
charbon semi-bitumineux contient 60/70 % de carbone ;
-
charbon bitumeux contient 70/90 % de carbone ;
-
-
L’anthracite (houille supérieure) à une concentration en carbone presque pur jusqu’à 97 %.


Le Lignite (houille brune)
Le lignite est un type de charbon « de rang inférieur », caractérisé par une teneur en eau élevée et une teneur en carbone de 50 à 60% lui conférant un faible pouvoir calorifique.
Près de 90% de la production mondiale de lignite est utilisée pour générer de l'électricité.
Les trois premiers producteurs mondiaux de lignite sont l'Allemagne, la Chine et les États-Unis.
Le lignite est exploité à l’échelle industrielle depuis le XIXe siècle.



Les Houilles et l'Anthracite
La houille est une qualité spécifique de charbon, terme générique qui recouvre trois catégories de combustibles solides de même origine (kérogène), mais dont les gisements sont à différents stades de transformation, dont l'anthracite est la variété de qualité supérieure.
L'anthracite (du grec ἄνθραξ anthrax, charbon). Charbon gris, noirâtre et brillant extrait de mines le plus souvent souterraine. L'anthracite a été exploité en priorité au cours des XIXe et XXe siècles (cf. Pic de Hubbert appliqué au charbon). Sa densité réelle est de l'ordre de 1,45 à 1,75.
L'anthracite se consume lentement il est utilisé pour :
-
le chauffage comme combustible, éventuellement sous forme semi-pulvérulente dans des installations industrielles2 ; son pouvoir calorifique est de 7 000 à 8 000 kcal/kg ;
-
la fabrication d'électrodes ;
-
comme colorant ;
-
pour produire du caoutchouc synthétique ;
-
pour la préparation de charbon activé notamment utilisé pour le traitement primaire de l'eau ;
-
en sidérurgie
Utilisation des charbons en sidérurgie
Historiquement, l'utilisation d'anthracite a été un point clé dans le développement de la sidérurgie, en particulier aux États-Unis. En effet, la mise au point du haut fourneau au coke par Abraham Darby permet d'affranchir cette industrie de la pénurie et du coût du charbon de bois. Malheureusement, la plupart des charbons alors disponibles aux États-Unis étaient incompatibles avec la production de fonte de qualité. Le remplacement du charbon de bois par l'anthracite échoua longtemps, jusqu'à l'invention du "vent chaud", insufflation d'air chaud (1 200° K)à la base du fourneau, par James Beaumont Neilson.
En 1831, le Dr Frederick W. Gessenhainer dépose un brevet relatif à l'utilisation d'anthracite, dont l'ignition devient possible lorsque l'air soufflé dans le haut fourneau a été préalablement chauffé. Il produit en 1836 à Valley Furnace, près de Pottsville en Pennsylvanie, la première fonte à l'anthracite, mais son décès en 1838 suspend momentanément le développement de cette technique aux États-Unis4.
Indépendamment de Gessenhainer, George Crane et David Thomas, de l'Yniscedwyn Works dans le Pays de Galles, déposent un brevet similaire en 1836. Le nouveau procédé y démarre le 5 février 1837. Crane achète cependant les droits relatifs au brevet de Gessenhainer, pendant que Thomas émigre en Amérique où il fonde la Lehigh Crane Iron Company à Catasauqua, en Pennsylvanie. La réussite de ce procédé assure sa diffusion, permettant ainsi l'essor de la sidérurgie américaine4.
Mécaniquement plus résistant, le coke supplante cependant l'anthracite dès que des charbons cokéfiables sont découverts. Au début du WIXe siècle, la production de fonte à l'anthracite est devenue marginale. De nos jours, l'anthracite n'est plus utilisé que comme complément au coke ou au charbon injecté aux tuyères de haut fourneau, ainsi que comme combustible dans les usines d'agglomération de minerai.
Le "COKE".
Le coke désigne un résidu solide poreux et fissuré constitué uniquement de carbone et de matières minérales calcinés. Il est produit par pyrolyse d’un mélange de charbon, c’est-à-dire par décomposition de ce dernier à très haute température (jusqu’à environ 1100°C) pendant une vingtaine d’heures en moyenne.
L’opération de « cokéfaction » du charbon consiste à en éliminer les matières volatiles dans un four, à l’abri de l’air afin d’éviter sa combustion en présence d’oxygène. Dans une « cokerie », des dizaines de fours sont réparties en batteries.
Précisons que tous les types de charbon ne sont pas « cokéfiables » ; les charbons « à coke » (aussi dits « bitumineux ») doivent posséder la faculté de se ramollir à une température d’environ 350 à 400°C, puis de se resolidifier en une masse poreuse à coke aux environs de 500°C. Avant d’être « cokéfié » dans un four, le charbon est broyé. Du fioul y est mélangé dans une proportion de 1% à 5% de la masse afin d’obtenir une « pâte à coke ».

Coke.


SOURCES
-
Connaissance des énergies
-
Wikipédia
-
Larousse
-
H.W. Schiller