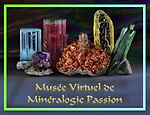Pétrole
Le pétrole est un mélange complexe d'hydrocarbures, composés principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène, mais également d'autres éléments tels que le soufre, l'azote et l'oxygène. Le pétrole se compose de myriades de molécules variées qui doivent être séparées et modifiées chimiquement pour donner lieu à des produits utilisables.
Combustible fossile, le pétrole est issu de la minéralisation, par processus thermique, de matières biologiques présentes dans certaines roches, appelées « roches-mères[1] ». (voir aussi à la page composés organiques)

COMPOSITION
Ces roches contiennent des restes fossilisés de plantes aquatiques ou terrestres, de bactéries et d'animaux minuscules qui se sont accumulés au fond d'océans, de lacs, de lagunes ou de deltas. Ces résidus organiques sont connus sous le nom de "kérogène[2]", ils sont emprisonnés dans des milieux anaérobiques[3], associés à des minéraux sédimentaires, donnant ainsi naissance à la "roche-mère".
Pendant des millions d’années, de nouveaux sédiments vont s'accumuler, enfonçant la roche mère à des profondeurs considérables.

PERMINERALISATION
Entre 2 500 et 5 000 m sous l’effet de températures élevées, le kérogène se transforme (réaction de craquage[4] thermique) en pétrole liquide et en gaz. Au-delà de 5 000 m, le pétrole se transforme à son tour en gaz.
Les hydrocarbures, qui sont plus légers que l’eau, remontent vers des zones de roches poreuses, appelées « roches réservoirs » ou « pièges », où ils sont emprisonnés, sous la condition que des roches imperméables (« roches de couverture ») les retiennent. Sinon, ces fluides s’écoulent à la surface, donnant naissance aux "mares" de pétrole exploitées dès l'Antiquité, comme celles observées au Moyen-Orient, au Venezuela ou encore en France. Le puy de la Poix dans l'Allier (près de Clermont-Ferrand), déjà connu des Romains, est un suintement actif de bitume, depuis plus de 2 000 ans.
1 roche-mère : une roche argileuse feuilleté, un schiste argileux. Gaz et huile de schiste sont des noms dérivés de la roche mère.
2 kérogène : (du grec signifiant « qui engendre la cire ») est la substance solide qui correspond à l'état intermédiaire entre la matière organique et les combustibles fossiles. Charbon, gaz naturel et pétrole.
3 milieu anaérobique : milieu privés d'oxygène.
4 craquage : le craquage (cracking en anglais) est, en pétrochimie, la thermolyse du pétrole et de ses dérivés liquides. L'opération consiste à casser les molécules.
Source IFP énergies nouvelles


UTILISATION
Après raffinage, certains de ses constituants deviendront, à température et à pression ambiantes, gazeux (méthane, propane, etc.), liquides (essences, gasoil, kérosène etc.) et parfois solides (paraffines, asphaltes, etc.).
Notons, que le raffinage pétrolier produit une grande partie des matières premières pour l’industrie chimique. Le plastique et
les tissus synthétiques n’existeraient pas sans le pétrole.
Un baril de pétrole est l’équivalent de 159 litres (42 gallons américains). Le ratio du raffinage du pétrole brut en essence est de 20%. La moitié du pétrole extrait sert au raffinage des carburants. Schématiquement on peut dire que 2 barils extraits représenteront le plein d’une voiturette, Fiat 500.
Le raffinage du pétrole est une industrie d’une importance cruciale pour l’économie.

Les principaux matériaux plastiques issus du raffinage du pétrole, ainsi que leurs domaines d’utilisation.
PVC : Polychlorure de vinyle. Utilisé pour fabriquer des tubes rigides (gouttières, câbles électriques, cadres, fenêtres). Autrefois, il servait à la fabrication de disques vinyle.
Polyéthylène basse densité : objets pour l'industrie automobile, sacs d'emballage de supermarché, films (travaux publics), tuyaux et profilés, sacs poubelles, articles injectés (ménagers et jouets), sacs congélation.
Polyéthylène haute densité : récipients, tuyaux, matériaux filamenteux, produits façonnés par moulage par injection.
Polytétrafluoroéthylène (PTFE) : également connu sous le nom de Teflon, est utilisé comme revêtement sur les poêles Tefal. Il trouve également des applications dans divers domaines de la chimie.
Polypropylène : un matériau utilisé dans la fabrication de pièces moulées par injection pour diverses industries, telles que l’automobile, l’électroménager, le mobilier, les jouets, l’électricité, l’emballage alimentaire, les emballages divers, les câbles, les ficelles, les films, les sacs, les boîtiers de phares, entre autres.
Polystyrène et les copolymères connexes (ABS) : utilisés pour diverses applications, notamment les emballages (barquettes blanches), l’isolation des bâtiments (polystyrène expansé), les stylos Bic Cristal (transparents), l’industrie automobile, l’électroménager, le mobilier (bureaux et jardins), les jouets, les bagages, les emballages pour cosmétiques, médicaments et produits alimentaires.
Poly-isobutène: également connu sous le nom de « caoutchouc butyl », est utilisé dans les pneus.
Polybutadiène (BR) : utilisé principalement pour la fabrication des pneus.
Styrène butadiène (SBR) : caoutchouc synthétique (latex, par exemple), composé de styrène et de butadiène (élastomères). Les applications du SBR sont nombreuses, on le trouve dans les pneus, les joints, les amortisseurs, les tapis roulants, les semelles et les garnitures de pompes. Il est également utilisé dans la composition des bitumes pour rendre le revêtement plus souple.
Acrylates et les méthacrylates, ainsi que le polyméthacrylate de méthyle, également connu sous l’abréviation PMMA. : applications en peintures, revêtement de surface, fibres, adhésifs, encres, verrières (vitrages caravanes, avions, bateaux), verres de lunettes, lavabos, baignoires cabines de douches.
Polyamides : famille des nylons : 6-6, 6 et 11, 12. Ils sont utilisés dans une variété d'applications, notamment dans les vêtements, les pièces mécaniques de frottement, les réservoirs d’essence et les seringues. Le Kelvar tissé est utilisé dans les gilets pare-balles.
Fibres et résines polyester : à partir de l'acide téréphtalique (obtenu à partir du paraxylène et de l’éthylène glycol, par exemple pour la fibre Tergal), et du polyéthylène téréphtalate (PET) pour les bouteilles.
Polyuréthanes : polycondensation de diisocyanate et de diols. Exemple : ex TDI (toluène diisocyanate), MDI diphénylméthane 4-4 diisocyanate,ou HMDI (version hydrogénée) et pour les diols (PEG polyéthylène glycol, le propylène glycol, PPG).
Ces matériaux ont une variété d’applications, notamment la fabrication de mousses rigides (isolation thermique et acoustique) et semi-rigides (rembourrage de meubles, coussins, selles), ainsi qu’en tant que revêtements, adhésifs, vernis, peintures, et en enduction pour les rideaux, tentures, bâches et voiles.
Polycarbonate : on le retrouve dans la composition des gilets pare-balles, des casques de moto, des bouteilles, des biberons, des moulinets de canne à pêche, des verres de sécurité, des boîtiers, des feux clignotants, etc.
Origine de l'unité de mesure BARIL ou BBL (barrel en anglais)
L'origine du terme "barrel", abréviation BBL, remonte aux années 1860-1870, aux Etats-Unis. À cette époque, on utilisait des barils fabriqués pour d'autres industries et commerces (whisky, huile de baleine, sel, poissons, etc.) pour stocker et transporter le pétrole par train, bateau chariots.
Ils avaient une contenance variant entre 30 et 50 gallons américains (de 110 à 190 litres). Afin d’assurer une plus grande uniformité, il a été décidé d'utiliser des barils de 40 gallons (151 litres). Ces fûts en bois de chêne, bien qu'ils ne soient pas totalement étanches, ont été légèrement surdimensionnés de 5 % pour garantir une livraison plus juste au client. Leur volume est ainsi passé de 40 à 42 gallons américains, soit 159 litres. Ces tonneaux ont été fabriqués par des artisans menuisiers tonneliers, leur coût était considérablement plus élevé que leur contenu.
Cependant, lorsque l’industrie pétrolière a pris de l’importance, des méthodes plus adaptées (oléoducs, citernes) ont été utilisées, tout en conservant la même unité de mesure. En vérité, une fois que l'équivalence "1 baril équivaut à 42 gallons" est devenue une norme universellement acceptée, la majorité du pétrole n'était déjà plus acheminée de cette manière.
Le double "b" de l'abréviation("bbl" et non " bl") viendrait du "b" de blue barrels, semble-t-il parce que la « Standard Oil of California » utilisait des barils bleus pour les différencier de ceux des autres compagnies, et pour les différencier des autres barils dont ceux de whisky.

LE PETROLE DANS LE MONDE
Il existe environ 30 000 gisements rentables, allant de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres carrés. Parmi ceux-ci, on distingue 450 à 500 gisements "géants" (dont les réserves excèdent 70 millions de tonnes), dont une soixantaine de "super-géants" (dont les réserves dépassent 700 millions de tonnes). Ces gisements se trouvent dans le monde entier, mais ils sont très inégalement répartis : 60 % des "super-géants" sont situés au Moyen-Orient, et ils représentent 40 % des réserves prouvées de la planète.
Les 2/3 des réserves mondiales de pétrole sont concentrées au Moyen-Orient.
Les réserves prouvées, un concept crucial.
Étant donné que le pétrole n’est pas une source d’énergie renouvelable, l’évaluation des réserves est cruciale. Les réserves représentent la quantité de pétrole qui peut être extraite à partir de gisements déjà exploités ou sur le point de l’être, compte tenu des contraintes techniques et financières actuelles.
Les réserves prouvées représentent la quantité de pétrole dont l'existence est avérée et dont la probabilité de récupération, compte tenu des données disponibles, des méthodes d'extraction et des conditions économiques, est d'au moins 90 %.
En général, seulement 35 % du pétrole contenu dans un gisement peut être extrait. De nouvelles techniques d’extraction peuvent permettre d’accroître les réserves ; elles peuvent être rentables si le prix du baril est élevé.
Le pétrole offshore
Les plaines sous-marines recouvertes d’une couche de sédiments peu profonde, c’est-à-dire ne dépassant pas 500 mètres, occupent une surface impressionnante de 30 millions de kilomètres carrés, comparable à celle du continent africain. Ces zones abritent une proportion considérable des ressources et de la production mondiales actuelles, représentant environ 30 % de la production globale et 20 % des réserves. Par conséquent, l’exploitation pétrolière en eaux profondes revêt une importance cruciale pour assurer notre approvisionnement énergétique.
L'exploitation en eaux très profondes, soit à une distance supérieure à 1 000 mètres sous la surface, a bénéficié récemment de progrès significatifs sur le plan technologique. Malgré ces avancées, cette forme d’extraction demeure extrêmement ardue et onéreuse, car les objectifs d'exploration sont constamment repoussés vers des profondeurs toujours plus grandes et des environnements toujours plus difficiles.
Les trois plus grands pays producteurs de pétrole offshore sont l’Arabie saoudite, les États-Unis et la Russie.