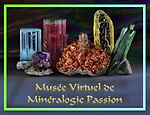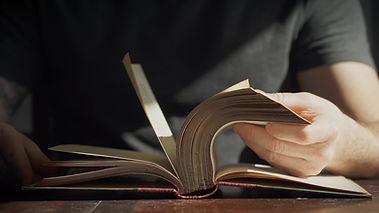

LES PERLES
LES HUITRES PERLIÈRES...

HISTORIQUE
Depuis le paléolithique l’on trouve des coquillages dans certaines sépultures, sites de La Madeleine en Dordogne, de Grimaldi en Italie et de Sungir en Russie (32 000 ans). C’est plus tard que l’on trouve des perles dans des tombes dans les régions du golfe persique et de l’Océan Indien (5 500 ans avant Jésus-Christ).
C’est en Chine que l’on a trouvé les premiers documents écrits qui datent de 4 600 ans qui décrivent ces merveilles comme un cadeau de la nature, en Inde et en Égypte les perles étaient considérées comme des objets divins sacrés.
La Grèce antique connaissait les perles sous le nom de « Larmes d’Aphrodite » l’Europe découvrira les perles en tant que bijou à la suite des conquêtes d’Alexandre le Grand en Orient (-334 à -325).
Chez les Romains elles étaient un signe de richesse et donc de pouvoir qui était réservé aux plus autres autorités et la tradition voulait que les familles richissimes achètent deux perles par années pour leurs filles.
Perses et Assyriens connaissaient les perles très abondantes dans leurs eaux et leur conféraient, eux aussi, des pouvoirs divins. Pour les Arabes dans le Coran, la perle est un trésor qui vient d’Allah et du Paradis.
Rare et précieuse la perle traverse les siècles tout en étant réservée à une élite richissime.
Mais au milieu du siècle dernier, les Japonais, dont le célèbre Kokichi Mikimoto, découvrent comment produire des perles de manière quasi industrielle, la perle de culture. Cependant il ne faut pas la confondre avec la perle synthétique issue de procédés qui ne sont pas naturels. Depuis l’évolution des techniques a même permis la production des perles d’eau douce.
De nombreux mythes et légendes ont émaillé l’histoire des perles au cours des siècles.

La plus ancienne perle trouvée dans une tombe du néolithique située sur le territoire de l'émirat Umm al-Qaywayn, aux Émirats arabes unis, 7500 ans.

Kokichi Mikimoto
QU'EST CE QU'UNE PERLE ?
C’est un très simple composé de carbonate de calcium (Ca CO3), de matière organique et d’eau, en concrétion dans des mollusques généralement bivalves. La théorie voudrait que dans la nature tous les mollusques à coquille soient capables de créer des perles y compris les escargots. On en déduit que ce ne sont pas seulement les huitres qui produisent les perles. Il y a une vingtaine d’années, une employée de la faculté des sciences de Nantes avait découvert une très belle perle dans une palourde pêchée à Noirmoutier. Les perles d’eau douce proviennent de moules d’eau douce.
La perle peut se former de deux façons soit dans la chair du mollusque, perle libre, soit dans la surface interne de la coquille (perle mabe ou ampoule ou blister en anglais).

Perle de palourde
Commençons ce dossier par une étude rapide du mollusque qui fabriquera la perle.
ANATOMIE DES HUITRES

On peut résumer l’anatomie de l’huitre à trois parties principales :
-
La coquille : l’huitre étant un mollusque bivalve, il y a deux coquilles qui s’articulent autour d’une charnière centrale, c’est une matière dure formée par sécrétion d’un organe interne, le manteau. La coquille grandit avec l’âge du mollusque. L’illustration ci-dessous montre la composition de la coquille et son mode de création.
À l’extérieur de la coquille, on constate souvent la présence d’un revêtement brun-verdâtre ressemblant à la matière de l’ongle, la corne, c’est la conchyoline, cette couche protège l’extérieur de la coquille.
À l’intérieur, la coquille est tapissée par la nacre, un assemblage de plaquettes d’aragonite CaCO3 et de conchyoline, une protéine.
-
Le manteau : c’est l’enveloppe biologique des organes internes, il recouvre sur toute leur surface les deux coquilles.
C’est en quelque sorte une peau interne, composée de trois couches de tissus composés de cellules très différentes les unes des autres :-
Au contact de la coquille, il y a le tissu épithélial, qui forme un recouvrement total de la coquille, dont les cellules sont jointives et soudées, ce sont elles qui produisent la matière de la coquille, la nacre.
-
Le tissu conjonctif est l’enveloppe des organes vitaux qu’il irrigue.
-
Sous le tissu conjonctif, il y a un second tissu épithélial, mais celui-ci ne produit pas de nacre.
-
-
Les organes internes : c’est l’ensemble des viscères de l’huitre, branchies, appareil digestif, cœur, appareil reproductif, etc.

LA NACRE
Biochimie et formation
La nacre est formée par biominéralisation, c’est la superposition de couches de tablettes d’aragonite (CaCO3), dont l’épaisseur est d’environ 500 nm, qui sont soudées entre elles par un composé biologique, la conchyoline, épaisse de 20 à 50nm (environ 4 à 6 %), c’est elle qui détermine la structuration en servant de « ciment » aux cristaux d'aragonite (qui représentent 90 % de la nacre). On note aussi la présence de traces d’eau (H2O) et d’ions divers.
L’iridescence est due à la superposition de couches d'indices de réfraction différents qui créent des interférences, la couleur dépend de l'angle d'incidence de la lumière.

Coupe de nacre d'une coquille d'huitre au MEB
Romain MALLET / SCIAM Angers
LES PERLES

Mystérieuses pendant longtemps, on les a prises pour des œufs, en Inde, c'était une goutte de rosée, tombée dans l'huitre venue respirer en surface, transformée en perle, puis pour des signes divins... une larme d’un dieu en Grèce ou à Rome.
On a cru plus tard, dans le golfe persique, qu'elles se formaient autour de grains de sable, introduit par le courant d'eau et créant une irritation, etc., etc.
Non, ce ne sont pas des œufs, mais ça on le sait depuis longtemps, et si j'en parle c'est parce que j'ai le souvenir, alors que j'étais encore enfant d'avoir entendu une personne, peu cultivée sans doute, dire que cela en était...
Les signes divins ??? Toutes les beautés de Mère-Nature en sont ! Donc ... je vous laisse seul juge de vos convictions !
Le gros mythe c'est le grain de sable ! Et oui que voulez-vous, il a une résistance sidérante dans les esprits !!!
Dimanche dernier au cours d'un repas où il y avait des huitres, la conversation avait de forte chance pour que quelqu'un parle de perle et ça n'a pas manqué. Et, devinez quoi ? Bingo ! La question est tombée " pourquoi n'y a-t-il pas plus de perles dans les huitres de Bretagne avec tout le sable que nous avons ? "
J'ai donc sorti l’Anti-mythe !
Anti-mythe...
Au Gemmological Institut of America un chercheur bien connu, grand spécialiste des perles, Kenneth Scarratt, a étudié des rapports d’expertises par radiographie de millions de perles, il n’a relevé la présence de corps étranger au sein d’une perle qu’une vingtaine de fois.
La théorie de l’intrus irritant, isolé par le coquillage en l’enrobant dans la nacre est complètement démonté par ces constats. Les rares intrus découvert et photographiés par Kenneth Scarrett sont un minuscule gastéropode et une minuscule coquille Saint-Jacques. Malgré mes recherches je n’ai pas pu me procurer ces extraordinaires clichés. Il y a bien des intrus qui pénètres dans les coquillages mais ils ne sont donc qu’extrêmement rarement à l’origine de la formation d’un perle libre au sein du coquillage ou en surface de la coquille.



Note de l'auteur :
L'on m'a très justement fait remarquer que les perles de culture sont produite en introduisant un intrus, le nucléus sur lequel l'huitre fera une perle. Les nucléus sont des billes plus ou moins régulières taillée dans de la coquille très épaisse d'autres mollusque, très souvent des moules du Mississippi et la Tennessee river. Ces nucléus sont parfaitement lisse et n'irritent pas l'huitre, alors qu' intrus irritant sera rejeté.
Merci à Catherine G. pour cette remarque constructive.
Je vais ajouter un paragraphe sur les nucléus utilisé pour les les perles de culture. (voir plus loin)
LES THEORIES A PROPOS DE LA FORMATION DES PERLES
Friedrich Wilhelm Alverdes
Ils sont nombreux à avoir contribué à la clarification du mode de formation des perles. C’est Friedrich Wilhelm Alverdes qui en 1912 démontra le premier que l’intrus n’est pas nécessaire à la formation de la perle. Les travaux de recherche qu’il avait effectué au début du siècles n’ont été retrouvés que beaucoup plus tard par Elisabeth Strack une gemmologue spécialiste des perles, de l’Université de Hambourg. elle les décrit dans son livre « Pearls éditions Rühle Diebener-Verlag, Stuttgart en 2006. Dans ce livre on retrouve la théorie d’Alverdes complétée par les travaux de Strack.

Friedrich Wilhelm Alverdes
Un ouvrage de référence scientifique indispensable en anglais qui ressemble à un roman passionnant. Le livre couvre les caractéristiques des perles et des perles de culture. Tous les traitements des perles et les méthodes d'analyse modernes sont expliqués. Elisabeth Strack donne des informations détaillées uniques.
Relié, 696 pages, plus de 600 photos couleur, 77 illustrations.

Elisabeth Strack

Henry Hänni
Le professeur Henry Hänni, du SSEF, Institut suisse de gemmologie à Bâle, auteur de nombreuses publications et conférencier international, est lui aussi un très grand spécialiste des perles et ses observations et expériences ont démontré que l’intrus n’est pas l’unique raison de la formation d’une perle mais que la blessure qu’il cause affecte le tissu épithélial peut provoquer la formation d’une perle.

On fait une petite pose ?
Pour vous remercier d'avoir lu jusqu'ici voilà une photo d'intrus dans une "perle de coquille, que l'on appelle "ampoule ou blister" (on reverra çà plus loin).
"Enseveli dans un mausolée nacré. Le destin d'un petit crabe trop curieux dans un blister."
Mort entre le manteau et la coquille ce mini crabe n'a pas été rejeté par l'huitre, elle l'a recouvert d'une ampoule de nacre, formant ainsi un blister, parfois appelé perle de coquille.

La Théorie blessure du manteau externe...
A la suite d'un accident fracturant la coquille, le manteau externe peut être blessé et des cellules épithéliales peuvent se retrouver déplacées dans l'hémolymphe ou le muscle du manteau. Par réaction génétique ces cellules vont se multiplier par division pour former un kyste , le sac perlier, qui va grossir et former une perle.
Il peut arriver que la perle en formation, sous l'action de l'huitre qui tente de l'expulser, se retrouve au contact de la coquille près du bord externe de celle-ci la où cette coquille fabrique de la matière coquillère pour croitre et se soude à la perle., qui ne sera pas une perle blister. (voir plus loin).

La Théorie parasitaire de la formation des perles
Cette théorie date du milieu du XIXe siècle en Italie, en Angleterre et en Allemagne, elle est le fruit d'observations de naturalistes sur de perles d'eau douce d'origine locale. Il était plus difficile pour ces chercheurs de travailler sur des perles marines; quasiment toutes originaires des mer chaudes.
À la fin du XIXe siècle, on publie l'observation de parasite au sein de perles issues de moules de Bretagne.
Plus tard des chercheurs partis dans les mers plus chaudes constatèrent le même phénomène pour les perles de Tahiti rapportée par les pêcheurs de nacre.
Léon Gaston Seurat, chercheur du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, s'est installé aux Gambiers, sur l'atoll de Mangarevaen. Dans des huitres, Léon Gaston Seurat a trouvé des kystes renfermant un ver plat comme une larve, en juillet 1903, il adresse le fruit de ses observations au professeur Guillard du Muséum, « Je crois que la formation des perles chez l'huître perlière est due à la présence d'un parasite "amphistome* " dont l'évolution m'échappe jusqu'à présent. » [La Nacre et la Perle en Océanie, pêche, origine et mode de formation des perles, bulletin n° 75 de l'Institut océanographique de Monaco, 1906.] Il orientera très vite ses recherches vers un autre type de parasite, le "cestode**".
Seurat oriente alors ses recherches vers les parasites de raies, particulièrement la raie léopard, "Aetobatus narinari", poissons qui vivent en abondance dans les eaux locales et qui se nourrissent d'huitres perlières. Il découvre très vite qu'elles sont infestées de cestodes qu'il nomme "Tylocephalum margaritiferae", en 1905. Le cycle est très simple les raies nagent au fond de la mer libérant les œufs de cestodes dans leurs excréments sur les bancs d'huitres, celles-ci filtrent l'eau de mer, les œufs se développent en larves minuscules dans les huitres qui sont mangées par les raies. La boucle est bouclée.
Les observations de Seura remarquent que les larves de 0,5 millimètre sont enfermées dans un kyste formé par des cellules épithéliales qui vont se multiplier par division pour former de la nacre perlière. Il note que seules les larves ayant migré dans le manteau ou les chairs donneront une perle.
À cette même époque Herdman et Hornell décrivent un cestode d'une autre espèce dans des moules d'eau douce du Sri Lanka
* Amphistome : Ver plat trématode, dépourvu de système digestif, il skate l'appareil digestif d'un individu en se nourrissant de la digestion de son hôte.
** Cestode : Parasite à corps plat, segmenté et aspect rubané. Les cestodes sont spécialisés dans le parasitisme avec des organes de fixation sur l'hôte et absence de tube digestif. Ce sont des méso parasites. Les segments ont pour fonction de produire des œufs (jusqu'à 5000 œufs par jour). [Wikipédia].
LES PERLES D'EAU DOUCE...
De formes, de tailles et de couleurs très variées, elles ont un rapport qualité/prix très intéressant et leur place sur le marché est en croissance constante. Produites par des moules des espèces, Hyriopsis schlegeli et Hyriopsis cumingi et leurs hybrides.
Les changements dans la perception des perles de culture d’eau douce ont été spectaculaires. Autrefois considérées comme inférieures aux perles de culture d’eau salée, leur qualité s’est tellement améliorée qu’elles sont maintenant favorablement comparées aux perles de culture d’eau salée.
Elles sont élevées de 8 mois à 5 ans.
La taille des perles varie de 2 à 10 mm.
La production japonaise est aujourd'hui plus restreinte, mais a connu une extension relative dans le passé. Les perles de Biwa, désignent souvent abusivement toutes perles cultivées au Japon et croissant dans une moule d'eau douce. Le nom devrait être réservé aux perles du lac Biwa, au Japon.
Les perles de culture d’eau douce sont produites principalement en Chine (1 500 tonnes/an) dans les lacs, les étangs et les rivières. Elles se développent dans une variété de formes et de couleurs naturelles, y compris le blanc, l’orange, la lavande et le violet. Elles sont également teintées dans un large éventail de couleurs. Les concepteurs aiment la variété des couleurs et des formes et créent des colliers de perles de culture parfois variés dans la taille et la couleur.
Il existe également une ferme à but principalement touristique au Tennessee.
Les moules peuvent produire jusqu'à 50 perles en même temps. Le nucleus est constitué de minuscules morceaux de coquillage, ce qui produit des perles de nacre pure.

Hyriopsis cumingii.
Le cycle de vie original des moules perlières de Bretagne
Margaritifera margaritifera,
qui peuvent vivre plus d’un siècle.
Voir ici : https://www.life-moule-perliere.org/un-cycle-de-vie-original.php

LES PERLES AMPOULES ("blister" en anglais).
Les huitres ont des prédateurs, certains ne sont pas capables de les briser, comme on l'a vu avec les raies, ils vont devoir s'introduire dans le coquillage et certains le font en perforant la coquille. L'huitre agressée ainsi, a un réflexe de défense, qui consiste a créer de la coquille sous forme de protubérance pour empêcher l'intrus de la pénétrer, et parfois a l'emprisonner dans le kyste.

LE NUCLEUS DES PERLES DE CULTURE
Mon propos sur cette page était de parler des perles naturelles, toutefois, il est important de dire que la majorité des perles commercialisées sont des perles de culture obtenues par implantation d'un nucléus dans une perle qui produira de la nacre autour de cet intrus.
Qui mieux qu'un producteur de perles de culture de Tahiti pourrait nous parler de ces intrus que sont les nucléus.
Les textes suivants sont donc empruntés à Thierry Janoyer producteur à la ferme perlière Manihi en Polynésie Française, qui m'a courtoisement autorisé leur publication.
"Le nucleus qui est le cœur de la perle est une bille manufacturée taillée dans du coquillage.
Différents types de coquillages peuvent être utilisés pour fabriquer cette bille nacrée.
La grande majorité des nucleus commercialisés proviennent de la coquille très épaisse d’autres mollusques, généralement de moules d’eau douce du Mississippi et de la rivière Tenesse."

"Les coquilles de ces mollusques sont choisies pour leur propriétés similaires à notre huître perlière, la Pinctada margaritifera.
Sa composition chimique, sa force de liaison et ses propriétés de résistance à la chaleur sont similaires à celles de la nacre.
Ces coquilles sont exportées vers le Japon. Elles seront transformées en perles sphériques de différents diamètres par découpe, meulage, façonnage et polissage à l’aide de machines et d’outils appropriés.
La précision dimensionnelle, la finition lisse et le polissage élevé sont des facteurs importants.
Les nucleus doivent être nettoyées et stérilisés avant utilisation pour éviter toute contamination qui pourrait affecter la santé des huîtres perlières et faire échouer la greffe."

Tahiti Perles Créations : https://tahiti-perles-creation.fr - https://www.facebook.com/profile.php?id=100063561278173
Une page sur les caractéristiques couleurs et formes, les imitations, synthèses et traitements sera rédigée et mise en ligne.
Merci de votre patience !