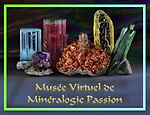ROCHES SÉDIMENTAIRES
"Si elles ne représentent que quelques pourcents des roches totales, ce sont sur ces roches que nous marchons ! Les roches sédimentaires constituent en effet la couche la plus superficielle de la Terre. Elles proviennent du démantèlement d'anciennes roches par érosion et sédimentation."

JJ Chevallier 2013
LES SÉDIMENTS
Les produits de l'érosion sont donc les sédiments.
Un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, l'atmosphère ou la glace et qui a fini par se déposer sous l'effet de la gravité, souvent en couches ou strates successives. Un sédiment est caractérisé par sa nature (composition physicochimique), son origine qui peut être peut être fluviatile, glaciaire, lacustre ou marine, sa granulométrie, les espèces qu'il contient.

SÉDIMENTATION
LES MILIEUX DE SEDIMENTATION
Le principal milieu de sédimentation est le milieu aquatique et plus particulièrement l'océan mais des sédiments peuvent se former sur le continent.
En région continentale
Sur les glaciers : ce sont les moraines (ou tills) qui sont caractéristiques. Il s'agit de dépôts très hétérogènes riches en particules fines mais aussi en gros blocs, le tout non classé. On peut noter également des dépôts périglaciaires :
-
les varves qui sont des dépôts rythmiques de fines particules au fond des lacs glaciaires,
-
les loess, formés à partir de poussières issues des boues de fonte qui s'accumulent à la suite de l'action du vent.
Dans les milieux désertiques, ce sont les dépôts éoliens qui constituent la majeure partie des sédiments actuels. Les roches sédimentaires d'origine désertique sont caractérisées par des grains sableux arrondis et dépoli (rond-mat) bien classés et à matrice argileuse pauvre et des galets à trois faces dépolies, les dreikanthers. Les dépôts de sables forment les dunes (nebka, barkhanes, seifs, ergs...). Les régions d'accumulation des sables alternent avec des régions dénudées. L'accumulation, en périphérie des régions désertiques, des fines poussières forment également des lœss.
Les dépôts fluviatiles torrentiels sont caractérisés par une stratification croisée avec un granoclassement subhorizontal. Les dépôts de fleuves sont constitués de limons, déposés de part et d'autre du lit lors des crues.
Pour les lacs, il existe une stratification thermique nette des eaux (présence d'une thermocline). Les eaux fluviatiles restent dans la partie superficielle du lac, elles sont plus chaudes (et donc moins denses). Ainsi plus les particules sont petites, plus elles seront amenées au large, d'où une sédimentation caractéristique. Pour les lacs recevant les eaux de glacier, ce phénomène entraîne la formation de varves : L'été, les grosses particules transportées par les eaux de fontes se déposent au fond du lac, et les petites particules restent en suspension, au-dessus de la thermocline. L'hiver, il n'y a plus d'apports fluviatiles (tout est gelé), seules les particules fines en suspension se déposent en une couche peu épaisse. Chaque année on peut donc observer une alternance dans la sédimentation. Les varves permettent de dater (relativement) les terrains où elles se trouvent.
Dans les parties profondes du lac, se déposent des turbidites contenant des éléments grossiers.
Dans les lacs froids, l'évaporation étant modérée des sursaturations peuvent avoir lieu entraînant des dépôts par précipitation de calcite (si l'activité organique est suffisante il y a libération de CO2). On peut noter également des dépôts chimiques et biochimiques (Travertins, Tufs et évaporites) dans certaines conditions (minéralisation de substance organique ou évaporation intense).
Les dépôts lagunaires peuvent être carbonatés (concentration en Ca après évaporation, puis précipitation de CaCO3 et dolomitisation du haut fond) ou gypseux (la concentration est plus poussée, du gypse, CaSO4 2H2O, se dépose puis si le phénomène continue il peut se déposer du NaCl).
Les dépôts de deltas se font par progradation avec un granoclassement, mais on peut distinguer 2 types de dépôts :
-
Quand les eaux fluviatiles rentrent dans des eaux calmes, où la quantité de sels provoque une augmentation de densité, elles sont dispersées latéralement au-dessus des eaux marines. Le dépôt de sable est accentué en bordure, les particules en suspensions se déposent par décantation. (hypoclinal)
-
Quand les eaux fluviatiles sont froides et denses, la dispersion est de type turbide (Hyperclinal).
En région océanique
Les dépôts détritiques de plate forme sont classés, répartis, étalés par les marées, les vagues et les courants littoraux et de plateaux. On y trouve les dépôts amenés par les fleuves, le vent mais aussi des sédiments biochimiques et biologiques ainsi que des constructions d'organismes (récifs correspondant à des températures de 20 à 35 et à des profondeurs faibles mais à eaux agitées permettant une bonne oxygénation). On distingue 2 zones :
-
la zone infratidale qui accueille les sables et les boues (micrites),
-
les haut-fonds où l'on trouve les oolithes.
Une sédimentation mixte peut avoir lieu (silico-carbonaté) comme dans le bassin Parisien au crétacé : la silice, dissoute par latéritisation au niveau du continent, précipite en mer car l'évaporation est intense, elle forme alors des "nodules" autour de tests siliceux d'organismes morts dans les sédiments carbonatés, les fameux silex.
Les dépôts au niveau du talus et du glacis sont principalement détritiques (mais également planctonniques et biochimiques). C'est à ce niveau qu'ont lieu les slumps et les arrachages par courants de turbidités.
Au niveau des bassins la sédimentation détritique devient plus localisée (selon les courants marins et éoliens). La sédimentation chimique, biochimique et biologique est de type carbonaté dans les eaux peu profondes (-4000 m maximum) ou chaudes, en effet en eaux froides la dissolution de calcaire est plus facile, et au-delà de -4000m (limite de compensation des carbonates) il y a dissolution, en raison du froid. A ce niveau se sont des sédiments siliceux qui se déposent (radiolaires, diatomées en zone froide). Pour les grands fonds, ce sont des argiles rouges d'origine détritiques que l'on retrouve, le reste étant dissout au cours de la descente.
La théorie de Bio-rhexistasie
Durant les périodes où le climat est stable (Biostasie), les ions solubles (Ca, Na, K, Mg, Si) sont lessivés sous le couvert végétal et entraînés par les cours d'eau (limpides) jusqu'à la mer. Cela abouti à des dépôts calcaires et dolomitiques, de nature biochimique et chimique.
Lors de modifications climatiques (Rhexistasie), le couvert végétal est détruit, il n'y a plus de rôle filtreur et l'érosion est intense. Les fleuves sont boueux, chargés en argiles, sable et sédiments ferrugineux. Ceux-ci vont se superposer aux calcaires et dépôts organiques précédents, les sédiments sont de plus en plus détritiques.
DIAGENÈSE
Les transformation chimiques, physiques et biochimiques que subissent les sédiments sont appelé diagenèse. C’est le résultat de l’action, de plusieurs facteurs sous différentes combinaisons, sur les sédiment qui se déposent à la surface du globe ou au fond des océans.
DU SÉDIMENT Á LA ROCHE LA DIAGENÈSE
Les sédiments sont généralement d'origines détritiques (débris d'anciennes roches) mais ils peuvent comporter également, en plus ou moins grandes quantités, des restes d'organismes vivants (fossiles) le plus souvent microscopiques et/ou des minéraux apparus par transformations chimiques. On fait donc la distinction, selon le pourcentage de chacun de ces éléments entre roches détritiques, biochimiques et chimiques. Les sédiments, une fois déposés, sont généralement meubles et riches en eau. la diagenèse va correspondre à leur transformation chimique, biochimique et physique pour former des roches.
Cela se fait en plusieurs étapes, plus ou moins respectées selon la nature du sédiment :
En surface :
Action des êtres vivants : Les animaux fouisseurs favorisent le mélange des sédiments fins. Protozoaires et bactéries interviennent dans la dolomitisation, la formation des phosphates, de la pyrite, du pétrole, des charbons. Leurs rôles sont donc loin d'être négligeable.
Pédogenèse : Elle intervient dans la formation de roches meubles (argile à silex, latérites) et de roches dures (grès, meulières). Par exemple la silice dissoute sous climat humide peut cimenter les sables en grès lors des saisons plus sèches.
Dissolution : Concerne les sédiments émergés. Les parties superficielles du sédiment sont dissoutes par action de l'eau et entraînées en profondeur (poupées du loess).
Déshydratation : Lorsqu'un sédiment aquatique est asséché, il y a durcissement et modification de ses propriétés physiques
En profondeur :
Cimentation : Les éléments dissous par l'eau peuvent, en précipitant, cimenter les particules du sédiment entre elles. On parle aussi de lithification.
Concrétionnement : Ce sont des accumulations de minéraux particuliers ayant lieu au cours du dépôt sédimentaire, ou ultérieurement. Selon leur forme, elles portent plusieurs noms : les sphérolites, les nodules, les géodes, les septarias.
Epigénisation et métasomatose : L'épigénisation correspond à la transformation d'un minéral préexistant en un autre de même composition. Il s'agit souvent d'un changement dans la structure du minéral. Par exemple, l'aragonite, contenue généralement par les tests calcaires d'organismes, se transforme en calcite.
La métasomatose a lieu à plus grande échelle et correspond à la substitution d'un minéral à un autre sans changement de volume. Par exemple le CaCO3 est parfois remplacé par du sulfate de fer (ammonites pyriteuses).
Compaction : Sous l'effet de la pression des sédiments sus-jacents il y a départ d'eau. Dans un premier temps l'eau en grande quantité tend à fuir sous l'effet de la charge supportée. Dans un second temps ce sont les grains qui se réarrangent de façon à supporter cette charge, il y a tassement.
CLASSIFICATION DES ROCHES SEDIMENTAIRES
Selon l'origine et la composition des roches sédimentaires on peut établir un classement assez précis.
Roches détritiques
Rudites : Ces roches possèdent une majorité de particules dont le diamètre est supérieur à 2 mm
roches meubles : Les particules ne sont pas soudées. Ce sont les blocs (>20 cm), les cailloux (>2 cm), et les graviers (> 2 mm).
roches consolidées : Les particules sont soudées par un ciment. Ce sont les brèches (éléments anguleux) et les poudingues (éléments arrondis)
Arénites : Grains, minéraux compris entre 50 mm et 2 mm
-roches meubles : Ce sont les sables (de quartz, feldspath, muscovite, calcite, glauconie, ... )
-roches consolidées : Ce sont les grès, c'est à dire des sables dont les grains se sont cimentés. Cette cimentation a pu être provoqué lors de la pédogenèse sous l'action de l'humus, ou en raison des fluctuations du niveau de la nappe phréatique qui favorise la précipitation du quartz ou encore à cause d'apports ioniques extérieurs.
-Les arkoses, grès grossiers (Grains anguleux, feldspath >20 %)
-Les Grauwackes, grès sombres à ciment argileux (origine marine ou orogénique)
-Les molasses, grès mixtes à calcite, quartz et tests (origine lacustre ou littorale)
-Les grès micacés, siliceux, calcaires
les quartzites
Les intraclastes sont des grains anguleux, les pellets des grains arrondis.
Pélites ou lutites : Essentiellement siliceuses, les grains font moins de 50 mm
Les minéraux sont généralement des argiles, des micas, des quartzs, de la calcite, des tests
Le ciment est souvent de la calcite.
On distingue :
-les pélites,
-les loess (argile + calcite + quartz),
-les marnes.
Roches chimiques et biochimiques
Roches chimiques
Les roches chimiques ne sont formées que par des dépôts minéralogiques indépendant de l'action d'êtres vivants contrairement aux roches biochimiques.
Les roches carbonatées
continentales : ce sont les dépôts formés généralement par précipitation à la suite d'une diminution de la pression de CO2, d'une augmentation de la concentration en Carbonate de calcium ou encore quand la température s'élève. Cela aboutit à la formation des stalactites et stalagmites ainsi que des tufs et travertins (dépôts de sources pétrifiantes). Il ne faut pas oublier les calcaires lacustres.
marines : ce sont
• les calcaires oolithiques (petites concrétions qui se forment dans les mers agitées et chaudes),
• les calcaires marneux et les marnes (mélanges plus ou moins important d'argile et de calcaire. Un apport détritique peut intervenir dans leur formation). Indiquent généralement un milieu de formation peu profond.
• Les dolomies, I (MgCa)2CO3 ou II (la majorité des dolomies est secondaire à calcite, aragonite et giobertite). La dolomitisation peut se faire pendant la diagenèse, dans ce cas c'est la giobertite (MgCO3) qui remplit les pores du ciment. Après la diagenèse, c'est lors de la rencontre entre eaux interstitielles différentes (lagune, eau douce) que se produisent les remplissages, mais surtout un échange de Ca avec Mg qui donne les dolomies II (les structures deviennent peu visibles).
Les sparites correspondent à un ciment grossier tandis que les micrites correspondent à un ciment fin.
Les roches siliceuses : Glauconite, tripoli, silex, meulières diagénétiques
Les évaporites : roches salines provenant d'un lessivage continental ou d'une évaporation lagunaire.
-Gypse (Température inférieure à 20°C) ou anhydrite (> à 20°C)
-Sel gemme
Roches biochimiques
Elles sont formées par accumulation de squelettes, de tests ou de constructions d'êtres vivants :
Calcaires d'accumulation (craies à coccolithes, à foraminifères, à entroques, coquilliers)
Calcaires construits ou récifaux : Ils sont formés par l'accumulation, quasiment sur place, des squelettes des organismes constituants les récifs coralliens.
Roches siliceuses :
-radiolarites (eaux tempérées)
-spongolites (spicules d'éponges)
-diatomites (eaux froides)
Roches d'origine organique
Charbons : Accumulation de débris végétaux qui sous l'action de micro-organismes anaérobies s'enrichissent en carbone (destruction de cellulose). Il y a dépolymérisation puis polycondensation des composés en acides humiques et fulviques.
On distingue :
Les tourbes (C < 50%)
Les lignites (50 < C < 70%)
Les houilles (70 < C < 90%)
L'anthracite (C 90%)
Ces accumulations peuvent se faire dans des lacs (bassins limniques) de montagne ou en bordure de mer (bassins paraliques). Les transformations nécessitent un climat chaud et humide.
Pétroles : Après l'accumulation de débris organiques en milieu aquatique plus ou moins confiné, il y a transformation des lipides et protéines en hydrocarbures par des micro-organismes. C'est une diagenèse biochimique qui a donc lieu et qui aboutit à la formation de kérogènes (macromolécules polymérisées insolubles dans les solvants organiques). En même temps, il y a libération de méthane en petite quantité et de protopétrole qui évoluera en pétrole par perte d'azote et d'oxygène sous forme de CO2.
La phase de catagenèse qui suit, à plus grande profondeur (température de 60°), voit la transformation du kérogène en hydrocarbures. Si la température augmente (150°) il ne restera plus que du gaz sec et du méthane.
Le pétrole formé par catagenèse s'accumule dans les parties poreuses de la roche mère mais tend à monter d'où la nécessité d'un toit imperméable (une couche argileuse par exemple) pour conserver le gisement et d'une roche poreuse pour retenir le pétrole.
Bitumes : Il s'agit d'une forme plus ou moins solide d'hydrocarbure, liée soit à des calcaires soit à des schistes. Ces hydrocarbures peuvent, après traitement, fournir du pétrole exploitable.

CYCLES SÉDIMENTAIRES
Sédimentation et roches sédimentaires marines (les plus courantes) se forment sur de longues périodes. Si les dépôts peuvent faire plusieurs centaines de mètres, la roche qui en résulte n'est pas homogène. Elles montrent des couches ou strates, témoins de cycles sédimentaires.
Le niveau marin et la sédimentation
Le niveau marin n'est pas stable, il subit des variations (ou eustatisme).


Les transgressions
Quand le niveau marin s'élève, on parle de transgression. Les dépôts sont caractéristiques :
• Les dépôts sont de plus en plus étendus.
• En bordure de continents (zone intertidale) les dépôts sont grossiers. Lors d'un sondage, les dépôts seront donc de plus en plus grossiers vers le bas.
• Le retrait de l'eau laisse de nombreuses lagunes où se forment des évaporites.

Les régressions
Le niveau marin s'abaisse. Les dépôts présentent les caractères suivants :
• Les dépôts sont de moins en moins étendus, ils laissent à découvert la partie la plus continentale des dépôts antérieurs.
• Le retrait de l'eau laisse de nombreuses lagunes où se forment des évaporites.

Les causes
Le niveau marin peut subir des variations réelles ou relatives :
Réelles : c'est le cas lors de glaciation ou de fonte des glaces,
La formation d'un nouvel océan implique la disparition d'un plus ancien. Or la croûte océanique jeune est beaucoup moins profonde qu'une vieille croûte.
Les collisions, distensions entraînent une perte ou une augmentation du volume marin.
Relatives : c'est en fait le continent ou le fond marin qui s'enfonce ou s'élève
L'isostasie : la croûte repose sur le manteau comme un poids peut reposer sur une éponge humide, elle s'enfonce en partie dans son support. Lors d'une orogenèse,
l'épaisseur de la croûte augmente, elle s'enfonce donc d'autant plus dans le manteau. Quand les montagnes ont été érodées, un mouvement de rééquilibrage fait remonter la croûte. Le continent s'élève donc par rapport au niveau marin.
On peut observer un phénomène similaire avec les périodes de glaciation. Le sol de Scandinavie, autrefois recouvert d'une forte épaisseur de glace, est encore en train de s'élever par réajustement isostatique à raison d'1 m par siècle !
La subsidence : Une croûte océanique ancienne, est plus froide et plus dense qu'une croûte récente, elle tend donc à s'enfoncer dans le manteau.
Les flexures : Lors de la formation d'une dorsale, la plaque lithosphérique se courbe sous l'effet du magma sous-jacent. Lors de la rupture de la plaque, les marges s'élèvent par déséquilibre. Il faut avoir à l'esprit que les roches peuvent avoir un comportement "élastique" sous l'effet d'une force pendant plusieurs milliers d'années.
Les cycles sédimentaires
On distingue :
-des cycles de 1ers ordres supérieurs à 50 millions d'années, ils sont dus à la fragmentation de la terre.
-des cycles de 2èmes ordres de 3 à 50 millions d'années, ils sont liés à la vitesse d'ouverture des océans.
-des cycles de 3èmes ordres de 0, 5 à 3 millions d'années, ils sont liés aux variations climatiques
-des cycles de 4èmes ordres de 10 000 à 500 000 ans, (cycle de Milenclovich)
-des cycles de 5 et 6èmes ordres, à l'échelle de l'année (varves) ou journaliers (stromatolites, marées)
Tous ces cycles sont emboîtés les uns dans les autres.
Ils se caractérisent par une phase d'accumulation intense puis une phase d'accumulation réduite voire nulle.
LES SÉRIES SÉDIMENTAIRES
Elles correspondent à la succession des couches sédimentaires. Si toutes les couches sont présentes on parle de série continue, s’il manque une ou plusieurs couches on parle de série discontinue.
Les discontinuités
Ces lacunes sédimentaires peuvent être dues à :
-une émersion (ou une régression marine). Elle se signale souvent par la présence d'une érosion continentale.
-une sédimentation bloquée : La formation d'un haut-fond créée des courants marins forts qui empéchent la sédimentation d'avoir lieu en bordure de cette colline marine. La surface du haut-fond est durcie par les courants ce qui limite l'érosion. Cela constitue un hard ground.
Discordances et contact anormal
Si aucun phénomène n'a perturbé la sédimentation, les couches doivent être parallèles entres-elles. Cela définit la concordance des couches.
Quand une couche n'est pas parallèle aux autres, il y a discordance. Les discordances sont généralement liées à la tectonique. Il s'agit souvent de simple basculement des dépôts antérieurs suivi d'une émersion (et donc la formation d'une discontinuité dans la série sédimentaire).
Un contact anormal provient d'un chevauchement, d'un pli couché, ou d'une nappe de charriage qui recouvre un terrain pouvant appartenir à une autre série sédimentaire.
RYTHMES SÉDIMENTAIRES
Une strate à deux origines possibles : une discontinuité dans le dépôt ou un changement dans la nature de ce dépôt sédimentaire.
Formation des alternances calcaire/marne
Mécanisme
Le calcaire se forme s'il y a un apport suffisant en CaCO3 par rapport aux argiles dans le milieu de sédimentation. Cet apport est lié à plusieurs facteurs :
-la production planctonique (conditionnée par les courants océaniques, les Upwellings, courants de fond, qui permettent le recyclage de l'eau et de matières organiques).
-la dilution du CaCO3 par l'apport d'argile d'origine terrigène.
-la dissolution du CaCO3 : la limite de compensation de dissolution des carbonates (CCD) est variable selon la température et la composition de l'eau.
-Le climat.
-Il agit sur les upwelings : dans les hautes latitudes l'eau tend à descendre en profondeur.
-Les carbonates tendent à se former dans les eaux chaudes.
-Il faut tenir compte également de la disponibilité du CaCO3 dans les océans : Au jurassique et crétacé la production de carbonates est importante sur les plates formes océaniques car l'activité biologique est développée. C'est le niveau marin qui a contrôlé les transgressions / régressions en fonction du climat (un climat humide tend à piéger l'eau sur le continent par infiltration).
Facteurs faisant varier les climats
Ce sont principalement les facteurs astronomiques (paramètres orbitaux de la Terre).
Le climat dépend du rayonnement de la Terre (Glaciations)
Mais des variations climatiques faibles agissent aussi sur la sédimentation : Au crétacé l'obliquité de la Terre permet une amplification des phénomènes climatiques, qui seront eux même amplifiés par les variations de précipitations. Ces phénomènes sont toutefois trop rapides pour être décelés par les fossiles.
Perturbations
Par la diagenèse
Par les discontinuités (absence de sédimentation) : Arrêt de production de CaCO3 par diminution de l'O2 disponible pour les organismes, érosion dû à des courants de fonds, intercalation de niveaux étrangers (turbidites), résultat de tempête
Exemple de dépôts moins profonds
Ils sont à la limite mer / terre, les faciès vont changer rapidement. Contrairement aux faciès de bassins, plus monotone, on aura une succession de faciès différents qui vont se répéter dans le même ordre, c'est une séquence.(ex une série de 3m représentant 20 000 ans se répète sur 16 millions d'années, toutes les 7 séquences on constate des érosions plus fortes c'est un cycle de 100 000 ans.) Quand il n'y a pas de dépôts de sédiments on parle de By-pass.
PHOTOS