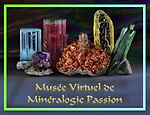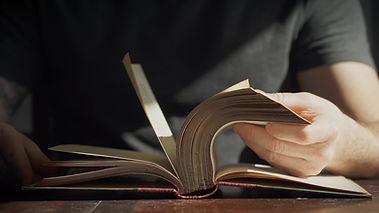


Une une interview de Monsieur Yves Lulzac, février 2020
par Laurence Jezequel, journaliste indépendante
Yves Lulzac est un ancien géologue minier qui a fait toute sa carrière au BRGM, à travers le monde. Il est à l'origine de la découverte de la Lulzacite, un phosphate de strontium, qu'il a découvert à St Aubin des Châteaux, Loire-Atlantique, en 1997.Gemmologue de laboratoire à ses heures, il a rédigé un manuel de gemmologie qui fait autorité dans le monde entier. Breton, il est aussi l'auteur de cinq ouvrages sur les manoirs Bretons.
Un orpailleur de la ruée vers l'Or aux
État Unis à la fin du XIXème siècle.
Laurence Jezequel
Ayant appris que la recherche de l’or dans les rivières de France était le passe temps favori d’un nombre de plus en plus important de mes concitoyens, j’ai voulu en savoir un peu plus sur cette activité qui ne m’est guère familière bien que j’en ai déjà entendu parler, ne serait-ce qu’à la suite de mes lectures de jeunesse concernant les anciennes « ruées » sur l’or de Californie ou du Klondike sur le continent nord américain.
Pour mener à bien mon enquête, je me suis donc tournée, une fois de plus, vers Jean-Jacques Chevallier pour obtenir de la documentation. Comme il se trouvait aux Etats-Unis il m’a orienté vers Monsieur Lulzac, que j’avais déjà rencontré à propos de l’Arsenic et qui a passé le plus clair de sa vie professionnelle sur le terrain dans le cadre de la division minière du B.R.G.M. (Division Massif Armoricain). Sachant que cet organisme a pratiqué de très nombreuses prospections alluvionnaires orientées sur la recherche de l’or et beaucoup d’autres métaux utiles à nos industries.
C’est donc à son domicile nantais qu’il m’a reçu afin qu’il éclaire ma lanterne sur ce point précis de la prospection minière.

Pépites d'or;
Source : https://pngimage.net)
YL. Je vois que la prospection des minerais vous tient toujours à cœur malgré vos affinités écolos qui devraient plutôt vous inciter à ignorer ce genre d’activité diabolique. Et si j’ai bien compris, vous voudriez savoir comment on peut récupérer des pépites d’or dans les rivières bretonnes ?
LJ. Non, je n’ai jamais dit que votre ancien métier avait une connotation diabolique car c’est un point de vue que je ne partage pas obligatoirement avec certains de mes amis écologistes. En fait, j’aimerais savoir si cet orpaillage que l’on pratique en France à l’heure actuelle, est une activité sérieuse ou un simple passe temps à la mode. Et dans ce domaine, je pense que les anciens agents du BRGM sont très qualifiés pour me renseigner car ils auraient pratiqué ce genre d’activité pendant un certain temps.
YL. En effet, les prospections de base pratiquées au BRGM dans les années 50 et 60, consistaient à explorer les alluvions du réseau hydrographique armoricain. A cette époque, tous mes collègues, et moi-même, savaient manier la batée (en réalité le pan américain), ainsi que la pelle bêche pour prélever les alluvions au fond des ruisseaux. Mais ce n’était pas pour chercher principalement de l’or, ce métal qui ne nous faisait pas particulièrement rêver. C’était pour faire l’inventaire de tous les minéraux utiles pouvant être valorisés, par exemple la cassitérite, la wolframite, le rutile, le zircon, etc.
Quant à l’orpaillage, je dois tout de suite mettre les choses au point : Si l’on peut effectivement récupérer de l’or dans les cours d’eau bretons, ce ne sera jamais en quantité suffisante pour assurer vos fins de mois. Ceci dit, vous aurez quand même la satisfaction de découvrir un peu de ce métal magique, ce qui vous dédommagera de vos courbatures consécutives au maniement de votre batée !
LJ. Mais, sans entrer dans les détails, comment se pratiquait cette prospection alluvionnaire au BRGM ?
YL. Avec en main la carte IGN au 1/50.000, nous devions effectuer un prélèvement d’alluvions dans tous les cours d’eau du Massif Armoricain, ces prélèvements étant équidistants d’un kilomètre, ou de 500 mètres dans certains cas. Ils se faisaient toujours dans le lit du ruisseau, ce que l’on nomme le lit vif, et leur volume était de deux fois 5 litres de sable « débourbé » et tamisé à la maille de 5 millimètres. Il s’agissait donc d’une alluvion débarrassée de son argile et de ses gros éléments qui auraient été gênants pour la bonne exécution du bateyage. Bien entendu, seuls les cours d’eau facilement accessibles étaient concernés, ce qui excluait les rivières telles que le Blavet et l’Oust, par exemple. Mais c’était bien suffisant pour avoir une bonne idée des possibilités minéralogiques des bassins versants.

LJ. Mais que faisiez-vous de ce sable et de ces gros éléments qui ne passaient pas dans les mailles de vos tamis ?
YL. Bien sûr, avant d’être rejetés, les gros éléments étaient rapidement examinés au cas où il y aurait eu un quartz minéralisé ou un gros cristal de cassitérite, ou encore une grosse pépite d’or !... Mais, malheureusement, cela ne s’est jamais produit !...
Quant au sable, il était traité sur place au pan américain. Le concentré lourd ainsi obtenu, concentré généralement de couleur noire, était mis en tube plastique, pour être ensuite expédié au laboratoire de traitement des minéraux alluvionnaires.
LJ. Votre principal outil de prospection était donc le pan américain et non pas la batée ?
YL. Oui, dès le début de nos recherches, nous avions adopté le pan américain plutôt que la batée classique, aussi appelée « chapeau chinois ». En effet, le pan, de par sa forme, permettait d’y faire le débourbage et le tamisage sans l’aide d’un quelconque récipient intermédiaire. De plus, son maniement est simple et peut s’effectuer avec un minimum d’eau. A l’extrême, il nous arrivait même parfois d’effectuer le finissage dans un autre pan.
LJ. Mais qui vous avait enseigné l’art du bateyage ?

Le Pan américai ou batée plus pratique que le "chapeau chinois."
(Photo : Atelier La Trouvaille)
YL. Tout simplement mon patron qui l’avait pratiqué à Madagascar. D’autres collègues l’avaient appris à l’occasion de leurs prospections en Afrique ou en Guyane. Ceux ayant travaillé en Guyane pratiquaient le « chapeau chinois », mais une fois intégrés aux équipes armoricaines, ils se sont vite adaptés au pan qu’ils jugeaient plus fiables au moment de la finition. Mais il faut dire que notre bateyage consistait à récupérer l’intégralité des minéraux « lourds » contenus dans les alluvions. Ce qui nous obligeait à être très vigilent pour ne pas perdre les minéraux de densité moyenne, comme les tourmalines par exemple. Donc, rien à voir avec le bateyage rapide des chercheurs d’or dont le seul but est de récupérer ce minéral de très forte densité et qu’on a peu de chance de perdre. Sauf parfois au moment de la finition car l’or peut avoir tendance à « flotter » en fonction de la forme des grains, surtout quand ils sont aplatis (les fameuses « paillettes » d’or ! ...).
LJ. Mais si je voulais orpailler, comment ferais-je pour apprendre à me servir d’un pan ?
YL. Dans tous les cas, il vaut mieux se faire montrer le mode d’emploi, sur le terrain de préférence, et non pas se fier aux explications livresques plus ou moins compréhensibles malgré la bonne volonté des « spécialistes » en la matière.
Il faudrait donc vous mettre en relation avec une personne possédant une bonne expérience dans ce domaine. A l’occasion je pourrais vous montrer les principes de base sans que nous soyons obligés d’aller sur le terrain. Autrement, je connais, non loin de Lorient, un ancien chercheur d’or, compétent et sérieux, ayant prospecté à Madagascar et qui, depuis, accompagne volontiers sur le terrain des personnes désireuses d’apprendre cet art, comme vous dites. Si vous le désirez, je pourrais lui en parler.
LJ. Oui, pourquoi pas. Mais si je voulais moi-même tenter l’aventure de l’orpaillage, comment devrais-je m’y prendre, et où aller pour avoir le plus de chances possible de tomber sur le bon coin ?

Jacques Le Quéré est chercheur d’or professionnel en Bretagne.
(Photo : Thomas Bregardis/Ouest-France)
YL. En Bretagne, ou sur l’étendue du Massif Armoricain, rares sont les régions dans lesquelles on ne puisse trouver une petite parcelle d’or. Mais pour savoir dans quelle région se rendre pour avoir des chances de récolter quelques « paillettes », comme l’on dit, le mieux que vous ayez à faire est de consulter l’ouvrage paru aux éditions BRGM en 1969 intitulé « La prospection minière à la batée dans le Massif Armoricain » sous la plume de Jean Guigues et de Pierre Devismes. Y figure une carte où l’on voit les principales zones aurifères susceptibles d’être intéressantes, comme celles de Pontivy ou de Loudéac, par exemple.
Ou encore l’atlas photographique des minéraux d’alluvions élaboré par Pierre Devismes en 1978 et paru dans les mêmes éditions BRGM. Vous y verrez de belles photos !... Si toutefois vous arrivez à vous procurer ces ouvrages car, de nos jours, ils sont malheureusement devenus très rares.
Je pense également à un ouvrage intitulé « A la recherche de l’or en Bretagne », rédigé en 1978 par deux orpailleurs morbihannais, Gilles Trébern et François Marie Baudic. On peut y trouver quelques informations utiles. En réalité, ce que ne disent pas ces deux orpailleurs (qui, en réalité comptaient un troisième larron du nom d’Alain Segond), c’est qu’ils ne pratiquaient pas vraiment l’orpaillage à la batée, mais plutôt la récupération de l’or dans les quelques sablières en exploitation dans les alluvions du Blavet. Le gros volume de sédiments ainsi traités leur avait permis de récolter annuellement quelques kilogrammes d’or sans trop se fatiguer...
LJ. Tout cela est bien beau, mais si je vais, par exemple, dans la région de Pontivy qui est aurifère et où il y a beaucoup de ruisseaux plus ou moins important, à quel endroit dois-je creuser exactement ?

YL. Je ne vais pas vous faire ici un cours de géomorphologie. Mais sachez quand même qu’en Bretagne, et sur l’ensemble du Massif Armoricain, le fond des vallées et vallons, est occupé par des dépôts alluvionnaires disposés, schématiquement, en couches horizontales comprenant de bas en haut :
- Des éléments plus ou moins grossiers formés de blocs, de gravier plus ou moins hétérogène ou de gravillon, avec une certaine proportion de sable, le tout pouvant être lavé et bien propre ou, le plus souvent, mélangé avec une certaine quantité d’argile. C’est dans ce niveau plus ou moins grossier que l’on a le plus de chances de trouver des concentrations de minéraux lourds, dont l’or. A préciser quand même, que ce niveau repose sur de la roche en place qui peut être dure et saine ou bien plus ou moins décomposée et altérée. C’est au contact de cette roche, que l’on appelle « bed rock » que l’or a tendance à se concentrer.
- Une couche plus ou moins épaisse de sable généralement bien lavé ou très peu argileux. Ce sable, qui peut paraître sympathique à première vue, est à éviter car ne contenant que très peu de minéraux lourds.
- Une couche d’argile, généralement très peu sableuse, également à éviter.
- Et enfin, une couche d’humus, ou de terre végétale, qui n’est pas une alluvion à proprement parlé.
Bien sûr, si le fond du vallon est occupé par un cours d’eau, ou ce que l’on appelle aussi un lit vif, celui-ci va entailler la couche d’humus et la couche d’argile, laissant à découvert une partie de la couche de sable et, parfois la couche de graviers sousjacente qui peut également être plus ou moins érodée par le cours d’eau. Ce qui peut signifier que la nature a commencé le travail de bateyage en éliminant l’argile et en amorçant la concentration des minéraux lourds.
En fonction des possibilités d’accès, et munie de l’autorisation du ou des propriétaires des parcelles concernées, vous allez donc vous positionner sur le ruisseau à condition que le fond soit accessible avec une paire de bottes ordinaires. Sinon, vous serez bonne pour le bain de pied !... Et, bien sûr, il faudra vous munir d’une pelle, genre pelle bêche, pour pouvoir prélever un peu de ce gravier supposé aurifère et, si possible, au plus près du bed rock comme je vous ai expliqué précédemment.
Quant à ce bed rock, il vous faudra apprendre à le reconnaître en fonction de la nature géologique du sous sol. Éventuellement, vous pouvez vous aider d’une carte géologique pour avoir une idée plus précise sur sa nature.
LJ. Mais si je ne remarque que ce beau sable bien lavé, cela veut-il dire que ce ruisseau n’est pas intéressant ?
YL. Normalement non, car si vous creusez sous ce sable fin, vous finirez par trouver ce niveau de gravillons argileux ainsi que la roche sur laquelle ils reposent. Et c’est là que vous devrez faire votre prélèvement. Rares sont les petits cours d’eau dans notre région, qui ne présentent pas ce même dispositif alluvial.
À signaler quand même, qu’au cours des siècles, voire des millénaires, le parcours d’un cours d’eau, grand ou petit, a pu varier sur l’étendue de la plaine alluviale (aussi appelée « flat »). Ce qui veut dire qu’il peut y avoir d’anciens lits vifs (aussi appelés « run ») quelque part sous cette plaine alluviale.
Mais, ce que vous devez surtout retenir, c’est que, seule la pratique et l’expérience, vous permettront de bien reconnaître cette stratigraphie alluvionnaire qui, au premier abord, n’est pas toujours facile à interpréter.
LJ. D’accord, mais si je comprends bien, je dois m’intéresser aux seuls petits « lits vifs » d’une région, et laisser tomber les dépôts alluvionnaires plus importants ?
YL. C’est à vous de juger, mais si vous vous sentez capable, avec un outillage adéquat, de faire des trous de 2 ou 3 mètres de profondeur au minimum, soit dans un lit vif, soit au milieu d’une plaine alluviale en dehors du lit vif, je vous souhaite bon courage.
Mais il ne faut pas croire que plus le dépôt alluvial est important et épais, plus la proportion (ou la teneur) d’or récupérable sera obligatoirement plus importante. Elle ne sera peut-être pas identique partout, mais pour le savoir, il vous faudra creuser un grand nombre de petits puits au travers de cette plaine alluviale pour découvrir un éventuel lit vif enrichi mais caché sous les classiques niveaux de sable et d’argile, sans oublier la terre végétale superficielle....
LJ. Mais j’ai lu, dans certaines publications, que l’on pouvait récupérer de l’or dans des failles et des marmites que l’on peut trouver dans la plupart des rivières.
YL. En effet, dans le lit de certains ruisseaux ou rivières, il peut exister des pièges dans lesquels les minéraux lourds peuvent se concentrer. Il peut s’agir de fissures (et non pas de failles) ou de cavités plus ou moins circulaires (les « marmites ») que l’on peut découvrir au bed rock des cours d’eau dont le régime est plus ou moins torrentiel. On les rencontre généralement dans les régions à fort relief où ils sont visibles sans être obligé de procéder au décapage du bed rock. Mais, malheureusement, vous n’avez que très peu de chances de découvrir ce genre de pièges dans les cours d’eau bretons...
Et ne vous fiez pas trop à tout ce que l’on peut raconter ou lire à ce sujet. La plupart du temps, il s’agit de considérations théoriques, sans doute applicables à certains types de terrains, mais qu’il serait hasardeux d’appliquer à l’ensemble des régions françaises.
De même, certains théoriciens de l’orpaillage vous affirmeront qu’il suffit de trouver certains minéraux accompagnateurs (ilménite, certains grenats, zircon, hématite, et j’en passe) dans les alluvions pour être assuré de tomber sur des zones aurifères. Ce qui est inexact car ces minéraux là se rencontrent très fréquemment et ne sont pas génétiquement liés à l’or.
LJ. Et qu’en est-il des plages en bordure de mer. Je pense en particulier à la plage de la mine d’or qui se trouve sur la commune de Penestin, pas très loin de chez moi ?
YL. La plage de la mine d’or en Penestin, entre nous c’est une belle blague !
S’il y a eu autrefois quelques timides exploitation de cassitérite (le principal minerai d’étain) ou bien de sables abrasifs, il n’y a jamais eu d’exploitation d’or. Seulement quelques dizaines de grammes qui ont été récupérées en sous produits lors de ces essais d’exploitations pour l’étain. Normalement, cette plage aurait dû s’appeler « plage de la mine d’étain » plutôt que plage de « la mine d’or ». Mais, évidemment, cette dernière dénomination est beaucoup plus attrayante... L’or fait toujours rêver !
Maintenant, rien ne vous empêche de traiter au pan le niveau de sable noir qui, parfois, est bien visible sur le cordon sableux de la plage mais qui, le plus souvent, est enfoui à faible profondeur dans le sable.
Vous pourrez ainsi, et avec un minimum de bateyage, récolter une grande variété de minéraux, dont des grenats, des saphirs, des zircons, des tourmalines etc., avec en prime quelques grains de cassitérite, mais le tout de taille millimétrique. Et, avec beaucoup de chance, une ou deux « paillettes » d’or.
Mais, un bon conseil, faites ces recherches lorsque la plage est déserte, car si vous tombez sur vos amis écolos, vous serez vite accusée de tous les maux possibles et imaginables !
De toutes façons, le mieux à faire est de récolter quelques litres de ce sable noir et de le traiter chez vous avec de l’eau non salée.
LJ. En effet, ce doit être intéressant de faire ce que vous me dites. Mais dommage que ces minéraux soient aussi petits !...

Paillette d'Or.
(Photo : AFP)
YL. Bien sûr, mais si vous traitez convenablement votre concentré et si vous vous procurez une bonne loupe binoculaire avec un bon éclairage, vous serez émerveillée de voir tous ces beaux minéraux. D’ailleurs, beaucoup d’amateurs minéralogistes, finalement pas trop intéressés par l’or, se sont reconvertis avec bonheur dans la collection de ces micro minéraux. Et, finalement, tout cela à peu de frais.
LJ. Tout à l’heure, vous me disiez que pour repérer d’anciens lits vifs dans les plaines alluviales, il me faudrait creuser des trous en travers de cette plaine. Moi, si je voulais les faire, il me faudrait jouer de la pelle ou de la pioche. N’y a-t-il pas d’autres moyens pour arriver au même résultat sans trop se fatiguer ?
YL. Bien sûr qu’il y a d’autres moyens. Mais là, vous entrer dans le domaine de la recherche minière faisant appel à des moyens techniques qui ne sont plus du domaine de l’orpaillage. Aussi, je vous déconseillerais de vous lancer dans une telle entreprise qui, d’autre part, serait lourde financièrement. Et, de plus, vous seriez obligée d’obtenir une autorisation administrative particulière qui, d’ailleurs, vous serait systématiquement refusée.
LJ. Mais si je trouve de l’or dans les alluvions d’un petit ruisseau breton, je suppose que cet or vient d’une source ou d’un filon quelconque dans lequel je pense qu’il serait possible de trouver de l’or en plus grandes quantités et peut-être même de grosses pépites.
YL. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. En effet, l’or que l’on trouve dans une alluvion peut très bien provenir d’un gîte aurifère situé en amont et enfoui dans les roches de la région. Mais pour le découvrir il vous faudra mettre en œuvre des méthodes de recherche particulières car dans nos régions les gîtes minéralisés, que ce soit en or ou en tout autre métal, n’affleurent pas d’une manière naturelle. Il faudra franchir des terrains étrangers et stériles pour localiser l’endroit exact où se trouve votre filon aurifère. Il vous faudra échantillonner ces terrains, soit par des prospections minéralogiques, de proche en proche, soit par des analyses chimiques systématiques basées sur la recherche directe de l’or ou, beaucoup mieux, sur la recherche de teneurs anormales en arsenic, cet élément qui est très souvent associé à l’or dans ses gîtes primaires.
Vous voyez, ce n’est pas une entreprise simple. De plus, elle ne se soldera pas obligatoirement par un résultat positif’ car l’or a un comportement souvent complexe dans les milieux superficiels. Et, croyez-moi, on en sait quelque chose quand on considère les nombreux échecs enregistrés au cours de nos recherches passées dans le Massif Armoricain !
Donc, encore une fois, et quitte à vous décevoir, je ne vous conseille pas de vous lancer dans une telle entreprise qui réclamerait, en plus d’une certaine compétence, de gros moyens techniques et financiers.
LJ. Bon, n’insistez pas, j’ai compris. Il me faudra donc me contenter de ramasser des paillettes dans les ruisseaux du coin et qui sait, si la chance me sourit, une petite pépite.
D’ailleurs, pour ce qui est des pépites, j’ai entendu dire que certaines personnes parviennent à en découvrir un peu partout dans la nature à l’aide d’un détecteur de métaux. Qu’en pensez-vous ?
YL. Oui, je sais que des échantillons d’or plus ou moins pépitique ont été découverts au moyen de cet instrument. Mais je dois tout de suite vous mettre en garde car, s’il n’est pas interdit de se promener dans la nature avec un détecteur à la main, il n’en est pas de même si vous voulez effectuer une fouille pour récupérer ce que vous avez détecté. Et, bien sûr, sans savoir à l’avance de quoi il s’agit. Vous risquez de vous mettre en infraction pour fouille illégale, que vous soyez sur un terrain privé ou public, avec ou sans l’accord du propriétaire du terrain.
Et j’en connais certains qui ont eu droit à de très sérieuses amendes à la suite de telles prospections.
Dons, un bon conseil, abstenez-vous, de telle recherches, sauf si vous voulez tenter le diable, comme l’on dit !

Recherche de l'or au détecteur.
(Photo : findinnold.org)
LJ. D’accord et enregistré. Mais, finalement, je ne me sens pas l’âme d’une chercheuse d’or.
Et merci encore pour toutes ces précisions qui vont contribuer à me faire une opinion sur ce sujet particulier.
YL. Ce sont plutôt vos amis écolos qui vont vous remercier d’avoir renoncé à martyriser dame nature en essayant de lui voler le peu de métal qu’elle vous offre pourtant d’une manière si généreuse....


La DREAL est l’organisme chargé de contrôler les activités minières en France.
La recherche d'or n'existe pas comme un loisir dans la législation Française. Seul le code minier reconnait l'activité de l'orpaillage mais comme un métier à part entière. C'est pourquoi on dit que le code minier ne s'applique qu'aux professionnels.
Aucune législation en France ne reconnait l'orpaillage de loisir.
L’orpaillage de loisir pratiqué par des non professionnels n’est pas reconnu par la législation française.
C’est le code minier qui légifère la profession de chercheur d’or.
Un particulier qui désire faire de l’orpaillage doit en faire demande à la préfecture de son département sous forme de courrier.
Il devra préciser :
-
avoir pris connaissance des articles ci-dessous et s’engager à respecter :
-
Article L-214-1 du code de l’environnement et ce qui en découle
-
Article L-121-1 du code minier
-
-
le lieu de la recherche, limites amont et aval du cours d’eau ;
-
la période, date de début et de fin de la recherche ;
-
le matériel utilisé, pelle bèche, pan, batée, rampe de lavage (1 mètre maximum), seau, tapis, pompe à main, tamis, en s’engageant à n’utiliser aucun appareillage mécanique.
Il s’engage sur l’honneur à respecter l’écosystème, faune et flore et à remettre le cours d’eau en l'état initial.
Si la recherche s’effectue sur un lieu privé, il faudra y joindre l’original de l’autorisation écrite du ou des propriétaires.
IMPORTANT...!
L’orpaillage est interdit toute l’année :
- dans le Finistère depuis janvier 2019 ;
- dans la Haute-Garonne depuis 2016.