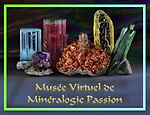L'or de Pénestin, dans le Morbihan,
mythe ou réalité ?
La plage de "La mine d'or"
Source : Web inconnue

Que s’est-il donc passé sur la plage de « la mine d’or » de Pénestin dans le Morbihan ?
Cette étude fait la synthèse des recherches archivistiques effectuées par Bernard Mulot, géologue au BRGM, décédé en 1998. Complétées par Y. Lulzac, et actuellement rassemblées et disponibles dans les archives de l’ex-division Massif Armoricain du BRGM.
Un article de Monsieur Yves Lulzac, mai 2020.
Yves Lulzac est un ancien géologue minier qui a fait toute sa carrière au BRGM, à travers le monde. Il est à l'origine de la découverte de la Lulzacite, un phosphate de strontium, qu'il a découvert à St Aubin des Châteaux, Loire-Atlantique, en 1997. Gemmologue de laboratoire à ses heures, il a rédigé un manuel de gemmologie qui fait autorité dans le monde entier. Breton, il est aussi l'auteur de cinq ouvrages sur les manoirs Bretons.
Une tradition voudrait que du minerai d’étain ait été exploité sur cette plage par les phéniciens dans l’Antiquité, ainsi que de l’or à la fin du XIXème siècle.
En effet, le nom même de Pénestin dériverait des mots bretons « pen » et « stein » signifiant « pointe de l’étain ». Ce qui ne fait pas le consensus parmi les celtisans.
Quant à l’or, il n’a jamais été vraiment exploité car les quelques centaines de grammes qui proviennent de cette plage n’ont constitué que le sous-produit des tentatives d’exploitations d’étain déclarées depuis la seconde moitié du XIXème siècle.
Dans un but de clarification, cet article se propose donc de faire le recensement des nombreuses activités minières qui se sont succédées depuis 1851 jusqu’en 1970.
Activités encouragées par la simplicité de l’exploitation d’un niveau de sables noirs enrichi naturellement en cassitérite et très accessoirement en or, lui-même inclus dans un cordon sableux de bord de mer s’étendant sur une distance linéaire d’environ 1,6 km. Niveau dont l’épaisseur est d’une vingtaine de cm en moyenne et dont l’extension latérale est limitée, d’un côté par le pied d’une falaise, et de l’autre par la haute mer. Il s’agit donc d’un gisement dont l’exploitation ne nécessitait pas de recherches compliquées ni de techniques lourdes d’extraction et de traitement.
La seconde moitié du XIX ème siècle.
Le temps des aventuriers de la première heure.
Tout d’abord, il convient d’émettre un doute sur une éventuelle exploitation de minerai d’étain par les phéniciens dans l’Antiquité. Le soi-disant toponyme évocateur ne fait pas l’unanimité et d’autre part il ne subsiste aucune trace d’une quelconque activité minière antique sur cette plage. Ce qui ne saurait étonner dans un environnement aussi mouvant.
D’après A. Caillaux en 1875, la cassitérite aurait été redécouverte à Pénestin en 1834, mais c’est au géologue Durocher que l’on doit la première étude sérieuse des sables de cette plage. Etude publiée en 1851 et dans laquelle il dévoile qu’un mètre cube de ce sable contient 10 à 15 kg de cassitérite et environ 0,5 g d’or. A signaler que des traces de platine seront également observées par le comte de Limur en 1878.
Puis, on apprend que deux anglais, nommés Wellington et Bonnefin, qui connaissaient la pratique de l’exploitation minière pour avoir travaillé précédemment dans les mines de Cornouailles anglaises, quittent, en fin 1850, le chantier de recherches minières de Piriac, non loin de Pénestin où ils s’étaient fait embaucher. Ils s’associent alors avec un certain E. Godefroy fils, et décident d’entreprendre des recherches d’alluvions stannifères dans la région de Guéhenno faisant partie du district stannifère de la Villeder. Mais, en janvier 1853, ils cèdent leurs droits à Mr. Bronne, le propriétaire de la mine de la Villeder, et décident d’entreprendre des recherches sur la plage de Pénestin à la suite d’informations probablement obtenues au cours de leurs précédents travaux.
En quelques semaines, ils auraient réussi à y extraire 750 kilogrammes de cassitérite.
Mais le maire de Pénestin, Mr. Bouret, leur signifie de cesser tout travail parce qu’ils sont en contravention avec la réglementation française. Ils modifient alors leur statut juridique et vont prospecter dans la région de Sérent, toujours dans le district de la Villeder, pour le compte de E. Godefroy fils, ainsi que de Mrs Dubroc et Massenet, ce dernier étant probablement Alfred Massenet, l’industriel connu pour avoir crée de nombreuses affaires minières, dont la Société Minière de Montbelleux en août 1907…
En mai 1857, la plage de Pénestin fait de nouveau l’objet d’une petite recherche. Non plus pour la cassitérite, mais pour son sable « gemmifère » réputé contenir des minéraux, pouvant être utilisés dans l’industrie des abrasifs, principalement grenats, corindons et zircons. C’est Mr. Cheron, le directeur de la Société Anonyme des Emeris de l’Ouest qui entreprend ces travaux et fait transporter 180 tonnes de sable au port de Tréhiguier.
Travaux probablement effectués en concurrence avec Mr. Renaud de Saint Amour et Mrs. Bailleul et compagnie, mais pour lesquels on ne possède pas de précisions.
A la même époque, l’argile kaolinique également présente dans les falaises de cette plage, fait également l’objet d’un essai d’exploitation par un certain Mr. le Bret. Mais il semblerait que les 30 tonnes de kaolin qu’il parvient à extraire de la falaise soient en grande partie restées sur place.
En 1876, la Société des Emeris de l’Ouest, dont le siège était à Redon (probablement la même que celle qui avait entrepris des recherches en 1857), procède à un échantillonnage sérieux du sable de Pénestin et conclue qu’il contient 60% de quartz et 40% de « gemmes ». A la suite de quoi cette société se voit attribuer une autorisation d’exploitation de sables stannifère, aurifère et gemmifère sur les communes de Pénestin, Houat et Groix pour une durée de 10 ans à compter du 21 mars 1879. Mais il semblerait que cette autorisation n’ait jamais été mise à profit.
En 1888, la société « Caisse des Mines » dirigée par Mr. Ricardo Seaver, effectue des recherches non autorisées qui se seraient avérées infructueuses. On suppose qu’il s’agissait de recherches pour la cassitérite.
Puis, un certain Mr. de Zeppenfeld, demeurant 18 rue de la Douane à Paris, entreprend quelques travaux de recherches dans la falaise de la plage en un lieu où quelques filons de quartz étaient visibles dans les formations schisteuses de la falaise. Mais, pendant l’hiver 1888-1889 un éboulement se produit dans la zone de ses recherches et le contraint à l’abandon. Pourtant, un arrêté daté du 12 mai 1889, lui avait donné le droit de faire des recherches pour or, platine, argent et étain sur les terrains domaniaux de Pénestin pour une durée de 2 ans. Mais, ne voulant pas s’engager dans des dépenses supplémentaires à la suite de cet éboulement, il obtient l’annulation de son autorisation par arrêté du 15 mars 1890.
À la suite probable de ces travaux, un début de galerie était encore visible au nord de la Pointe de Lomer en 1903 et il semble que ce soit depuis cette époque que la plage comprise entre les Pointes de Lomer et de Kerfalher porte le nom de « Plage de la Mine d’Or » ou aussi de « Côte de Californie ».
En 1896, un certain Mr. Urvoy sollicite une demande de concession pour sable stanno-aurifère et kaolin sur les communes de Pénestin, Camoël et Férel. Demande qui, apparemment, n’eut pas de suites.
Première décennie du XX ème siècle.
Le temps des choses sérieuses.
Par la suite, aucune recherche n’est effectuée sur cette plage jusqu’en 1901, époque au cours de laquelle un ingénieur civil des mines nommé Eugène Morineau, demeurant boulevard Raspail à Paris, entreprend des recherches sérieuses sur les sables de la plage et obtient une autorisation de travaux accordée par arrêté du 8 janvier 1902.
Il définit trois zones productives sur la partie découverte de la plage par marée basse en fonction de leur distance par rapport au pied de la falaise. Dans la zone non recouverte par la mer il met à nu le sable noir enrichi naturellement et le transporte au pied de la falaise au moyen de chars à bœufs, puis il le hisse à la pelle jusqu’au sommet de la falaise de la pointe de Lomer par l’intermédiaire de trois paliers. Quant aux zones recouvertes par la mer, il les exploite au moyen d’une drague flottante mais qui l’oblige à extraire également une certaine proportion de sable blanc stérile.
Finalement, le traitement du sable s’opère dans un atelier (laverie) équipé de tables à secousses (tables Wilfley de 240 coups à la minute). Atelier qui lui posa de nombreux problèmes de mise au point et qui ne put fonctionner d’une manière continue qu’à partir de la mi-juillet 1903. En moyenne, à cette époque, son rendement à la tonne de sable brut était d’environ 10 kg de minerai marchand à 43% d’étain métal, et de 147 kg de grenat. Grenat qu’il vend librement car n’étant pas concessible, le minerai d’étain étant considéré comme un sous-produit qu’il vend en Angleterre à la firme Johnson and Sons au prix de 666 francs anciens la tonne. Quant au peu d’or contenu dans ce sable, il le récupère au moyen d’un simple procédé gravimétrique, les quelques essais de cyanuration qu’il avait tentés n’ayant jamais été concluants. Il en avait probablement évalué la teneur entre 0,3 et 3 grammes au mètre cube de sable noir, ou encore entre 100 et 150 grammes à la tonne de cassitérite. Sans autres précisions.
Du 15 juillet au 15 septembre 1903, il ne parvient qu’à produire un peu moins de 5 tonnes métriques de minerai marchand contenant de 43% à 75% d’étain métal, ainsi qu’environ 20 onces d’or (soit environ 600 grammes) qu’il vendra en Angleterre après avoir obtenu l’autorisation de disposer du produit de ses recherches par arrêté du 6 novembre 1903. Autorisation suivie de l’accord de l’administration des Domaines daté du 21 janvier 1904.
À cette époque, l’on sait qu’il vendait son minerai marchand, titrant d’environ 75% d’étain métal, au prix de 986,60 francs[1] par tonne anglaise (soit 971 francs la tonne métrique).
À la mi-septembre, ses dépenses s’étaient élevées à 47.000 francs (soit environ 180.500 euros), mais elles se monteront à 59.300 francs à la fin de cette même année (soit environ 238.000 euros). A comparer avec la somme possible d’environ 5.000 francs (20.000 euros) qu’il aurait touchée pour la vente de son minerai d’étain et celle d’environ 400 dollars pour la vente de son or. Sans compter la vente des minéraux abrasifs mais dont on ignore la valeur. Quant au platine signalé par de Limur en 1878, il n’a jamais été retrouvé.
D’où un bilan largement déficitaire bien que l’on ne connaisse pas exactement le montant de ses ventes.
Cependant, compte tenu des échantillonnages suivis d’analyses effectuées en Angleterre (entreprises « The Wilfley Concentrator Syndicate » et « Johnson and Sons ») et en France (Hubin de Harfleur), il semblerait que son affaire pouvait être rentable à condition d’améliorer sérieusement son rendement de production en utilisant un mode d’extraction moins primitif. Ainsi, il pensait avoir la possibilité d’exploiter, mais dans des conditions quand même assez onéreuses, une zone contenant 200 tonnes de minerai stannifère marchand et 2.000 tonnes de minéraux abrasifs, principalement constitués de grenats.
Quelque peu encouragé par ces perspectives optimistes, il fait alors une demande de concession en 1904 pour étain et métaux connexes, portant sur une superficie de 1.938 hectares. Ceci malgré l’opposition du Conseil Municipal de Pénestin et de Férel, du Conseil Général du Morbihan et de nombreux pêcheurs, ostréiculteurs et propriétaires, dont un notaire de la Roche Bernard. Mais il n’y eut pas de demandes en concurrence.
C’est à ce moment qu’il envisage de modifier son mode d’exploitation dans l’espoir d’augmenter sa production et met en service une pompe suceuse de 100 m3/h installée sur un bateau en tôle muni d’un moteur à vapeur de 45 CV. Matériel qu’il mettra en place à Pénestin dès le 18 octobre 1904. Il décide également de remplacer les tables à secousses de sa laverie par un concentrateur à courant d’air de 3,4 m3 de capacité relié à une conduite en grés vernissé longue de 125 mètres destinée au rejet du sable stérile en mer.
Toutes ces modifications lui demandent encore de longues mises au point et des réglages laborieux et c’est pourquoi l’administration lui impose, en janvier 1905, un sursis de 6 mois pour l’octroi de sa concession. Sursis assorti d’une réduction de périmètre pour satisfaire aux réclamations de la commune de Pénestin.
Mais il s’aperçoit vite que l’état de la mer ne lui permet pas de travailler d’une manière continue car son nouveau système d’extraction ne pouvait fonctionner correctement que par mer calme, le reste du temps le matériel devant rester à l’abri au port de Tréhiguier.
Malheureusement, le bateau et sa pompe coulent au cours d’une tempête et il se voit donc obligé d’abandonner ses travaux. Alors, qu’il avait encore extrait plus d’une tonne de cassitérite contenant 603 kilos d’étain métal. Plus 73 grammes d’or qui seront vendus en Angleterre bien que la mine d’or de la Bellière ait semblé intéressée.
Ainsi se terminent les tentatives d’exploitation d’Eugène Morineau qui ne se solderont que par la vente d’environ 6 tonnes de minerai marchand, environ 670 grammes d’or et environ 35 tonnes de grenats et autres minéraux abrasifs, alors que le total des dépenses engagées sur ce site avait été évalué à environ 125.000 francs (500.000 euros). D’où une affaire largement déficitaire.
Et, le 26 mars 1907, l’Administration rejettera sa demande de concession
Pourtant, en octobre 1906, l’ingénieur en chef des Mines, avait émis une opinion favorable sur les possibilités minières des sables de la plage de Pénestin....
[1] Il s’agit, dans l’ensemble de l’article, de francs anciens, ceux d’avant la réforme de 1960 où 100 F deviennent 1 F.
Première moitié du XXème siècle.
Le temps des derniers aventuriers.
Par la suite, on a connaissance de nombreux échantillonnages ou essais épisodiques de mise en exploitation dont les suivants :
-
en 1911, par Mr. Duchange demeurant 60 rue Delpech à Amiens. Cette même année et probablement à la suite de sa démarche, le service des Mines fait procéder à un échantillonnage de la plage au moyen de 13 prélèvements. A l’issue de leur traitement on en déduit qu’un m3 de sable noir, pesant en moyenne 1.315 kg, pouvait contenir de 0,3 à 3 g d’or, de 6 à 8 kg de cassitérite, 2 kg d’ilménite, 15 kg de magnétite, 20 kg de corindons et spinelles, et 200 kg de grenats. Au total, cette zone d’échantillonnage pouvait représenter un tonnage de sable noir sec de 86.160 tonnes, exploitable par la méthode du raclage à marée basse, et pouvant être évacué vers le sommet de la falaise au moyen d’une rampe d’accès.
Il semblerait qu’aucun début d’exploitation n’ait été tenté à la suite de ces travaux, bien qu’il ait tenté de relancer son affaire en décembre 1943 auprès de Mr. Jean Cantacuzène, directeur de la Société d’Etude et d’Exploitation Minière à Paris (20 rue de l’Arcade), ainsi qu’en janvier 1944 auprès de Mr. R. Duval, ingénieur TPE à Vannes. Toutes ces tentatives étant restées sans suite, semble-t-il.
-
en 1913, par Mr. Brenet demeurant 11 rue de Provence à Paris qui est autorisé à extraire 1.000 m3 de sable sur la grève des Demoiselles. Tentative sans suites.
-
en 1921, par Mr. Léon Lafitte, demeurant 3 rue de Suresnes à Paris, qui est plutôt intéressé par l’exploitation des minéraux titanifères, ilménite et rutile principalement.
-
toujours en 1921, par Mrs. Richart, Audren et Paquet, de Paris, également intéressés par les minéraux titanifères.
-
en 1926, un ingénieur des Mines fait état de prélèvements d’échantillons effectués à 300 mètres à l’est de Tréhiguier sur la rive de la Vilaine. Dans son PV du 12 juin 1926, il mentionne l’absence d’or et de platine.
-
en 1928, par Mr. Couvreur, agrégé de l’université de Plaisir, en Seine-et-Oise.
-
en 1929, par Mr. Freitel, de Moisdon-la-Rivière. C’est probablement lui qui, en juin 1929, procède à des échantillonnages qui seront traités à Toulouse et dont les concentrés obtenus sur tables à secousses donneront de 1,5% à 24,6% de minerai marchand de cassitérite.
-
en 1930, le même Mr, Freitel continue ses échantillonnages et fait analyser une quinzaine de prélèvements au laboratoire Cambreton à Saint Nazaire. Le tout constaté par le sieur Duchemin, ingénieur des Mines, par PV du 6 novembre 1930 faisant état de teneurs en cassitérite variant de 0,05% à 0,16%. L’or ne se trouvant qu’en traces et le platine inexistant.
-
en 1931, par Mr. Duchemin, ingénieur des Mines qui procède à un simple échantillonnage d’interprétation peu aisée, à l’issue duquel il aurait trouvé une teneur voisine de 800 grammes d’étain au m3 de sable.
-
en 1942, par Mr. Henri Forge demeurant 77 boulevard Malesherbes à Paris. Le 20 mars1942, il sollicite une demande de Permis Exclusif de Recherches auprès de la préfecture du Morbihan pour produits abrasifs, fer titané et étain. Ceci après avoir fait état des précédents résultats obtenus par Eugène Morineau et visité les lieux avec un ingénieur des Mines. Ce dernier procèdera à un échantillonnage portant sur 2 fois 9 échantillons de 20 à 28 kg chacun et conclura que l’extraction du sable ne pourrait se faire que par raclage à l’aide d’un scraper.
Le 17 avril suivant, Mr. Forge est informé qu’il lui suffit, pour continuer ses travaux, d’obtenir l’autorisation des propriétaires concernés tout en étant obligé d’exposer en détail la nature de ses travaux auprès du Service des Mines, avec le nom et l’adresse du responsable.
Enfin, par courrier du 17 avril suivant, il demandera à Mr. Fischesser, ingénieur des Mines, de venir visiter les lieux en vue d’obtenir une autorisation auprès des autorités d’occupation allemandes, cette région se trouvant en zone interdite. Autorisation vraisemblablement non accordée.
C’est probablement vers la même époque que Achille Stouvenot, ingénieur des Mines, publie une note sur Pénestin et pense que 300.000 m3 de sables sont disponibles à teneur de 4,6 kg d’étain au m3.
-
en 1944, par Mr. Herpe, directeur de « l’Expansion Minière Bretonne » au 121 rue de Fougères à Rennes. Mais le rapport de l’ingénieur des TPE émet un avis négatif car la plage de Pénestin est incluse dans la zone de défense côtière définie par les troupes d’occupation allemandes (organisation Todt). Cependant, en mars 1945, le volume de sable à traiter sera estimé à 200.000 m3 comprenant le seul niveau de sable noir dont l’épaisseur varie alors de 50 cm à 1 mètre. Toutes ces démarches n’ayant pas eu de suites.
Seconde moitié du XXème siècle.
Entrée en scène du BRGG puis du BRGM.
Au cours de l’année 1950, le Bureau de Recherches, Géologiques et Géophysiques (BRGG), entre en scène et prélève une dizaine d’échantillons pour un poids total de 25 Kg, et les fait analyser au laboratoire de « Minerais et Métaux ». Le résultat final fera état d’une teneur en étain métal de 0,48%. Soit une teneur d’environ 9,6 Kg au m3.
Ensuite, par courrier du 21 février 1952 adressé à l’ingénieur général des Mines, Mr. P. Morel demeurant 90 rue de Miromesnil à Paris, déclare qu’il a l’intention de constituer une société d’études en association avec Mr. Claude Herbinger, directeur de la Société des Minerais et Minéraux Industriels. En compagnie de Mr. Lougnon, géologue au BRGG, il procède à l’extraction de 100 kg de sable noir de la plage et les fait traiter au moyen de jigs et de tables à secousses suivant différentes coupures granulométriques.
À la suite de ces analyses, on en déduit que 100 m3 de ce sable pourrait fournir 164 kg de cassitérite à 70% Sn, 1 tonne de magnétite, 1,6 tonne d’ilménite, 10 tonnes de minéraux abrasifs (grenats, corindon et spinelles), et de 40 à 80 g d’or.
Le 17 décembre 1958, Mr. Claude Lévy, minéralogiste au Bureau de Recherches Géologiques, Géophysiques et Minières (BRGGM), fera une simple analyse minéralogique à l’issue de laquelle il constatera l’absence de platine et de minéraux niobifères[2].
En mai 1960, René Mercier, prospecteur au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), procède au fonçage de 74 petits puits circulaires d’environ 1m2 de surface et de 1 mètre de profondeur en moyenne. Le traitement au pan américain de la seule couche de sable noir a démontré l’extrême dispersion des teneurs en cassitérite qui peuvent varier de la simple trace à la teneur exceptionnelle de 6.500 grammes au m3. Ceci sur une extension linéaire de haut de plage minéralisée en cassitérite d’environ 500 mètres de long sur les 1.600 mètres de plage explorée.
Au cours de l’année 1963, une campagne de sondages courts a été réalisée par Mr. Danvel, ingénieur au BRGM, dans les limites d’un quadrilatère de 2.300 m de long et de 100 m de large. On compte 155 sondages d’environ 1 m de profondeur chacun qui ont été disposés sur 24 lignes équidistantes de 100 m. D’où un métrage total de 157,35 mètres.
Les analyses ayant été effectuées « à l’excavé », c’est-à-dire sans faire la distinction entre un horizon de sables noirs enrichis et son environnement stérile, il est apparu que ce sable avait en moyenne une teneur d’ensemble de 24 grammes de cassitérite au m3. De même qu’en 1960, il n’a pas été tenu compte des rares traces d’or observées.
Enfin, en juin 1970, une rapide étude sur l’origine possible de la cassitérite présente sur la plage de Pénestin, a été entreprise par Y. Lulzac, géologue minier au BRGM. En conclusion, plusieurs sources possibles d’alimentation ont été évoquées :
-
Le niveau de sable d’âge Pliocène présent sur le sommet de la falaise, mais dont les teneurs sont toujours de bas niveau.
-
Les occurrences fissurales quartzeuses découvertes dans le socle schisteux altéré de la falaise.
-
Des formations pegmatitiques ou quartzeuses plus lointaines dont il est possible de découvrir des témoins dans la zone de galets de la plage, ainsi que dans la proche microfalaise de Coëtsurho où l’une de ces formations est bien visible en place.
Ceci contrairement aux hypothèses maintes fois avancées pour expliquer la présence de cette cassitérite à Pénestin. Hypothèses faisant toujours appel à des origines lointaines telles que les districts stannifères bien connus de Piriac et de Questembert-Limerzel.
[2] Du Niobium : élément chimique de numéro atomique 41 et de symbole Nb, qui fait partie de la série des métaux de transition.
Conclusion
Pour ce qui concerne le potentiel stannifère réel de cette plage de Pénestin, il est difficile de se faire une opinion précise en se fondant uniquement sur les chiffres issus des anciens échantillonnages et tentatives d’exploitation. On constate qu’en général ces chiffres sont toujours très supérieurs à ceux qui ont été obtenus à la suite des échantillonnages récents effectués par les agents du BRGG-BRGM.
À ceci, plusieurs explications possibles :
-
Imprécisions dans l’énoncé des modes d’échantillonnage anciens car on ne connaît pas toujours la nature exacte de ce qui a été prélevé sur le terrain : s’agit-il du seul niveau de sables noirs récupéré d’une manière minutieuse sans inclure du sable stérile ? Tout en sachant que la limite entre ce niveau particulier et son contexte stérile n’est pas toujours très tranché.
-
Imprécisions dans le mode de calcul des teneurs en cassitérite, que ce soit en pourcents, en grammes par tonnes ou en grammes par mètres cubes, car il n’est pas toujours précisé s’il a été effectué sur du sable sec ou humide. De même, il semble y avoir parfois des teneurs exprimées en étain métal ou en cassitérite sans que l’on sache toujours la proportion de l’un par rapport à l’autre.
-
Grande hétérogénéité régnant au sein du niveau de sable noir préconcentré naturellement au rythme du marnage, des variations climatiques et des courants marins. Ces phénomènes aléatoires pouvant être à l’origine d’incessants remaniements de ce niveau particulier dans le cordon sableux ainsi que d’importantes modifications dans la distribution des minéraux lourds. Il est évident qu’un gisement de plage actuelle n’est pas un stock de minerai stable. Il subit d’incessantes modifications dont l’ordre de grandeur peut être très largement supérieur à la marge d’incertitude des échantillonnages.
-
Appauvrissement local du sable noir en minéraux utiles (dont la cassitérite principalement), consécutif aux nombreux essais d’exploitation. En effet, la vitesse de l’érosion de la falaise et de sa couverture pliocène, ainsi que de celle des gîtes primaires plus lointains, n’est pas suffisante, à l’échelle humaine, pour régénérer le stock de minerai disponible. D’où, logiquement, une baisse des teneurs en général mais qui ne pourra pas toujours être perceptibles à l’échelle locale à cause de la grande mobilité des points de concentrations naturelles.
-
Manque de fiabilité, involontaire ou non, de certains résultats d’échantillonnages et d’exploitation, tendant à optimiser le potentiel minier de ce site en vue de faciliter la poursuite des travaux ou l’octroi d’un permis de recherches ou d’une concession.
Évidemment, ces mêmes remarques peuvent s’appliquer pour ce qui concerne le potentiel aurifère du site qui a toujours été considéré comme étant très secondaire dans la mesure où l’or n’a toujours été qu’un sous-produit d’exploitation qui ne pouvait être récupérable avec profit que si le volume du minerai à traiter était suffisamment important. A notre connaissance, seul Eugène Morineau a pu atteindre cet objectif.
Quant aux teneurs en or qui ont pu être parfois annoncées au cours de ces activités minières, elles ont pu être rapportées, soit au poids ou volume de sable noir, soit au poids de cassitérite récupérée, sans que ce rapport soit toujours clairement précisé.
À noter que les échantillonnages récents n’ont jamais avancé des chiffres de teneur car l’or s’est toujours présenté sous forme de traces impondérables.
Compte tenu de tous ces paramètres et également du potentiel minier très limité de ce site, il est évident qu’à l’heure actuelle, les sables noirs de la plage de Pénestin ne sauraient présenter un quelconque intérêt économique.

ANNEXE 1
La géologie du site de Pénestin...
A travers le compte-rendu de la sortie du Samedi 14 Décembre 2002,
sortie guidée par Nicolas Brault et Stéphane Bonnet (Université de Rennes1).
Source : https://sgmb.univ-rennes1.fr/12-excursions/45-penestin
Société Géologique et Minéralogique de Bretagne

ANNEXE 2
La géologie du site de Pénestin...
La publication de la précédente annexe m'a valu pas mal de réactions dont celles de géologues de l'Université de Nantes qui m'ont adressé leur propres observations, rédigées par
Jean Jacques Guillou, maître de conférences à la faculté des sciences de Nantes.
Visite du 11 mars 2003 à Pénestin
(Visite faisant suite à l’article rédigé par Mrs Brault et Bonnet de la faculté des sciences de Rennes).
Le substrat altéré
J’ai été particulièrement frappé du degré d’altération du substrat schisteux. Certes, il est analysé et détaillé avec force termes techniques dans l’article des rennais, mais j’ai la certitude qu’ils n’en ont pas tiré les évidences qui s’imposent à l’observateur moyen :
-
On peut déjà noter que ce type d’altération en masse n’est pas très fréquent dans les falaises armoricaines exposées, en général formées de matériel peu altéré.
-
Cette falaise altérée en masse s’affaisse sur elle-même. Il est probable qu’en terme de bilan volumétrique, les phénomènes d’altération avaient un effet irrégulier selon l’endroit considéré (efficacité de l’exportation des éléments mobiles en fonction de la nature locale de la roche, de l’intensité et de la nature variable de l’altération et de l’irrégularité des circulations d’eau), et il est donc impératif d’éliminer tout ce qui est tassement différentiel dû à l’altération entre panneaux voisins, avant de supposer qu’on a affaire à des failles vivantes d’origine profonde dès qu’une faille ou une diaclase rejoue. Ceci d’autant plus qu’il s’agit d’un front de falaise, lieu où apparaissent des phénomènes « panaméens ».
-
Ce matériel peu cohérent sera facilement affecté par tout ce qui est phénomène périglaciaire, beaucoup plus aisément que ne le seraient des substrats sains.
-
On observe enfin que la mer, à son niveau actuel, attaque ces altérites à une vitesse remarquable. Or les alluvions grossières supposées paléo-ligériennes par les rennais, reposent sur ce matériel. Donc, dans l’hypothèse qu’on a bien affaire au lit d’une paléo-Loire, l’érosion fluviale aurait-elle alors été incapable, à l’époque, de déblayer ce substrat peu cohérent ? Ce serait tout à fait insolite par rapport aux capacités érosives pléistocènes de la Loire (lit à -50m à son embouchure) et de la Vilaine (-20 m ?), fleuves qui recoupent toutes les barres rocheuses armoricaines.
Ces fleuves, capables d’éroder les roches les plus résistantes en amont, deviendraient-ils alors, en aval, incapables d’attaquer des argilites ? Le concept de base étant l’érosion régressive.
Au total, l’érosion de ce substrat se résume au creusement de petits chenaux aux bords symétriques ou non, le tout étant plus ou moins affecté par les remobilisations périglaciaires.
Conclusions : il est difficile d’interpréter ce substrat profondément altéré, particulièrement meuble et conservé sous des dépôts grossiers pelliculaires, comme étant le témoin du fond d’un lit de grand fleuve, à moins d’admettre qu’on se situe sur des zones de débordement très marginales, au fonctionnement très épisodique. Mais que resterait-il alors comme arguments pour soutenir l’hypothèse avancée ?
Les dépôts eux-mêmes
Il s’agit d’une question de géométrie également fondée sur les notions les plus élémentaires.
On sait que dans un système fluviatile classique, les terrasses les plus anciennes surplombent les terrasses les plus récentes. Or, les rennais montrent que la sédimentation fluviale la plus basse est ici la plus âgée en appliquant, fort justement, le principe de superposition. On se trouve donc dans un cas inverse, mais envisageable en première approche, à condition d’admettre un certain nombre de mécanismes compensateurs.
Car cela implique que les trois ensembles détritiques n’ont pu se superposer que s’il n’y a pas eu d’enfoncement du lit du paléo-fleuve (ou des lits si l’on admet que la paléo-Vilaine se soit confondue avec la paléo-Loire) dans le laps de temps donné de 300.000 ans.
Pour cela :
Hypothèse 1, il faut que les altitudes du niveau de la paléo-Loire et de celui de la paléo-Vilaine, fleuves supposés coulant en sens différent à des centaines de milliers d’années de différence, aient été exactement les mêmes en ce point précis. Une fois la paléo-Loire détournée, la paléo-Vilaine aurait repris le relais plus tard, exactement à la même altitude. N’oublions pas que rien ne permet de supposer qu’on soit ici à une quelconque embouchure nécessairement commune aux trois systèmes successifs, embouchure restée stable pendant 300.000 ans, mais à une certaine distance de ce secteur.
Hypothèse 2, pour obtenir ce résultat, il faut aussi impérativement que sur ces 300.000 ans, la répercussion à cet endroit précis de l’évolution du niveau marin (niveau de base des systèmes fluviatiles successifs), ait exactement compensé les phénomènes d’enfoncement des lits, au point de toujours les annuler et d’obtenir une superposition parfaite sans épisodes érosifs intercalaires des trois dépôts successifs (de la paléo-Loire puis des deux paléos-Vilaine). Il est donc impératif que l’interaction-compensation des phénomènes de différentes natures (marin et fluviatile) à différentes échelles des bassins fluviatiles successifs, remette quasi-exactement au niveau initial matérialisé par le contact entre le substrat et les premiers dépôts, les deux paléos-lits les plus récents.
Je ne ferai aucun commentaire sur l’éventualité de telles évolutions paléogéographiques mettant en jeu des cinétiques normalement indépendantes.
La paléogéographie.
De l’Odet au Brivet, les fleuves bretons coulent perpendiculairement à la côte en recoupant les structures armoricaines, même si certains de leurs affluents (Oust, Don, Issac) peuvent suivre ces mêmes structures dans des gouttières schisteuses tendres. Le plus souvent, la Loire recoupe également ces structures parallèles à la côte, en dehors de son tracé oblique en amont d’Ancenis (dans un bassin Carbonifère de structure originale), et de celui de l’estuaire étant lui-même un domaine pétrographique et structural particulier.
Dans l’hypothèse rennaise, et donc sans tenir compte du manque de témoins sédimentaires d’une paléo-Loire en Brière, il faudrait choisir, dans l’ouest briéron, l’axe de l’étier de Mesquer pour y faire passer la Loire.
Un tracé nord continu dans les roches dures qui jalonnent l’accident sud-armoricain serait une fois de plus particulièrement irréaliste.
A partir de Mesquer, il faudrait repartir vers le nord à contrepente pour atteindre le secteur de Pénestin en tournant le dos à l’Atlantique. Ce serait cohérent avec un écoulement supposé sud-nord par les rennais. Mais où se serait situé le paléo-estuaire ? Du côté de la Manche actuelle ? D’autant qu’il ne faut pas oublier ici les hypothèses énoncées plus haut sur la disposition géométrique insolite des dépôts. Hypothèses déjà très fragiles mais énoncées pour les besoins de la cause.
Revenons à plus sérieux : l’Atlantique est à sa place depuis le début du Tertiaire et un fleuve de l’ampleur de la Loire va y arriver le plus directement possible. La capture de la Loire-amont, ancien affluent de la Seine, par la Loire-aval, montre que cette dernière était un cours d’eau particulièrement actif, capable d’entamer largement le paléo-bassin de la Seine. Cela implique une érosion régressive vigoureuse partant, par définition, de l’estuaire, son niveau de base. Cette évidence s’oppose à toute divagation de la partie aval, divagation qui aurait été grossièrement parallèle au tracé de la côte actuelle.
On remarquera, dans le sud du Massif Armoricain, une structuration discrète, telle qu’il en existe dans la meseta ibérique (Guillou, 1981), où l’on trouve en perpendiculaire à la direction majeure, des structures sécantes qui pilotent, pro parte, certains phénomènes magmatiques et volcaniques (métallifères) et qui se retrouvent à certaines périodes en surface, y déterminant des alternances entre zones hautes et bassins.
Il s’agirait ici d’une suite de petites dépressions en chapelet partant du Golfe du Morbihan pour s’exprimer ensuite dans la Baie de la Vilaine. L’axe du Brivet-Brière serait éventuellement esquissé dans les marais de Saint Etienne-de-Montluc pour se terminer à Grandlieu (Guillou et Delanoë 2010). Une telle disposition, même discrète, aurait pour effet de diriger et canaliser le ruissellement perpendiculairement à la direction ONO-ESE et, s’appliquant à la Loire, de s’opposer à l’hypothèse rennaise.
Une interprétation possible.
Arrivant à la plage de Pénestin, le premier réflexe est de penser à un système formé en climat semi aride chaud par l’épandage de matériaux détritiques sur une plateforme pénéplanée de type pédiment, altérée sous un climat rubéfiant typique affectant substrat et sédiments. De faibles dépressions, creusées par un ruissellement pelliculaire, auraient été comblées par les premiers apports détritiques d’origine locale (quartz d’exudation et filonien, blocs de schistes et quartzites anguleux), avant l’arrivée d’apports plus conséquents. Ce système aurait été lié à l’activité de l’accident sud-armoricain, précisément à la surrection du compartiment nord, et se serait vite interrompu à la suite d’un calme tectonique et au passage à des climats défavorables, tempérés, humides et périglaciaires.
L’intervention d’intrusions marines (placers de plage) ne serait pas impossible. Mais l’intervention plus naturelle d’épisodes humides à ruissellement continu expliquerait les concentrations de minéraux lourds, plus difficiles à réaliser dans la dynamique de « sheet-floods » des dépôts de type « red-beds » sensu stricto, sauf remaniements possibles.
ANNEXE 3
Le point de vue du géologue prospecteur minier ayant eu souvent l’occasion d’étudier des gîtes stannifères de type alluvionnaire sur l’ensemble du Massif Armoricain...
Mr. Yves Lulzac
Le gîte alluvial de Pénestin est le type même du placer marin sub-actuel dont les minéraux denses, y compris la cassitérite, ont été concentrés localement au rythme du marnage, des courants marins et des aléas climatiques.
Il est indéniable que le sable actuel, composé de minéraux légers (quartz principalement), ainsi que de minéraux plus denses (grenat, ilménite, magnétite, rutile, zircon, cassitérite, or, etc) provient en grande partie de l’érosion des roches altérées de la falaise ainsi que de la couche plus ou moins sableuse qui coiffe le sommet de cette falaise. C’est un constat que l’on a pu faire à l’issue des échantillonnages réalisés en vue de rechercher l’origine de la seule cassitérite.
Pour ce qui concerne l’état d’altération actuelle des micaschistes en place de la falaise, et compte tenu de ce que l’on a pu constater à de multiples reprises au cours de nos recherches par sondages profonds (sondages ou travaux miniers), il paraît évident que l’on a ici un superbe témoin de ce que pouvait être la pénéplaine éocène façonnée sous climat tropical humide. C’est ce que le professeur Milon avait appelé « la maladie tertiaire ». Et, dans cette roche altérée, il est normal d’y retrouver la plupart des minéraux que l’on peut recueillir sur la plage actuelle, et d’y découvrir des zones franchement argileuses de type kaolin.
Quant à la couche sédimentaire qui coiffe le sommet de cette falaise, elle ressemble beaucoup aux sables et gravillons déposés par la mer pliocène et dont il existe encore de nombreux témoins sur l’ensemble du Massif Armoricain. Témoins qui peuvent renfermer des minéraux denses utiles, tels que la cassitérite, comme il est possible de constater, par exemple, dans la région de Questembert-Limerzel dans le Morbihan. Les variétés minéralogiques que l’on rencontre dans le sable pliocène de Pénestin ne sont guère différentes de celles des sables pliocènes déposés sur les autres districts stannifères, sauf que leur concentration peut fortement varier d’un point à un autre. Elle est faible à Pénestin pour ce qui concerne la cassitérite, et beaucoup plus riche dans l’exemple précédent.
Il faut noter que si cette terrasse alluvionnaire sableuse de Pénestin avait été le témoin d’un ancien lit de la Loire, on aurait observé des associations minérales différentes, à l’image de ce qu’il est possible de constater dans les sables du lit actuel de ce fleuve. En particulier il y aurait eu absence de cassitérite.