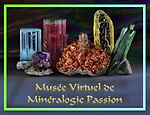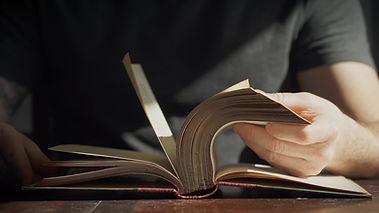

Mine d'Abbaretz- Loire inférieure - Bretagne - France.
L'ETAIN BRETON
Par Yves LULZAC, ancien géologue minier du BRGM
Article paru dans Mines & Carrières
N° 196 - octobre - 2012 (Hors série)
avec l'aimable autorisation de l'auteur
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
GLOSSAIRE

En guise de conclusion
Symbol alchimique de
l'Etain.
Avec ses 26 districts reconnus à ce jour, le Massif Armoricain mérite bien de figurer parmi les provinces stannifères de l'ouest de l'Europe, aux côtés du Massif Central français, de la Galice espagnole et des Cornouailles anglaises.
C'était l'une des "Iles Cassitérides" de l'Antiquité.
Si l'on ne considère que les districts dont on a suffisamment bien estimé les chiffres de production anciennes et modernes, ainsi que les réserves disponibles, on parvient aux bilans suivants (en tonnes de cassitérite):
- Production alluvionnaire ancienne: 800 tonnes.
- Production ancienne hors alluvions: 1 640 tonnes.
- Production alluvionnaire moderne: 6 400 tonnes.
- Production moderne hors alluvions: 4 000 tonnes.
- Réserves alluvionnaires: 1 000 tonnes.
- Réserves hors alluvions: 28 000 tonnes.
Bien sûr, il aurait été intéressant de comparer ces chiffres de production avec ceux des autres provinces de l'Europe occidentale, mais les données sur ce sujet sont très incomplètes ou inexistantes, excepté pour ce qui concerne la production moderne des Cornouailles anglaises (H.G. Dines, 1956).
En effet, depuis le dix huitième siècle et jusqu'au milieu du vingtième siècle, on sait que la production cornouaillaise a largement dépassé les 2 millions de tonnes d'étain métallique. On sait également que, sur une superficie d'environ 2 250 km², cette province comptait 380 mines dont la cassitérite était le minerai principal, et le cuivre le minerai secondaire.
A lui seul, le district de Camborne-Redruth-Saint Day, d'une superficie de 130 km², a fourni plus d'un million de tonnes d'étain extrait de 112 mines dont une vingtaine avait un potentiel supérieur à 10 000 tonnes.
Ces chiffres sont sans commune mesure comparés à ceux du Massif Armoricain avec ses 10 400 tonnes de cassitérite sorties d'une dizaine de mines au cours des dix neuvième et vingtième siècles sur une superficie de 40 000 km².
Pour ce qui concerne les productions antiques, les mises en parallèle sont beaucoup plus délicates à établir car, si des preuves évidentes d'exploitations très anciennes ont été découvertes par hasard dans les Cornouailles anglaises, combien d'autres, par contre, sont restées ignorées des mineurs modernes plus préoccupés de production que d'archéologie.
On admet que ces productions cornouaillaises ont principalement porté sur les gîtes alluvionnaires plutôt que sur les filons toujours plus difficiles à abattre et à traiter.
Au total, une vingtaine de vallons aurait été exploitée, pour une longueur cumulée d'environ 45 kilomètres (Collectif, 1992). En admettant une largeur utile de 20 mètres et une épaisseur du niveau minéralisé égale à 2 mètres, on obtient un volume possible de 1,8 million de m³ dont la teneur en cassitérite devait être très importante compte tenu du grand nombre et de la richesse des gîtes primaires.
Si l'on retient une teneur de 3 kg/m³ de cassitérite récupérée, le tonnage extrait aurait été de l'ordre de 5 400 tonnes, soit environ 4 000 tonnes d'étain métallique sur une période de temps comprise entre l'âge du Bronze et l'occupation romaine, et probablement bien au-delà.
On est donc loin des 800 tonnes de cassitérite probablement sortie des alluvions armoricaines, bien qu'il s'agisse ici d'un tonnage qui aurait pu être majoré dans des proportions non négligeables.
En effet, l'on s'étonne du fort potentiel de cassitérite subsistant encore dans ces alluvions que l'on imaginait exploités dans leur totalité. Cette observation s'appliquant d'ailleurs aussi bien aux gisements alluvionnaires cornouaillais qu'à tous les vallons armoricains exploités ou simplement échantillonnés à l'époque moderne, comme par exemple ceux des districts de Saint-Renan ou de Questembert.
On a l'impression que les anciens prospecteurs se livraient à un simple "écrémage" des niveaux les plus riches, peut-être découverts par hasard, et qu'ils se contentaient de produire le maximum de minerai en un minimum de temps sans chercher à épuiser le gisement dans sa totalité. A croire que le minerai d'étain n'était pas aussi précieux en ces époques lointaines qu'on ne le pense aujourd'hui.
Bien sûr, les conditions de travail dans ces fonds de vallons présentaient de nombreux inconvénients, le plus important étant le risque d'inondation des chantiers à tout moment de l'année, que ce soit à cause de la trop grande proximité d'un cours d'eau permanent, ou d'une période très pluvieuse.
C'est pourquoi la plupart des exploitations anciennes recensées de nos jours en Armorique intéressent de préférence l'extrémité amont des cours d'eau.
Cette façon de travailler devait être générale dans l'ouest de l'Europe bien que des traces d'exploitations alluvionnaires très profondes, certaines datées de l'âge du Bronze, aient été observées dans les Cornouailles anglaises.
L'exploitation des gîtes primaires en zones non inondables, mais au-dessus de la nappe phréatique, pouvait donc paraître plus aisée et se prêtant mieux à une exploitation minutieuse surtout lorsque l'abattage était facilité par un encaissant altéré pouvant se traiter à la manière d'une alluvion. C'est le cas du gisement de La Villeder et plus particulièrement de celui d'Abbaretz où l'extraction du minerai semble avoir été conduite d'une manière plus rationnelle.
L'on en vient, alors, à s'interroger sur les méthodes employées par ces anciens prospecteurs.
Ceux de l'âge du Bronze préféraient, semble-t-il, exploiter sommairement les alluvions au hasard d'une prospection non systématique basée sur le seul échantillonnage des alluvions superficielles en "lit vif". Ce serait l'œuvre de petits groupes d'individus isolés, chacun exploitant son vallon et procédant sur place au traitement du minerai dans l'intention, soit d'utiliser le métal à leur compte, soit de l'échanger ou de le vendre. En gardant à l'esprit que l'exploitation à l'âge du Bronze d'un vallon de type "Délé" (district de Saint-Renan), dont le volume d'alluvions à extraire et à laver approchait les 15 000 m³, devait prendre plusieurs années sinon plusieurs décennies.
Les autres, contemporains des romains ou plus tardifs, tout en poursuivant les petites exploitations alluvionnaires artisanales, comme dans le district de Questembert, préféraient s'investir dans l'exploitation de gros gisements de type primaire, dont celui d'Abbaretz en représente un bon exemple. Sur ce dernier district, on y verrait plus volontiers l'œuvre de professionnels bien organisés, opérant par petits groupes sur une section filonienne bien délimitée, et disposant d'un unique atelier de traitement. Atelier dont on n'a d'ailleurs pas retrouvé l'emplacement exact à l'heure actuelle.
L'exploitation antique d'Abbaretz, la plus importante du Massif Armoricain, conduit d'autre part à s'interroger sur sa durée réelle car, si l'on se fie aux diverses trouvailles faites au cours des travaux modernes, elle aurait persisté depuis l'occupation romaine jusqu'au Moyen Age central, soit sur un millénaire ou peut-être davantage.
Sauf à envisager une improbable production journalière de quelques kilogrammes de cassitérite, on imagine mal une exploitation minière se déroulant sur une aussi longue durée sans admettre des périodes d'inactivité dont les causes peuvent être multiples: concurrence de l'étain cornouaillais, concurrence du fer, guerres, voies commerciales coupées, etc.
Se pose alors le problème de l'origine des "repreneurs" arrivant sur les lieux pour continuer une exploitation peut-être abandonnée depuis des décennies ou des siècles. Etait-ce une communauté gallo-romaine professionnelle de la recherche minière, ou bien des Saxons ou des Germains bien connus pour leurs compétences en matière de mines (plus tard, le duc Jean V, ne fera-t-il pas appel à un allemand dans l'espoir de redécouvrir les mines d'argent oubliées de ses contemporains bretons…), ou bien des mineurs cornouaillais bien que ceux-ci devaient avoir suffisamment à exploiter sur leurs propres terres ?...
Toujours est-il qu'au dix septième siècle, le souvenir des anciennes mines d'étain armoricaines s'était complètement estompé, à tel point que la très perspicace Martine de Berthereau, baronne de Beausoleil, n'avait pu inventorier, dans sa célèbre «declaration» de 1632, qu'une seule occurrence d'étain, perdue dans un lieu non précisé du vaste évêché de Quimper…
Yves Lulzac, mai 2012
Bibliographie
Agricola, G. De Re Metallica. Bâle, 1571. Ed. Gérard Klopp, Thionville, 1992.
Allon, A. Délimitation par tranchées du gîte primaire d'étain de la Chênaie-la Ribaudais. Abbaretz (Loire Atlantique). Rapp. BRGM, div.VB 231, juin 1971.
Allon, A. Etain de Saint-Dolay. Mission 1970-1971. Rapp. BRGM, div.VB, février 1975.
Bambier, A. Prospection éluvionnaire et étude de gîtes en place à partir d'indices de cassitérite dans la région de Questembert. Rapp. BRGM, A1759. 16 février 1961.
Bertereau (de), Martine, baronne de Beausoleil. «Veritable declaration de la descouverte des mines et minieres du royaume de France». 1632.
Bonnici, J.P., Heinry, C. Recherche des gîtes stannifères primaires à partir des indices alluvionnaires trouvés en Mayenne. Rapp. BRGM, div.VB. Avril 1969.
Briard, J. Les dépôts bretons et l'âge du Bronze atlantique. Rennes, 1969.
Champaud, C. L'exploitation ancienne de cassitérite d'Abbaretz-Nozay. Ann. de Bret., t.64, fasc.1,1957.
Chauris, L., Guigues, J., Moussu, R., Walter, J. Observations préliminaires sur les gisements stanno-wolframifères associés au granite du Leslay (Côtes-du-Nord). C.R.A.S., t.258, pp.5499-5502, 1er juin 1964.
Chauris, L., Forestier, F.H., Ters, M. Une pegmatite sodo-lithique à Saint-Sébastien près de Nantes (Loire Atlantique). Bull. Soc. Fr. Minéral. Cristallo., t.92, 1969.
Chauris, L., Lulzac, Y. Les aplites à topaze et les stockscheider du leucogranite de Scaër (Finistère). Bull. Sté. Géol. et Min. de Bretagne, série C, t.V, fasc.1, novembre 1973.
Chauris, L. Minéralisation stanno-wolframifère dans le granite de Carantec (Bretagne). C.R.A.S. Paris, t.280, 2 juin 1975.
Chauris, L., Garreau, J. Le massif granitique de Plounéour-Menez (Finistère) et les minéralisations associées. Bull. Sté, Sci. Nat. de l'Ouest de la Fr., t.5, 1983.
Chauris, L. Un petit placer stannifère sur la rive septentrionale de la Baie de la Vilaine (Morbihan). Bull. Sté. Polym. du Morbihan, 1991.
Chauris, L. Cassitérite détritique sur les grèves de Carantec en Baie de Morlaix (Finistère). Bull. Sté. Linn. de Normandie, vol.114-115, pp.113-116, 1991.
Collectif. Prehistoric extractive metallurgy in Cornwall. Proc. of a one day conf. held at the Camborne Sch. of Mines. Pool, Redruth, Cornwall, July 11, 1992. Bidd and Gale ed., July 1997.
Collectif. A la redécouverte des mines du passé. Géochronique n°57, ed. BRGM, 1996.
Coquebert de neuville, R. Recherches sur le gisement d'étain de Piriac. Bull. Sté, Sci. Nat. de l'Ouest de la Fr., 1931.
Davy, L. Une ancienne mine d'étain entre Abbaretz et Nozay. Bull. Sté, Sci. Nat. de l'Ouest., t.7, fasc.IV, 31 décembre 1897.
Davy, L. Etude des scories de forges anciennes éparses sur le sol de l'Anjou, de la Bretagne et de la Mayenne, pour servir à l'histoire de la métallurgie. C.R. mensuel de la Soc. de l'Indus. Minérale, avril 1913.
Dines, H.G. The metalliferous mining region of south-west England. Mem. of the Geological Survey of G.B. London, 1956.
Dubuisson, F.R.A. Catalogue de la coll. minéralo. géognos. et minéralurgique du département de la Loire-Inférieure. 1830.
Gautsch, J.P., Lulzac, Y. Nouveaux travaux sur les indices de Langonnet (Morbihan). Rapp. BRGM, R5039, 2 mars 1962.
Giot, P.R., Lulzac, Y. Datation à l'âge du Bronze d'une exploitation de cassitérite du Finistère. Bull. Sté. Préhis. Franç. t.95, n°4, pp.598-600.
Giot, P.R., Guigon, P., Merdrinac, B. Les premiers bretons d'Armorique. P.U.R. mai 2003.
Gobet, M. Les anciens minéralogistes du royaume de France. Chez Ruault, Paris, 1779.
Guigues, J. Etat de nos connaissances et programme de recherches sur le P.E.R. de Lizio. Rapp. BRGGM, A1513, 1959.
Guigues, J. Résultats de la prospection dans la région de Quimper. Rapp. BRGM, R5025, 20 novembre 1960.
Guigues, J., Devismes, P. La prospection minière à la batée dans le Massif Armoricain.
Mem. BRGM n°71, 1969.
Guillou J.J., Lulzac, Y. La niobo-tantalite zonée des pegmatites de Nantes (Loire-Atlantique). Bull. Sté, Sci. Nat. de l'Ouest de la Fr. nouvelle série, t.21 (3), 1999.
Huguenin, J. Coup d'œil sur la géologie du Morbihan considérée du point de vue des gisements métallifères. Ed. Masson et fils, Paris, 1862.
Kerforne, F. La région minéralisée de Montbelleux (Ille-et-Vilaine). Bull, Sté. Géol. et Minéral. de Bretagne, t.VII, fasc.1 et 2, 1926.
Laporte, A. L'archéologie et l'histoire au service de la recherche minière. Bull. BRGM, n°1, 1965.
Laucagne, P., Sanselme, H. Découverte du wolfram et de minéralisations associées dans le haut bocage vendéen. Note C.E.A. du 20 février 1956.
Lulzac, Y. Note sur la répartition des minéralisations stannifères dans le massif granitique de Locronan-Plogonnec (Finistère). Rapp. BRGM, div. VB, 1964.
Lulzac, Y. Note sur la présence de cassitérite dans la région de Quistinic (Morbihan). Rapp. BRGM, div. VB, 17 juin 1964.
Lulzac, Y. Note sur la répartition de la topaze et de la cassitérite dans la région de Scaër-Saint-Thurien (Finistère). Rapp. BRGM, div. VB, 1964.
Lulzac, Y. Etude et évaluation des flats stannifères de la région de Plougasnou près Lanmeur (Finistère). Rapp. BRGM, DRMM 67 A4, juin 1967.
Lulzac, Y. Essai de recherche des gîtes primaires stannifères dans la région de Kervéatous, Saint-Renan (Finistère). Rapp. BRGM, DRMM 68-12, 18 juin 1968.
Lulzac, Y. Evaluation économique du flat stannifère du Liscouet en Saint-Gildas (Côtes d'Armor). Rapp. BRGM, 68 RME 035, RMM, juillet 1968.
Lulzac, Y. Les filons cupro-stannifères du Pays de Lanmeur (Finistère). Rapp. BRGM, 70 RME 012, RMM, avril 1970.
Lulzac, Y. Nouvelles observations sur la cassitérite de Penestin (Morbihan). Rapp. BRGM, div. VB, juin 1970.
Lulzac, Y. Les formations stannifères primaires du bassin du Trévelot en Limerzel (Morbihan). Rapp. BRGM, div. VB, 1970.
Lulzac, Y. Les minéralisations stanno-wolframifères de la région de Parthenay (Deux-Sèvres). Rapp. BRGM, VB 76 001, décembre 1975.
Lulzac, Y. Le district stannifère de Nozay-Abbaretz (Loire Atlantique). Rapp. BRGM, div. VB, août 1983.
Lulzac, Y. Les minéralisations à étain, tantale et lithium de Tréguennec (Finistère). Rapp. BRGM, DAM/OP4, div. MA, mars 1986.
Lulzac, Y. Concession de Montbelleux. Etat des connaissances au 31 août 1986. Rapp. BRGM, DAM/OP4, div. MA, août 1986.
Lulzac, Y. Le district stannifère de Landerneau (Finistère). Rapp. BRGM 88, DAM 024, OP4, août 1988.
Mahé-Le Carlier, C, Lulzac, Y, Giot, P.R. Etude des déchets de réduction provenant de deux sites d'exploitation d'étain armoricain de l'âge du Bronze et du Moyen Age. Rev. Archéo. de l'Ouest, 18, 2001, pp.45-56.
Maréchal, J.R. Propagation du procédé direct de fabrication du fer et de l'acier par les Celtes et les Germains. O.G.A.M. t.21, n°121-126, 1969.
Méloux, J. Etude sur le gisement d'étain de Piriac. Rapp. BRGM 63B16, DRMM, 1963.
Moussu, R. Le gisement d'étain de Saint-Renan (Finistère). Ann. des Mines, 9, sept. 1963.
Mulot, B. Compte-rendu de mission à Bréhand (Côtes-du-Nord). Note BRGM div. VB, 1962.
Norton Nance, R. ed. A cornish-english dictionary, 1955.
Ramin, J. Le problème des Cassitérides. Les sources de l'étain occidental depuis les temps préhistoriques jusqu'au début de notre ère. Ed. A. et J. Picard, Paris, 1966.
Solère (de), B. Note de prospection dans les Deux-Sèvres. Rapp. BRGM, div.VB, avril 1974.
Trautmann, F., Becq-Giraudon, J.F., Chevremon, P., Guerrot, C., Thièblemont, B. Datation à 378 Ma du massif du Pertre (Ille-et-Vilaine, Mayenne). Géol. de la France, 2002, n°1.
Tronquoy, R. Contribution à l'étude des gîtes d'étain. Ed. Gauthier-Villars, Paris, 1912.
Walter, J. Rapport de la mission Cohignac (Côtes-du-Nord). Rapp. BRGM, div. VB, 1er décembre 1964.
Glossaire
AD- Pour "Anno Domini". Terme employé pour exprimer une date à partir du début de l'ère chrétienne.
Andradite- Grenat calcique et ferrifère dont la couleur évoque parfois celle de la cassitérite.
Aplite- Roche généralement granitique à grain très fin, souvent très pauvre en micas.
Arsenopyrite- Sulfure naturel d'arsenic et de fer. Egalement appelé mispickel.
BC- Pour "Before Christ". Terme employé pour exprimer une date antérieure à l'ère chrétienne.
Béryl- Alumino-silicate naturel de béryllium. Il accompagne parfois la cassitérite dans ses gîtes primaires. L'émeraude et l'aigue-marine sont des béryls.
BP- Pour "Before Present". Terme employé pour exprimer une date antérieure à 1950.
Cassitérite- Oxyde naturel d'étain de densité égale à 7. Sa teneur en étain varie de 72 à 78%.
Chalcopyrite- Sulfure naturel de cuivre et de fer.
Chlorite- Mica ferro-magnésien de couleur verte.
Corindon- Oxyde naturel d'aluminium. Le plus dur des minéraux après le diamant. Le rubis et le saphir sont des corindons.
Galène- Sulfure naturel de plomb.
Gif- Pour "Gif-sur-Yvette" dans le département de l'Essonne, où se situe le laboratoire d'analyse isotopique du C.E.A.
Greisen- Roche composée essentiellement de micas blancs et de quartz, généralement dérivée d'un granite. C'est une roche typique des gîtes stannifères.
Grenat- Alumino-silicate calcique, magnésien et ferrifère dont la cassure esquilleuse est mise à profit dans l'industrie des abrasifs.
Kaolin- Argile résultant de l'altération des roches contenant des feldspaths.
Lœss- Dépôt argilo-calcaire superficiel de granulométrie très fine, d'origine éolienne en climat périglaciaire. Egalement cartographié sous le nom de "limon des plateaux".
Ly- Pour "Lyon". Ville où se situe le Centre de Datation par le Radiocarbone de l'université Claude Bernard.
Mylonite- Roche écrasée par le jeu d'une tectonique de compression ou de cisaillement.
Pegmatite- Roche, souvent de composition granitique, dont les minéraux constitutifs sont de très grande taille, de l'ordre du décimètre ou parfois du mètre.
Pyrite- Sulfure naturel de fer.
Sables noirs- Sables recueillis à l'issue d'une opération de concentration gravimétrique, soit naturelle (plages marines ou cours d'eau), soit manuelle (batée). Ils sont très souvent composés d'une grande majorité d'oxydes naturels de fer (magnétite), ou de fer et de titane (ilménite), tous de teinte noire. D'où le nom usuel donné à ces sables.
Spinelle- Aluminate naturel de magnésium, de dureté moyenne.
Topaze- Fluo-silicate naturel d'aluminium, de grande dureté. Ce minéral accompagne souvent la cassitérite dans ses gîtes primaires.
Tantalite- Oxyde naturel de tantale, de fer et parfois de niobium.
Tourmaline- Boro-silicate naturel d'aluminium, magnésium, fer, lithium, fréquent dans les gîtes primaires de cassitérite.
WO³- La teneur des minerais de tungstène se donne généralement en pourcentage d'oxyde de tungstène WO³.
Wolframite- Tungstate naturel de fer et de manganèse.