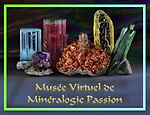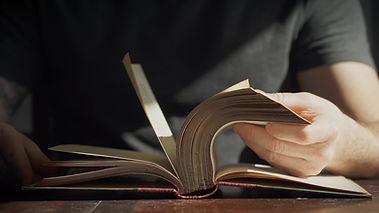
L'ETAIN ARMORICAIN
Par Yves LULZAC, ancien géologue minier du BRGM
Article paru dans Mines & Carrières
N° 196 - octobre - 2012 (Hors série)
avec l'aimable autorisation de l'auteur
PROVINCE NORD ARMORICAINE
DISTRICT DE SAINT RENAN
Il concerne la moitié occidentale du massif granitique qui s’allonge sur 45 km, depuis l’île de Molène jusqu’à mi-distance entre les bourgs de Ploudaniel et de Saint-Derrien. Cette partie occidentale est caractérisée par une roche à grain fin appelée granite de Saint-Renan.
Ce n’est qu’en 1957 que les premiers indices de cassitérite furent découverts dans cette région. Découverte fortuite due à Charles Pavot dans le cadre de ses recherches de minerai d’uranium, puis confirmée et élargie peu après par le B.R.G.M.
Très vite, l’intérêt de cette région s’est porté sur le fort potentiel stannifère de ses alluvions, et plus particulièrement par celles de la vallée de l’Aber Ildut, immédiatement en aval de la ville de Saint-Renan.
Le gisement fut mis en exploitation par la Compagnie Minière de Saint-Renan (CO.MI.REN.) de 1960 à 1974, tout d’abord par abattage hydraulique de l’horizon alluvial, puis par drague suceuse flottante. La production totale de cassitérite s’est chiffrée à 5 000 tonnes, soit 3 600 tonnes d’étain métallique.
Au cours de la première phase de travaux, c’est-à-dire lorsque l’extraction du minerai se faisait à vue, des traces évidentes d’exploitations anciennes ont été découvertes dans la moitié inférieure du petit vallon du Vouden, l’un des affluents de la vallée principale. Il s’agissait d’un fossé large de 5 à 30 mètres dont la profondeur atteignait au maximum les 8 à 9 mètres dans sa partie amont. Cette cavité, totalement invisible en surface, était remblayée par des couches alternées d’argile et de sables ou gravillons très peu argileux renfermant des morceaux de bois grossièrement taillés.
Dans le dépôt alluvionnaire principal exploité en eau au moyen d’une drague flottante, des traces d’exploitations anciennes, beaucoup moins évidentes, sont apparues sous forme de quelques fossés profonds de 2 à 3 mètres, certains remplis d’argile, d’autres de sables et graviers bien lavés. Ces excavations avaient à peine entamé le sommet de l’horizon minéralisé à faible teneur sans parvenir jusqu’au niveau inférieur le plus riche, profond de 4 à 5 mètres. Niveau impossible à atteindre avec les moyens artisanaux de l’époque, dans des terrains marécageux et gorgés d’eau.
D’autres dépôts alluvionnaires d’étendue plus modeste furent également exploités par abattage à vue dans les régions de Plouarzel, Tréouergat et Bourg-Blanc où de nombreuses anomalies stratigraphiques ont également été observées au sein du contexte alluvial. Plus particulièrement dans l’amont bassin du ruisseau du Breignou, non loin des villages des Trois Curés et de Lescus, où des scories associées à des globules d’étain métallique ont en outre confirmé la proximité d’un atelier de traitement.
Diverses trouvailles sont également à signaler bien que l’on ne puisse pas les mettre obligatoirement en relation directe avec l’extraction de l’étain. Ce sont des monnaies romaines et une fibule en bronze, divers fragments indéterminés de bronze, les restes d’un four ainsi qu’un curieux disque en pierre d’environ 28 centimètres de diamètre et percé en son centre d’un trou circulaire. Bien d’autres témoignages d’occupation ancienne ont certainement été exhumés des terrains exploités, mais pour disparaître de nouveau ou être détruits, les méthodes d’exploitation modernes ne favorisant guère les observations archéologiques.
Au total, ces petits gisements alluvionnaires annexes ont fourni 680 tonnes de cassitérite dans les années 70.
Dans le cadre d’une recherche des gîtes primaires à l’origine des concentrations alluvionnaires, l’attention fut attirée, non loin du village de Délé, par un petit vallon dont l’extrémité amont présente un profil transversal différent de ce que l’on observe habituellement. Dans sa partie la plus étroite, large d’environ 25 mètres, un fossé profond d’une cinquantaine de centimètres et large d’une dizaine de mètre se distingue nettement dans l’axe de la plaine alluviale, ses deux côtés formant une sorte de banquette inclinée.
Un profil de sondages profonds réalisé au travers du vallon a permis de localiser une excavation large d’une quinzaine de mètres et profonde d’environ 2 mètres remplie de terre végétale argileuse contenant un mince niveau intercalaire de sable bien lavé. Ce remblai, qui avait entamé la couche alluviale stannifère dans sa presque totalité, a fourni du charbon de bois en abondance ainsi que des fragments de scories, des globules d’étain métallique et de la cassitérite résiduelle.
A 120 mètres en aval, un dispositif semblable apparaît également dans l’axe de la plaine alluviale, large ici d’une cinquantaine de mètres. Le fossé d’exploitation, découvert dans les mêmes conditions que précédemment, semble avoir exploité la plus grande partie de la couche alluviale minéralisée mais sans avoir toujours atteint sa limite inférieure. Le remplissage du fossé comporte, d’une part une cavité remplie de sables argileux reposant à 2 mètres de profondeur sur un niveau de terre végétale, d’autre part une cavité profonde de 2 mètres entièrement comblée par de l’argile. Si ce remblai ne contient, ni charbon de bois, ni scories, il s’est révélé par contre relativement riche en cassitérite. Ce qui permet de douter de l’efficacité des moyens de lavage et de séparation du minerai d’étain employés par ces anciens mineurs.
Néanmoins, il se pourrait que, sur les 600 mètres de profil longitudinal probablement exploites, ce vallon ait pu fournir une quinzaine de tonnes de minerai en admettant une teneur en cassitérite récupérée de 1 kg/m³.

Une datation au radiocarbone effectuée sur le charbon de bois a révélé un âge de 3020 +/- 50 BP. Soit à la limite Bronze moyen, Bronze final (analyse Ly 8696 (10120) du 23 juin 1998).
Il est bien difficile d’évaluer la quantité de cassitérite extraite du district de Saint-Renan dans les temps anciens, sachant que cette exploitation ne semble pas avoir été réalisée d’une manière systématique dans tous les vallons accessibles à l’époque, c’est-à-dire les vallons secs ou à faible débit d’eau.
Par exemple, non loin du vallon de Délé, celui de Poulinoc, dans sa moitié aval, n’a pas été exploité alors que ses alluvions présentent de très fortes teneurs en cassitérite, atteignant même les 10 kg/m³. Il semble en être de même pour le vallon de Kerastreat avec ses alluvions à 2 kg/m³, et sûrement bien d’autres qui n’ont pas été explorés par sondages profonds (Y. Lulzac, 1968).
Si l’on ne retient que les vallons secs ou faiblement arrosés du réseau hydrographique qui draine les régions les plus stannifères de Plouarzel, Saint-Renan et Bourg-Blanc, on parvient à un total d’une quinzaine de kilomètres de profil longitudinal.
En admettant une largeur exploitable variant de 10 à 25 mètres, une épaisseur productive de 1,5 mètre en moyenne et une teneur en cassitérite récupérée de 1 500 g/m³, on pourrait chiffrer à environ 680 tonnes la quantité de minerai extrait de cette région par les Anciens.
Ceci depuis l’époque du Bronze et probablement bien après si l’on en croit le moine hagiographe Albert le Grand lequel, dans sa « Vie de Saint Sané », rapporte que ce saint homme avait vu, vers la fin du cinquième siècle ou au début du siècle suivant, les traces d’une exploitation d’étain près de Saint-Renan, le transport du minerai se faisant par voie de terre jusqu’au mouillage du Dellec (commune actuelle de Plouzané) (L. Kervran, 1971).
Les gîtes primaires à l’origine de la cassitérite alluvionnaire ont fait l’objet de recherches conduites en parallèle avec les travaux d’exploitation. Les résultats obtenus confirment, comme dans le cas du secteur de Limerzel (district de Questembert), l’existence d’une multitude de petits gîtes souvent extrêmement riches en cassitérite mais qui, pris individuellement, ne présentent guère d’intérêt économique. De plus, leur extrême dispersion sur une grande superficie très recouverte et pauvre en affleurements naturels, représente une entrave particulièrement efficace à leur localisation, que ce soit dans les temps anciens ou même à l’époque moderne.
Ici, ces gîtes sont surtout représentés par des poches ou de courts filons ou lentilles de granite greisenisé, des filonnets quartzeux ou tourmalinifères porteurs également de minéralisations wolframifères, ainsi que des ségrégations feldspathiques.
Il est pratiquement certain que toutes ces occurrences en roche dure sont restées ignorées des anciens prospecteurs.

_.jpg)


Drague flottante Ellicot à St Renan.
Image Expoteme.fr

Machinerie de traitement, mine d'Etain de St Renan.
Image Patrimoine d'Iroise.

VIDEO : Fonctionnement de la mine d'Etain de Saint renan ...
Machinerie d'extraction, mine d'Etain
de St Renan.