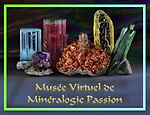SITE OPTIMISÉ POUR EDGE, MOZILLA FIREFOX et CHROME
AFFICHAGE 1920 X 1080
SITE OPTIMISÉ POUR EDGE, MOZILLA FIREFOX et CHROME
AFFICHAGE 1920 X 1080
SITE OPTIMISÉ POUR EDGE, MOZILLA FIREFOX et CHROME
AFFICHAGE 1920 X 1080

LE TUNGSTÈNE ARMORICAIN ...
page 1
Une étude de Monsieur Yves Lulzac, juin 2019
Yves Lulzac est un ancien géologue minier qui a fait toute sa carrière au BRGM, à travers le monde. Il est à l'origine de la découverte de la Lulzacite, un phosphate de strontium, qu'il a découvert à St Aubin des Châteaux, Loire-Atlantique, en 1997.Gemmologue de laboratoire à ses heures, il a rédigé un manuel de gemmologie qui fait autorité dans le monde entier.Breton, il est aussi l'auteur de cinq ouvrages sur les manoirs Bretons.
SOMMAIRE
Cliquez sur le chapitre recherché

LE TUNGSTÈNE ARMORICAIN
-
Où le trouve-t-on ?
-
Où pourrait-on L'exploiter ?
Introduction
Faisant suite à l’article dédié à l’étain, paru dans le numéro 196 hors-série de la publication « Mines et Carrières » (revue de la société de l’industrie minérale), ainsi que dans les numéros 67 à 69 de la publication « Bretagne Minéralogie » du club minéralogique de Saint Nazaire, il a semblé pertinent de dédier une étude similaire au tungstène, métal indissociable de l’étain pour lui être très souvent associé dans ses gîtes primaires en roche. Pourtant, très curieusement, ces deux métaux se distinguent par leurs propriétés diamétralement opposées : pour l’étain, peu fragile à température ambiante, c’est un point de fusion très bas à 232° Celsius (c’est le point de fusion le plus bas de tous les métaux usuels), et une faible dureté. Pour le tungstène, très fragile à température ambiante, c’est un point de fusion extrêmement élevé à 3.422° Celsius (c’est le plus réfractaire de tous les éléments), et une très grande dureté.
De même que pour l’étain, la découverte de la majorité des gîtes primaires et secondaires de tungstène, est redevable des prospections alluvionnaires inaugurées par le B.R.G.M. dès 1957 et qui se sont poursuivies jusque vers la fin des années 70.
L’étude présente fait donc l’inventaire de tous les gîtes tungstifères actuellement connus dans le cadre du Massif Armoricain, et aborde également le potentiel économique de ces gîtes, en fonction des travaux de reconnaissance qui ont pu y être réalisés avant l’abandon de toutes recherches et exploitations minières françaises métropolitaines à la fin des années 80.
Rappelons également que par ses qualités exceptionnelles, le tungstène possède de nombreux emplois dans l’industrie des aciers et alliages de grande résistance, dans la fabrication, sous forme de carbure, d’outils de grande dureté principalement utilisés dans les travaux de terrassement et de forage ; dans l’industrie électrique (entre autres : filaments des ampoules d’éclairage thermique), dans l’industrie chimique, l’armement, ainsi que dans les soudures verre-métal, etc.

Dans le Massif Armoricain, le tungstène n'est pas rare et même parfois abondant sous forme de ses deux principaux minerais :
-
La wolframite, tungstate de fer et de manganèse, dont le pôle à fer dominant se nomme ferbérite, et le pôle à manganèse dominant se nomme hübnérite. C'est un minéral noir, de dureté moyenne mais très fragile à cause de son excellent clivage. Dans le milieu alluvial, on ne peut donc le trouver que sous forme de faibles concentrations locales ou, le plus souvent, de simples traces qui ne seront jamais très éloignées de leurs gîtes primaires mais sans pouvoir préjuger de la valeur de ces derniers. A signaler que sa reconnaissance en fond de battée n'est pas toujours aisée, même au cours des processus de séparation densimétrique et magnétique.
Le comportement de le wolframite diffère donc de celui de la cassitérite qui lui est souvent associée, et sa dispersion superficielle n'atteint jamais l'ampleur d'une pollution générale et ne contribue pas à créer des pseudo-indices d'interprétation toujours malaisée. Et, bien sûr, ce minéral ne se concentre pas en placers susceptibles d'être exploités, tous du moins dans le cadre du Massif Armoricain.
Néanmoins, si son observation dans une alluvion est un bon indicateur de gîte primaire proche, sans préjuger de sa taille, elle demandera toujours à être complétée par un relevé précis des formations superficielles locales (terrasses alluviales, îlots de sables pliocènes, coulées de solifluxion périglaciaires, etc.), par une classique recherche d'éboulis quartzeux minéralisés, et enfin par une étude géochimique centrée sur le dosage de W et As dans les sols.
-
La scheelite, tungstate de calcium de couleur blanche ou rosée qui possède la faculté d'émettre une vive fluorescence bleuâtre ou jaunâtre sous un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (lampe de Wood). Cette propriété est souvent mise à profit en recherche minière car la scheelite peut aisément se confondre à l'œil nu avec d'autres minéraux blancs beaucoup plus communs. Mais, en contre partie, cette propriété a aussi tendance à faire largement surestimer le pourcentage apparent de ce minéral dans un échantillon, que seule une analyse gravimétrique ou chimique pourra confirmer ou infirmer.
Comme la wolframite, ce minéral est peu altérable dans la nature et, du fait de sa meilleure cohésion, il se rencontrera plus fréquemment dans le milieu alluvial mais très souvent sous forme de traces sans jamais former de dépôts exploitables.
La remontée aux gîtes primaires peut suivre le même processus que précédemment bien que les seuls dosages de W et As dans les sols en prospection géochimique ne semble pas être toujours suffisamment efficaces dans l'optique d'une recherche de gîtes de type skarn ou skarnoïde. Tout d'abord parce que la diffusion du tungstène dans certains sols ne semble pas toujours se faire d'une manière optimale, et ensuite parce que l'arsenic n'est pas toujours présent dans ces types de gîtes. Un complément d'étude géophysique (magnétisme par exemple) peut alors apporter d'utiles informations.
Avant la mise en chantier des prospections alluvionnaires systématiques inaugurées par le B.R.G.M. en 1958 dans le Massif Armoricain, la wolframite et la scheelite n'étaient connues qu'en peu d'endroits, presque toujours en relation avec des gîtes stannifères plus ou moins étudiés et exploités, le plus connu étant celui de Montbelleux dans le département d'Ille et Vilaine.
A l'issue des prospections alluvionnaires, de nouvelles et nombreuses occurrences inconnues de minerais de tungstène ont été découvertes, généralement en relation avec la cassitérite. Et c'est également grâce à l'emploi systématique de la lampe de Wood, tant sur le terrain qu'en laboratoire, que de nouveaux indices en liaison avec des roches basiques ont été découverts.
Ce sont ces occurrences, nouvelles et anciennes, que l'on se propose d'inventorier ici en faisant également le point sur leur niveau de connaissance et, le cas échéant, sur leur valeur économique présumée en ayant toujours à l'esprit que cette valeur sera tributaire de la conjoncture économique du moment, et donc du prix des matières premières.
Dans le Massif Armoricain, le tungstène s'exprime selon trois principaux types de gisement :
-
les formations filoniennes quartzeuses intragranitiques, soit à épontes greisenisées ou tourmalinifères, soit à épontes plus ou moins feldspathiques, ces dernières formations pouvant s'apparenter à un type pegmatitique immature.
-
les formations filoniennes quartzeuses encaissées dans des terrains sédimentaires alumineux métamorphiques, souvent à proximité immédiate d'intrusions granitiques.
-
les formations de type skarn ou skarnoïde, les premières résultant du métamorphisme d'une roche sédimentaire carbonatée au contact d'un intrusif granitique ou granodioritique ; les secondes en liaison avec des roches silicatées basiques ayant subi l'influence d'un métamorphisme général ou de contact, ou ayant été plus ou moins modifiées par voie hydrothermale.
Contrairement à la cassitérite, minerai d'étain fort recherché et exploité dès l'Antiquité, et même au-delà, la wolframite et la scheelite n'ont jamais fait l'objet de travaux de recherche ni d'exploitation avant la fin du 19ème siècle et, dans le cadre du Massif Armoricain, seul le gîte de Montbelleux a été partiellement exploité dans la première moitié du 20ème siècle.
Certains gîtes évoqués dans le cadre de cette étude ont pu faire l'objet, dans la seconde moitié du vingtième siècle, de travaux de recherches superficiels ou profonds (prospections éluvionnaires, géochimiques, tranchées, sondages ou travaux miniers), mais beaucoup d'autres sont restés dans le domaine des simples observations visuelles effectuées sur affleurements naturels ou artificiels ou, éventuellement, sur des zones d'éboulis ou des concentrations alluvionnaires significatives. Ne seront donc pas évoqués ici certains indices isolés non en place souvent de localisation imprécise, en particulier ceux concernant les roches silicatées basiques, fréquentes dans le Massif Armoricain, qui montrent très souvent de simples traces de scheelite sous la lampe de Wood, sans aucun autres minéraux accompagnateurs pouvant évoquer une formation de type skarnoïde, et sans environnement géologique favorable. De telles minéralisations ne présentent évidemment aucun intérêt économique et méritent seulement de rester dans le domaine de la curiosité minéralogique.
Le Massif Armoricain sera ici divisé en deux unités principales :
-
La province nord-armoricaine, qui part de l'île de Molène dans Finistère, pour finir aux confins orientaux du département de Mayenne.
-
La province sud-armoricaine qui débute à Pointe du Raz dans Finistère pour se terminer dans département des Deux-Sèvres, en bordure du bassin sédimentairepoitevin.
Conclusions
De grandes incertitudes demeurent encore concernant la valeur économique de la plupart des indices et districts évoqués ici. Certains n'ont été entrevus qu'à la faveur de nappes d'éboulis généralement peu étendues dans des secteurs ne présentant pas de structures majeures apparentes. Il est donc très hasardeux de se prononcer sur leur éventuel intérêt économique sans procéder à des recherches amont en privilégiant les méthodes géochimiques centrées sur le dosage des sols en W et As, suivies de reconnaissances par tranchées.
Cependant, ceux qui ont été découverts dans des zones bénéficiant d'une certaine efficacité métallogénique connue, mériteraient des compléments de travaux par géochimie, tranchées et sondages carottés. On pense en particulier aux districts de la Villeder, de Nozay-Abbaretz, de la Lucette.
Quant aux districts dont la valeur économique n'est plus à démontrer, ils rentrent dans le domaine de la pré-faisabilité, le premier d'entre eux étant celui de Coat-an-Noz dont la géométrie et le potentiel métal sont maintenant bien connus.
Il en est de même pour ce qui concerne la mine de Montbelleux dont l'avenir immédiat a malheureusement souffert de problèmes techniques, sans doute prévisibles et surmontables, mais survenus au moment de la chute des cours de l'étain et du tungstène. Actuellement, l'atout majeur de cette mine repose, non seulement sur son potentiel déjà connu, mais sur sa très probable extension verticale sud-ouest entrevue à la suite des derniers carottages.
De même, le prometteur indice du Vau Houdin demanderait à être confirmé. Il pourrait être à l'origine d'un second centre d'exploitation et de la reprise des recherches de gîtes semblables non affleurants, de type sommets de coupoles, dans les limites de cette région à fort potentiel métallogénique.
Pour ce qui concerne les circonstances ayant conduit à la découverte de ces 46 indices et districts, il faut admettre qu'elles sont nombreuses et qu'elles ne font pas toujours appel à un processus ou à un raisonnement purement géologiques. On sait, par exemple, que l'origine de la découverte du gisement de Montbelleux est due à la présence d'un échantillon de quartz à wolframite conservé au musée minéralogique de la faculté des sciences de Rennes et remarqué par le professeur F. Kerforne. De même, les indices de scheelite du Golfe du Morbihan ont été mis en évidence grâce à un inventaire minéralogique effectué dans les collections du musée de Vannes.
De même, on doit à certains minéralogistes professionnels ou amateurs, agissant sans aucune idée préconçue, la découverte des indices de Plougoulm, Kerdu, Orvault pro-parte, et Noirmoutier.
Viennent ensuite les découvertes tungstifères fortuites réalisées à la suite de recherches axées sur des métaux d'une autre nature. C'est à ce type de démarche que l'on doit la découverte des districts de Saint Renan et de Mortagne sur Sèvres grâce à l'uranium, de ceux de Nozay-Abbaretz et de La Villeder grâce à l'étain, de celui de La Lucette grâce à l'antimoine. Et aussi la découverte des indices de Pleuven grâce au béryllium et de Saint Jacut-les-Pins grâce au fer. Sans oublier, dans un premier stade des recherches, le district de Coat an Noz grâce à ses minéralisations de type BGPC, puis dans un second stade des travaux, grâce au plomb exploité au 18ème siècle bien que ces derniers travaux n’avaient pas été programmés. Finalement, ce district de Coat an Noz devant sa notoriété à un enchaînement de découvertes fortuites, voire de véritable hasard.
D'autres découvertes sont à mettre sur le compte de travaux de thèse, comme par exemple les indices de Lervily et de la Roche Balue.
Beaucoup de découvertes tungstifères sont dues à une simple prospection "au marteau" dans des environnements à priori favorables. Dans cet ordre d'idée on doit citer les districts et indices de Carantec, le Cloître St Thégonnec, Mesquen, Ploumilliau, Sullé, Trégomar, Dielette, Tréguennec, le Saint, Baud, Guénin, la Ricotière, et de Nantes-Orvault.
Bien sûr, une bonne part des découvertes revient à la prospection alluvionnaire systématique particulièrement bien adaptée à la recherche de gîtes stanno-tungstifères. Sont concernés ici les districts et indices de Landerneau, Lanmeur-Plougasnou, le Cloître St Thégonnec pro-parte, Locarn-Duault, Leslay, Vire, Montaigu (Mayenne), Locronan-Plogonnec, Bréhan Loudéac, Montaigu (Vendée), la Rousselière, le Plessis et la Peyratte.
Enfin, on doit à la prospection géochimique stratégique ou orientée la découverte des districts ou indices de Coat an Noz pro-parte, Beauvain, la Rousselière, St Herblon, la Jarrie et Chemillé-Echasserie.
Toutes ces méthodes ou circonstances, fortuites ou non, ont conduit à la découverte de la plupart des gîtes affleurants ou sub-affleurants sur la surface topographique actuelle mais d'autres restent probablement à découvrir sous des coulées de solifluxion ou des couches de lœss particulièrement épaisses.
Par contre pour ce qui concerne la découverte de gîtes non affleurants et profonds, seules les études géochimiques, géophysiques et structurales resteront d'actualité mais dans lesquelles le hasard n'aura plus guère sa place.
MONTBELLEUX l'unique exploitation
La mine de cassitérite et wolfram, sur la commune de Montbelleux en Luitré, dans le pays de Fougère est la seule exploitation de wolfram d'Armorique. Exploitation pour le wolfram, minerai de tungstène. L'exploitation a été épisodique de 1905 à 1957. Les recherche ont commencée en 1903 avec Fernand Kerforne, professeur de géologie et de minéralogie à la Faculté des Sciences de Rennes, qui redécouvre le gîte d'étain et de wolfram de Montbelleux.
Plus d'informations sur son histoire : http://montbelleux.e-monsite.com/
L'histoire de la mine est fidèlement rapportée dans l'étude de Jean-Marie Bodin
"LA MINE DE MONTBELLEUX - 1903-1983 - Luitré - Ille-et-Vilaine"
publiée en 1995 dans la revue "Minéraux et Fossiles".


LES PRINCIPAUX MINERAUX DU TUNGSTENE EN ARMORIQUE
PAR J-J CHEVALLIER
"Wolframite" variété minérale intermédiaire entre la Ferbérite dont le pôle ferrifère est Fe et l'hübnérite dont le pôle manganifère est Mn.
(Fe,Mn)WO4
Monoclinique
Durerté : 5/5,5
Densité : 7,14/7,54 selon le pourcentage de Fe et Mn.
Couleur : noire
Eclat : submétalique à résineux
Transparence : opaque
Photo : Wolframite, Montbelleux, Ille et Vilaine, France.
Collection C. Lolon, Photo L-D Bayle

Ferbérite
Fe2+WO4
Monoclinique
Dureté : 4/4,5
Densité : 7,6
Couleur : noire
Éclat : submétallique
Habitus : massif, prismatique, tabulaire
Macle : en V selon (100) ou (023)
Clivage : parfait selon [010]
Etymologie : Dédiée à Moritz Rudolph Ferber (1805-1875) collectionneur allemand.
Forme une série avec l'Hübnérite.
Photo : Ferbérite de Puy-les-Vignes, Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France
JL photographie
Coll. La Société de Géologie du Limousin
(Je n'ai malheureusement pas trouvé de photo de ferbérite bretonne)

Hübnérite
Mn2+WO4
Monoclinique
Dureté : 4/4,5
Densité : 7,1
Couleur : noire à rouge, marron
Eclat : métallique à adamantin
Habitus : prismatique, tabulaire, lamellaire, aciculaire
Macle : selon (100)
Clivage : parfait selon [010]
Etymologie : Dédiée à A. Hüner métallurgiste allemand.
Forme une série avec la Ferbérite.
Photo : Hübnérite, Lisio, Tromeur, Morbihan, France.
Collection C. Lolon, photo L-D Bayle

Scheelite
CaWO4
Quadratique
Dureté : 4,5/5
Densité : 6,1
Couleur : incolore, blanche, grise, orange, jaune, marron, noire, violacée, très rarement bleue et verte
Eclat : adamantin vitreux
Habitus : massif, bipyramidal, rarement tabulaire
Macle : selon (110)
Clivage : parfait selon [101]
Fluorescence : UV courts en en blanc bleuté
Etymologie : Dédiée à KW Scheel (1742/1786) chimiste suédois qui a montré la présence d'oxyde de tungstène dans ce minéral.
La scheelite est isomorphe avec la wulfénite, la powéllite et la stolzite.
Photo : Scheelite et grenats, Trez Traou, Cotes d'Armor, France.
Collection C. Lolon, photo L-D Bayle

ANNEXE
LES OCCURRENCES DE MINÉRAUX TUNGSTIFERES EN BRETAGNE
SELON MINDAT
A jour le 20 mars 2020, liste non exhaustive d'indices alluvuionnaire
FERBERITE

HÜBNERITE

SCHEELITE